VII 7
Le concept, l’intelligence humaine l’a utilisé pour se doter d’un nouveau monde. La chose familière dont elle avait déjà su se faire un outil, elle l’a considérée dans sa choséité, elle a pu énoncer qu’une table, par exemple, ne se compose pas de bois, mais pour la plus grande part d’espace vide parsemé, en quelque sorte, de charges électriques qui se meuvent à grande vitesse.
Pour la vie courante, cette allégation scientifique est une abstraction qui n’a pas d’intérêt. Pourtant, de ce maniement du concept découle tout ce monde technologique qui nous est maintenant quotidien.
Seulement, si cette ingéniosité conceptuelle a eu pour effet de modifier notre emprise sur les choses et de fabriquer de nouvelles choses qui modifient notre vie matérielle, les conséquences ont également touché notre comportement psychique et déterminé de nouvelle façon nos attitudes mentales.
Notre propos ici est justement d’examiner ces nouvelles déterminations pour voir comment elles peuvent modifier l’humain, parfois à son insu.
Pour concrétiser cette intention, prenons l’exemple d’un barrage : le concept du barrage fait apparaître l’image d’un ouvrage hydraulique destiné à retenir, accumuler ou dériver une grande quantité d’eau. Avant de former le concept qui donne cette image, il a fallu que les besoins de la vie humaine fassent éprouver la nécessité de capter l’eau. L’idée de pouvoir disposer à son aise d’un élément si nécessaire à la vie est d’évidence positive. L’idée de construire un barrage est une bonne idée.
Imaginons donc un film dont l’histoire raconte la construction d’un tel ouvrage. Le scénario exige la mise en place d’une maquette sur le terrain. Comme dans la fable, Concept convoque Intellect et Technicologon pour faire le travail et l’on braque les projecteurs sur les lieux de l’action. Pour un film, la finalité du barrage réside dans son apparence, comme on peut voir dans la ville qui l’avoisine de simple façades de maisons qui sont inhabitables.
La tâche de Concept et de son équipe est donc déterminée par la finalité de l’utilisation : ils ne procéderont pas de la même façon s’ils ont la commande d’un barrage “en dur”, utilisable pour de bon. Le concept du barrage sera même différent s’il s’agit d’accumuler, de retenir ou de dévier les eaux. La technologie devra également tenir compte de la topographie et de la nature du terrain. Enfin, les travaux dépendront largement de facteurs économiques.
Concept ne peut donc travailler efficacement que s’il est entouré d’une équipe d’experts dont il utilise les diverses connaissances. Si les projecteurs sont braqués sur un seul d’entre eux, si la vedette accapare toute l’attention et occulte les acteurs secondaires, l’histoire ne sera plus compréhensible. En l’occurrence du barrage, on aura provoqué une catastrophe technique, écologique, financière ou humanitaire selon les carences de l’entreprise.
Il s’avère aujourd’hui de plus en plus dramatique d’oublier ou de négliger l’étroite collaboration de toutes les facultés, à cause précisément de la complexité de la tâche engendrée par la richesse disponible de concepts. La puissance potentielle de certains nouveaux concepts devrait engendrer une retenue proportionnelle, car l’on ne joue pas impunément avec des forces qu’on ne sait pas maîtriser.
Il ne s’agit donc pas, pour reprendre la métaphore, de juger Concept en le déclarant malfaiteur, mais simplement d’apprendre à l’utiliser, comme on se sert d’un couteau en le saisissant par le manche plutôt que par la lame. C’est la suprématie d’importance attribuée au concept qui mérite examen et la trop grande latitude qu’on lui accorde dans les affaires humaines. En effet, lâché sur la pente, il acquiert une vélocité qui lui confère une nouvelle qualité : il devient projectile et peut blesser.
Encore faut-il, pour qu’il advienne un tel destin, qu’il y ait eu quelque consistance substantielle préexistante à la chute et capable d’y survivre, bulle de verre il sera pulvérisé, bille d’acier peut-être se plantera-t-il dans un obstacle mou qui le gardera prisonnier, boule de neige, il se transformera en avalanche. Toutes ces choses ont une existence préalable à l’événement décrit. Elles ont une structure matérielle phénoménale susceptible de se conserver dans l’espace et dans le temps.
Mais le concept n’est pas une chose, il n’a pas d’existence c’est un processus abstrait qui prend figure différente au fil de l’espace et du temps. Il est le dernier né de la famille des processus psychiques et sans doute à ce titre, il est gâté, on prend au sérieux ses fantaisies, on ne s’étonne pas qu’il ait tant de frasques à passer. Ses apparitions historiques sont si opportunistes qu’elles le rendent méconnaissable. Il est tellement histrion qu’à chacun de ses avatars, on accorde une identité pleine et entière, comme on fait de la place à un nouvel hôte.
Il est donc toujours paré d’un nouveau charme et l’on succombe à l’attrait de cette nouveauté. On ne soupçonne pas que c’est le même vieux compère, équipé d’un habit neuf.
Et pourtant, sa présence sur la scène n’a pas l’importance gigantesque, il n’est pas aussi indispensable qu’on pourrait le croire à voir son outrecuidance.
Observons le petit enfant : il ne possède pas le concept du temps. S’il éprouve un désir, qu’on lui accorde sa réalisation mais en la remettant à trois jours, ou trois semaines, il est frustré, non pas d’impatience, mais d’un sentiment navrant d’absence et de manque. Pour le réconforter, il faut lui permettre de vivre concrètement le délai en accrochant son imagination à des repères familiers : il sait que le jeudi, mais non, le “jeudi” ne signifie rien, il sait que revient périodiquement le moment où il mange, où il se couche, où il se livre à un jeu préféré dans un lieu où sa mère l’emmène, où il écoute son père lui conter une histoire. Il faut lui montrer trois gâteaux et les faire disparaître l’un après l’autre en évoquant l’analogie avec ces faits qui vont apparaître et passer pour laisser poindre à l’horizon du temps l’événement convoité.
Les anthropologues occidentaux ont noté le comportement psychique de tribus qui n’avaient pas encore eu le temps de s’adapter au fonctionnement abstrait de notre pensée. Ils leur demandaient, par exemple, pourquoi un certain nombre d’habitants avaient quitté le village. On leur répondait qu’ils, ou elles, étaient partis quand le ciel est rose avant que le soleil ne sorte de la terre, on décrivait précisément ce qu’ils avaient emporté, on pouvait donner leur nom et parler de leurs plus intimes particularités. On savait dire comment, qui se voit, mais non pourquoi, qui n’a pas d’apparence.
N’y a-t-il pas dans cette visée pragmatique une analogie de comportement avec celui de ces neurophysiciens qui s’enthousiasment orgueilleusement parce qu’ils parviennent de mieux en mieux à décrire ce qui se passe concrètement dans le cerveau, si bien qu’ils ne se demandent même pas ce que les êtres pensent ni pourquoi ils le pensent ?
Le dénominateur commun entre ces performances infantiles, primitives et pseudo-scientifiques est un principe concret, qui régit leur univers. On dispose dans ces cas d’une représentation du monde basée sur des métaphores ego ou anthropocentriques, une imagerie réduite aux conformations d’une contrée limitée par l’horizon très proche, une connaissance qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez.
Mais la différence concerne la valeur effective des procédés. Tandis que l’enfant apprend à dissocier le monde en objets distincts par la différenciation entre les données qu’il ressent à l’intérieur et celles qui appartiennent à l’extérieur, le primitif se livre avec une attention concentrée à l’observation minutieuse des données sensibles et construit un système abstrait pour organiser le chaos de ses perceptions.
Ces deux mouvements sont des ouvertures de croissance dans l’ordre de la complexité.
C’est l’inverse qui a lieu quand la connaissance rétrograde en réduisant brutalement la valeur des données acquises en les précisant de façon intempestive, comme en étaient coupables ces imprudentes assertions que cite Gaston Bachelard dans le chapitre sur l’obstacle animiste dans son étude sur la formation de l’esprit scientifique. L’académie avait donné en 1738 la garantie de son autorité à la fécondité minérale et à la reproduction métallique. Abusant de la classification par analogie, on retrouvait dans le corps humain les différents règnes de la nature et l’on attribuait au règne végétal les ongles, les poils et les cheveux. On expliquait le feu d’électricité par la vivacité animale.
N’est-ce pas succomber à pareille tentation que de prétendre “expliquer” l’humour parce que l’on a pu provoquer artificiellement les modifications chimiques qu’on a observées dans le cerveau d’un homme ou d’une femme qui rit ?
Bien sûr, un croyant scientifique serait scandalisé d’un tel rapprochement. Au niveau de la description mécanique du phénomène, il aurait raison de protester contre cette analogie. Les processus psychiques à l’œuvre dans la science moderne sont d’une toute autre nature que ceux qui ont présidé au type de connaissance analogique préalable.
Entre la révolution néolithique qui avait inventé les fondements de la civilisation : la poterie, le tissage, l’agriculture et la domestication des animaux, et celle qui permet l’éclosion de la pensée scientifique actuelle, il y a un saut stratégique inédit.
Plus proche de l’intuition sensible, le savoir primitif est un souci d’observation exhaustive et procède par un inventaire systématique des rapports et des liaisons qui aboutit à une classification intégrale. Cette systématisation au niveau des données sensibles aboutit parfois à un arrangement des apparences et des résultats dont l’efficacité ne peut être contredite par la science moderne, du moins après plus ample considération. Si l’intuition classe l’ail et le navet dans le même bouquet, la botanique proteste en affectant l’une à la famille des liliacées, l’autre à celle des crucifères. La chimie intervient et rabroue la botanique en rapprochant les familles, car ces deux plantes recèlent du soufre toutes les deux.
L’intuition a bien des talents que la connaissance par concepts ne peut posséder. Si les rites et les pratiques magiques sont décriés par l’esprit scientifique, c’est qu’il ne parvient pas à décider si ces procédés relèvent de l’herboristerie, de la sorcellerie ou de la psychologie. Mais dans ce savoir-là, le rapport au réel est joué avant d’être connu.

VII
Jamais le tocsin n’avait chanté si pur
quand, leur dieu mort,
il fallait s’éveiller,
quand la sérénité,
mordue par la vision déçue de l’appris qui s’émiette
et l’esprit chaoté d’une amère disette,
il fallait s’aguerrir
et vouloir d’un bond fauve
se hausser, hors le champ des confiances acquises
vers l’âpre création d’un horizon nouveau.
18.11.1972

Culture
« Culture » est un mot dont l’étude étymologique ne permet pas vraiment de débrouiller le sens. Il est plus profitable d’analyser d’abord la notion qui englobe à la fois la description de comportements usuels et particuliers aussi bien que la pratique des arts les plus sophistiqués. Pourtant, depuis le milieu du siècle dernier, l’usage du mot s’est généralement détaché de son acception savante pour aboutir à signifier également les us et coutumes de la gent animale.
C’est sans doute la sensibilité révolutionnaire qui a voulu débarrasser la culture de ses attributs somptuaires afin de la purger d’une quelconque évaluation hiérarchique. La culture est maintenant la somme des manières particularistes de tout un chacun. Dans cet effort de valorisation des différences, on s’est aperçu que les groupes et familles d’animaux démontraient des habitudes transmissibles et l’on a conclu qu’ils possédaient une culture, tout comme les humains.
En effet, le radical colo avec son participe cultum indique une pratique essentielle, commune à tous les êtres animés, liée à la motilité des corps et à leurs manières d’agir. La culture n’est pas étrangère aux animaux qui se doivent de colere, de cultiver leur puissance physique. Ils favorisent des règles de comportement social et veillent sur le développement de leur progéniture en lui offrant des modèles construits sur leur expérience. Quelles qu’en soient les modalités, la culture animale est une technique de survie.
Ce souci du corps, l’humain va le vivre par le moyen d’un acte mental. Et ce mot de culture, même quand il est associé à un autre radical pour signifier une activité concrète, comme dans l’horticulture ou la viniculture, est synonyme d’un travail de l’esprit. C’est à l’époque de la Renaissance que le mot ajoute à ses usages le développement des facultés intellectuelles et fait ainsi le constat de la capacité naturelle de l’humain.
Il faut donc observer une bifurcation du sens selon qu’on entend la culture selon le monde animal et physique et puis la technique d’exercices appropriés à la capacité mentale de l’humain. A partir de cet embranchement vont s’en dessiner d’autres.
Toute activité humaine procède d’une aptitude à conceptualiser le vécu. Le mot « érudition » en expose bien le processus. L’humain qui veut cultiver sa nourriture et s’habiller pour se protéger est confronté à la matière dans son état rudis, comme la terre et la laine, qui sont brutes et qu’il faut travailler pour en tirer des produits utilitaires. Au sens figuré, Cicéron décrit rudis et integer discipulus : Erudire consiste donc à penser une technique pour dégrossir et façonner la matière et les esprits. Eruditio est à la fois l’action d’instruire et le savoir obtenu par cet enseignement.
Mais la culture se distingue de l’érudition quand celle-ci, en se spécialisant, tend à collectionner le détail de ses faits. Dans La recherche du Temps Perdu, Proust évoque cette antinomie quand il décrit le sentiment négatif de certains vis à vis de .. « la culture désintéressée, qui leur paraît comique passe-temps d’oisifs .. ». La culture en tant que savoir est alors blâmée d’être devenue sa propre finalité.
Le glissement sémantique des mots répercute le désir de la volonté infléchie par l’affectivité. Ainsi, une personne de grande culture, qui est la richesse acquise et entretenue d’esprits curieux et raffinés, est admirée mais peut provoquer le dépit de ceux qui n’ont pas le loisir de cultiver ce luxe mental. Le sens du mot risque donc d’être dévié. Une telle réaction s’est produite dans l’histoire. A mesure que la société gagnait en souci d’équilibre sur le plan des avantages matériels, l’inconscient collectif tendait à soumettre la culture à ce principe d’égalitarisme. La tension du mot n’était plus portée sur la quantité ou la qualité de la culture, mais sur l’individu qui pouvait s’en faire valoir.
C’est au tournant du XIXe siècle que le mot prend la valeur descriptive qui différencie les aspects distinctifs d’une civilisation. La notion désigne l’ensemble des comportements et des caractères acquis de l’individu dans une société.
Enfin, la notion de culture est aujourd’hui plus largement évocatrice du paysage familier concernant l’imaginaire et les pratiques existentielles d’un individu que son éventuel travail d’exploitation d’un champ de connaissance.
Quand un groupe humain revendique la reconnaissance de « sa » culture, il réclame en justice son droit à la propriété d’un bien qui lui appartient en propre, qui le constitue historiquement et dont la configuration unique le différencie des autres. Cependant, cette acception de la culture présente une curieuse confusion. Bien que l’on assigne au mot une fonction identitaire, il s’est détaché de la notion comme un halo de valeur qui se cristallise en l’exigence du « droit à la culture pour tous ». Dans ce sens, la culture n’est plus ce qui caractérise déjà l’individu par sa naissance ou son milieu de vie mais un nouveau territoire dont il réclame la jouissance.
Considérée alors comme un bien désirable, la culture-objet s’offre comme un produit de consommation, alors qu’à son origine, elle était exercice et labeur. Se cultiver n’est plus travailler ses talents, mais se divertir. Les progrès de la technique auraient permis de cultiver sans trop de peine et d’y trouver plaisir.
Cette attitude qui privilégie la fonction « ludique » de la culture rejoint en fait l’impasse de celle qui lui est opposée, qui vantait la thésaurisation des connaissances et causait le bâillement ennuyé de ceux qu’elle contraignait et qui rêvaient de se dégourdir les jambes. Une telle révolte est légitime quand elle souligne la valeur de « l’expression personnelle », en opposant l’inventivité de l’individu à son gavage.
Mais le vice inhérent à ces deux représentations tient à ce qu’elles se focalisent sur l’objet au lieu d’avoir le souci du sujet. Cumuler le savoir dans sa tête ou prétendre le saisir de l’extérieur soit en l’achetant soit en réclamant qu’on vous le présente gratis sont les deux faces d’une même erreur fondamentale.
L’essence de la culture concerne le souci de soigner ses talents et d’exercer ses forces. Les produits de l’activité culturelle offrent des modèles, des références dont peuvent profiter ceux qui cherchent à se nourrir.
La culture implique un effort, dans le but d’augmenter sa puissance d’être.
2006
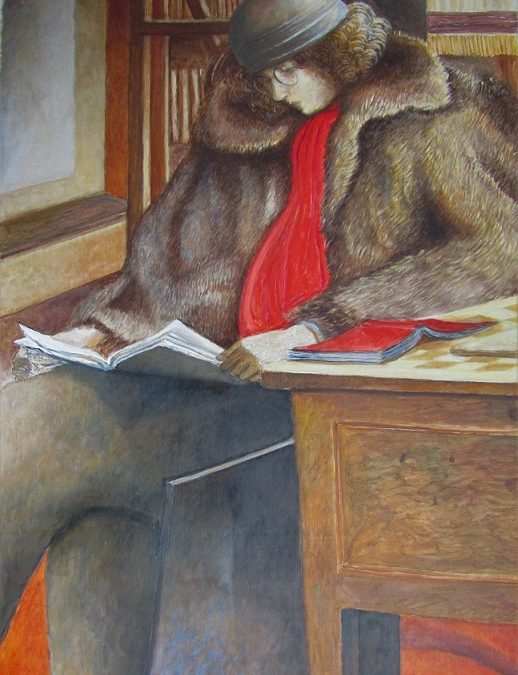
Commentaires récents