§8 Niveaux constituants de la diffusion de l’Être
Un observateur qui voit un poète prendre sa plume ou un peintre son pinceau pourrait demander de justifier un tel geste. S’ouvrent alors un faisceau de raisons qui décrivent l’amplitude et la nature de l’être-au-monde. L’artiste saisit son outil pour façonner un objet. Cette œuvre peut avoir une destination précise ou indéterminée dans une visée sociale, économique ou tactique. Tels sont les linéaments extrinsèques de l’acte. Sa vertu intrinsèque est de constituer l’être de son auteur.
Nos activités les plus humbles possèdent aussi ce schéma. L’aspect utilitaire est la cause prochaine de l’acte, sa raison est métaphysique. Mais qu’en est-il des actes dont la destination se rabat sur le moyen ? Le bon sens appréhende fort bien le problème et cependant l’ignore. L’intellectualité argumente à bout de souffle et perd le sens. Le poète est seul capable de survivre écartelé. Cette trinité est à l’œuvre en chacun d’entre nous.
Notre emploi du temps nous contraint, nos tâches nous assignent. La routine et nos devoirs nous semblent plus réels que les buts qu’ils doivent servir. Bientôt, une inversion nous possède : l’école et le ménage deviennent des objectifs auto-suffisants, l’administration accable le citoyen, les besoins du confort nous harcèlent, le profit nous ruine, les vacances et les loisirs nous épuisent, le taux de croissance qui menace de s’arrêter de croître nous affole.
Mais que fait le poète qui regarde une pierre, une ombre, un nuage ou ses propres soucis et fabrique un objet témoin de sa douleur et de sa joie de l’aventure ? L’activité descriptible qu’il déploie est imputable au corps du sujet. L’esprit qui le meut n’est pas de même nature, le sens du geste n’est pas l’organe car la main tendue peut donner le poison, le baiser peut être trahison.
La valeur de tout acte humain est définie par son intention, le choix de la finalité étant la pierre angulaire de la structure humaine. Et puisque l’humain est capable par cette liberté d’un accord d’harmonie de sa puissance avec la volonté universelle, la notion d’Être ne correspond qu’à cet effort. Il s’ensuit que tout acte accompli dans cette visée diffuse l’Être dans la création, tandis que ces mouvements ordonnés par l’habitude ou le seul profit utilitaire s’abîment au Néant. On peut donc être poète en faisant la vaisselle pourvu qu’une méditation vitale ordonne la routine et que cette routine ne soit pas devenue l’ossature principale de la vie.
En effet, la vérité humaine n’est pas de l’ordre de la matière (telle que nous la connaissons et que nous avons défini ses propriétés, mais nous n’aurons jamais achevé cette “inspection” car le monde se crée en permanence sous nos yeux et par notre action même). En tous cas, cette matière liée au temps et à l’espace est le lien obligé de l’esprit. Il ne peut être d’esprit sans matière. Mais il peut fort bien exister de la matière sans esprit. Car les notions d’Être et d’Esprit sont spécifiques à ce précipité de matière qu’est l’humain. L’âme universelle dont les anciens habitaient le monde, vivant et inanimé, correspondait à leur compréhension intuitive de ce physisprit à l’œuvre dans le vivant, de cette participation réactive de toutes les forces chimiques, de l’unité fondamentale de la matière visible et invisible. La diffusion à ce stade est synonyme de l’existence même du monde et est omniprésente.
Mais l’Être est le produit de la conscience humaine. Il n’y a pas de néant matériel, il ne peut être de Néant que pour l’Esprit.
L’esprit humain est installé dans une béance, une faille irrémédiable. Car la nature humaine a dénaturé la nature. Elle a créé, ou plutôt, elle est toujours occupée à créer un monde virtuel qui peut agir sur le monde matériel et qui pourtant est dépendant de lui. Le langage qui véhicule les concepts est le moyen de la puissance humaine mais il a tendance à confondre sa nature avec sa fonction. Il lui faut opérer une conversion douloureuse pour admettre que son attitude est souvent erronée, qu’il est coupable d’anthropocentrisme. Il est absurde par exemple d’associer la notion de finalité avec l’activité de la nature. Pour user d’une image humaine, on peut dire que la nature est une usine de fabrication dont le laboratoire dispose d’une richesse infinie de moyens dont la destination n’est pas programmée ; contrairement aux entreprises humaines dont les moyens sont élaborés en fonction de la production envisagée.
Le monde humain, son langage et son éthique sont donc structurés par ce caractère qui en est le fondement : l’autonomie de l’image conceptuelle et par conséquent l’incapacité de la Raison à fonder les valeurs. Mais si la Raison n’est pas fondatrice de la finalité, la potentialité à laquelle elle accède en désigne la voie : le nouveau pouvoir humain lui permettant, grâce à l’abstraction du concept, d’appréhender l’intégralité de la création et jusqu’à l’unité des contraires, la vertu concrète de ce pouvoir l’oriente absolument vers l’harmonie, c’est à dire l’équilibre matériellement possible dans une situation donnée. On comprend alors ce qui fonde les valeurs et ce qui semble les défaire : la finalité d’harmonie universelle qui est le désir fondateur de la Raison est contingentée, dans la pratique, par les limites qu’imposent les lois matérielles de l’espace et du temps. Il faut donc être sagement réaliste et trouver une formule de viabilité. Si la Raison ne peut réaliser un désir qui est absolu, c’est à dire qui ressort du pouvoir abstrait ou conceptuel de l’esprit humain, il faut que chacun de ses actes en prouve l’intention.
Souvent, bien sûr, la Raison constate avec dépit que ses efforts sont parcimonieusement récompensés. Si “l’enfer est pavé de bonnes intentions”, c’est que sur cette terre, il faut souffrir la masse et le poids des contraires en même temps que d’en connaître spirituellement l’unité. La “tâche” de la Raison ne sera donc jamais matériellement accomplie, mais justement ce serait un magistral et malencontreux contre-sens que d’attendre une telle incarnation de l’Être. Le dieu qui s’est fait chair est un vœu pieux, un symbole magnifique, un espoir fou qui s’apparente à la quadrature du cercle : dans la définition matérielle qui fait notre existence, une telle occurrence est impossible. Mais l’invention de ce mythe est amplement justifié par le désir de la Raison qui souffre dans ses fers et se console en voulant marier le concret avec l’absolu.
En fait, ce qui est sage, essentiel et réaliste, c’est de tendre à chaque seconde à réinventer la nature humaine, c’est-à-dire à s’efforcer d’utiliser l’image conceptuelle de telle sorte que l’acte engendré lutte activement contre l’exclusion (dans la mesure du possible) et témoigne pour la foi dans l’unité. Telle est la diffusion de l’Être … Tout acte posé dans une posture solipsiste, qui n’accomplit pas cet effort d’élévation et retombe au niveau de l’intérêt instinctuel, abandonne l’Être pour son Néant.

Opinion
Sapiens nihil opinatur, le sage ne hasarde aucune opinion, déclare Cicéron, offrant un jugement auquel Bachelard fait écho quand il dit dans le Chapitre premier de La Formation de l’esprit scientifique : « L’opinion pense mal, elle ne pense pas, elle traduit des besoins en connaissances. »
Il peut être utile de se référer à la nombreuse famille latine du mot pour en apprécier la valeur. Opinatio est l’acte de se former une conception (personnelle) mais opinato, de manière attendue, vient d’opinatus, qui signifie notoire, illustre, célèbre, qui est dans l’opinion (collective).
Opinio et le verbe Opinor sont relatifs à la conjecture, à la croyance et l’opinator est celui qui présume et n’a que des opinions. Opinabilis qualifie un avis fondé sur l’opinion. Opiniosus est plein de conjectures, opinosissimus en est fécond, tandis qu’opiniuncula désigne une faible opinion. Opinatrix enfin est celui qui conjecture et n’affirme rien.
En grec, l’opinion se différencie en gnômê et doxa. Le premier est la faculté de connaître, l’esprit, par opposition à soma, le corps. Gnômê est l’opinion résultant d’un jugement de droite raison opéré par la connaissance d’une chose et conduisant à un projet et ferme dessein. Doxa manifeste bien aussi une résolution, mais elle est fondée sur la croyance et la doctrine. Elle est opposée aux concepts de vérité, de connaissance acquise (gnosis) et de science (episteme). La doxa présente une opinion généralement admise, qui peut être simple conjecture et pure imagination.
Ut opinor, si je ne me trompe, le verbe latin prend racine dans le mot ops, opis, opum qui dit le pouvoir, le moyen, la force, la puissance ou l’influence. L’opus, qui est l’œuvre, le travail ou l’acte correspond à ce qui est éprouvé comme nécessaire. Opus est aliqua re, il est besoin de quelque chose.
Ce panorama lexical dresse le portrait de l’aventure dramatique du psychisme humain.
La puissance de volonté est le mobile et le moyen vital de tout organisme. Sans doute plus exigeants d’énergie que les végétaux qui se nourrissent par la photosynthèse et sont autotrophes, se nourrissant de l’énergie lumineuse, les animaux ont développé l’hétérotrophie. L’humain se nourrissant aussi de substances organiques, la différence de comportement provient de son aptitude psychique. L’humain veut entretenir la vie de son corps mais il veut aussi développer son esprit.
Le mode existentiel de l’humain étant le choix délibéré de l’acte, la volonté devient puissance de détermination. Alors que les choses et les bêtes suivent le mouvement des forces qui sont déterminées par les qualités substantielles de la matière, l’humain recouvre à son actif le facteur aléatoire à l’œuvre dans la matière « immatérielle », que l’on appelle aujourd’hui « quantique ». Le hasard constituant qualifie la potentialité psychique de l’humain.
Se produit alors une bi-polarité de la volonté. Initialement agent du déterminisme, elle devient puissance de détermination. Autrement dit, l’humain tout à la fois est incité à l’acte par des forces qu’il ne commande pas et capable d’infléchir ces forces dont il prend conscience. La « volonté » qui décrivait le mouvement universel inhérent à la matière devient chez l’humain la force directive personnalisée de son existence. L’acte psychique est volontariste et la liberté semble se confondre avec la volonté. L’humain veut vouloir et son désir exulte dans la liberté de son acte.
L’opinion est le produit bâtard d’un amalgame entre liberté et volonté. Le processus en est apparent dans la conduite de l’enfant qui doit apprendre la maîtrise des pulsions de sa volonté. Son « opinion » désigne alors tout bonnement ce dont il a envie. Au niveau des sociétés, le comportement est majoritairement déterminé par la conformation présente du paysage psychique collectif. L’opinion suit les croyances, les habitudes, voire les modes prévalentes. Celui qui s’efforce d’échapper à cet entraînement ne se fonde pas sur une idée admise mais sur un jugement étayé par une enquête de connaissance, même si parfois cette sagesse est encore intuitive.
Il semble alors à « l’opinion » que « le jugement » lui ressemble et n’a pas à lui en remontrer. Pourtant ces deux attitudes sont contraires. Tandis que l’avis, le dessein, la conviction, la résolution prennent appui sur une pensée menée par une intelligence qui prend en compte la complexité, l’opinion est passionnelle et sectaire, se référant plus aux sentiments qu’à la raison. L’opinion occupe l’écart entre le mimétisme et l’intolérance. Exprimant le plus souvent un lieu commun, elle se targue d’originalité. Dressée comme un coq sur ses ergots, l’opinion défie la volonté de l’autre. Il est frappant d’observer que les tenants d’opinions s’époumonent en arguties dans le seul but d’affirmer leur droit à la parole, sans se soucier de la teneur exacte des propos des antagonistes.
Le droit à l’opinion est alors une caricature. Ce droit émane pourtant de la structure psychique de l’humain. Il correspond à l’aptitude humaine à inventer le réel. Il représente aussi le progrès en maturité de l’esprit.
Dans les premiers temps de l’humanité, la faculté psychique s’organise. Elle élabore des structures virtuelles qui balisent l’univers matériel. Les animaux vivaient de repères sensoriels, l’humain y ajoute des produits abstraits qui servent d’outils au travail mental et nourrissent la mémoire. Ce mobilier psychique forme le texte des croyances qui peuvent éventuellement être adoptées ou combattues.
L’opinion naît avec l’esprit critique observant que ces repères psychiques sont malléables et sujets à renversement de perspective. Mais cette conscience de la relativité subjective n’empêche pas l’humain de rester attaché à l’objectivité de ses croyances. Et quand le dogme opiniâtre ne se construit pas autour de la foi religieuse, il prend le nom d’opinion, qui n’affirme rien de précis mais continue à croire.
L’opinion n’aime pas la pensée. Établie dans ses habitudes, elle est mécontente que la critique les dérange. Il s’ensuit que bien souvent l’opinion dise à l’inventeur que ce qu’il fait apparaître n’est pas vrai. Plus tard, quand l’idée juste a lentement pénétré l’inconscient collectif, on lui rétorquera que ce qu’il dit est vrai mais n’est pas nouveau.
Émettre une opinion, c’est affirmer la suprématie de son individualité contre l’Autre. L’opinion n’argumente pas, elle vocifère en réitérant sa dénégation. Elle ne peut convaincre puisque la pensée demande méditation, enquête, souci d’expérience dans la diversité. (Dans le langage ordinaire, il arrive bien souvent que l’on emploie un mot pour l’autre et que « l’opinion » gagne en valeur quand la pensée est déconsidérée) .
Si l‘opinion ne peut convaincre, elle ne peut pas non plus être convaincue. Quand la « pensée » s’efforce de présenter ses doutes et ses constatations, l’opinion se rétracte, se compacte ou se transforme en surface de glace ou la pensée perd le moyen de son équilibre.
Rebelle à la conversion raisonnable, l’opinion est pourtant sujette à la possession. Fondée sur le dogme et la croyance familière, elle est sensible à la profération d’une autorité brutale qui joue sur la passion de la volonté en offrant l’opportunité de s’épargner l’effort de la réflexion. « L’opinion publique » est un courant tout à la fois versatile et impétueux.
Quand elle est religieuse, l’opinion est intransigeante et cruelle. Quand elle ne l’est plus, elle transfère son allégeance à un autre système conceptuel et reste aussi bornée dans sa foi en l’absolu de son idole.
Cependant, l’opinion est la vertu de l’humain qui pense et qui parle. Elle est utile et saine quand elle exprime le travail de sa liberté dans la conquête de son intérêt métaphysique. Elle est morbide et destructrice quand la liberté rend les armes à la volonté.
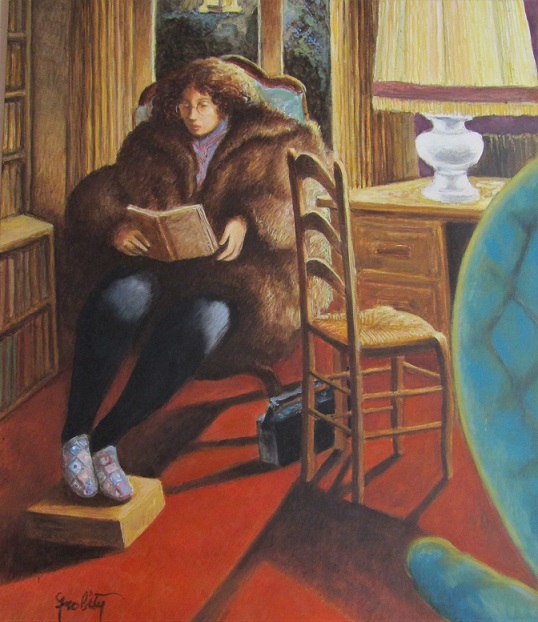
Commentaires récents