III
La tentation immémoriale de l’esprit humain consiste à transposer le concept, du plan logique où il est légitime, au niveau affectif où il constitue une compensation morbide à la situation inconfortable de la conscience qui se trouve dans un état permanent d’insécurité parce que, comme dans le jeu de puce, le réel, dès que l’on y touche, est propulsé ailleurs.
La passion enfantine trouve sa joie dans cette instabilité, qui lui procure le bonheur d’agir. La délectation de faire prendre l’air et de l’exercice à toutes ses facultés est encore intensifiée par l’éventuelle résistance extérieure qui relance l’élan et provoque un surcroît d’énergie et de puissance de volonté.
Mais la conscience, lasse de ces ébats, l’intuition du réel va céder la place à l’argumentation. A ce niveau, les causes et la finalité du jeu qui n’existaient pas à proprement parler, mais résidaient dans sa joie d’être vécu, ne sont plus perçues que par une absence. L’appareil conceptuel affairé va raisonner en ses termes habituels et chercher ce qui manque ici dans un autre espace.
Ainsi s’établit le malentendu et s’élaborent les mythomanies, les utopies et le Royaume des Cieux, qui sont des représentations abstraites qu’on habille du principe de réalité pour donner apparence à leur nature de chimère, comme aux fantômes on prête un drap et des chaînes pour les apercevoir.
Il est indéniable pourtant que ces créatures mentales ont une existence et une utilité qui est leur raison d’être. Ils fonctionnent à la façon de l’objet symbolique chéri des petits enfants, qui pleurent s’ils n’ont pas tout près d’eux le “mimi” qui représente non pas la mère ni l’amour de la mère, mais le besoin qu’ils en ont.
Ces représentations abstraites sont des symboles de la réalité et sont le produit naturel de la conscience, lieu de toutes les joies et de toutes les douleurs humaines.
En effet, la conscience est puissance de préhension, mais ne peut rien saisir d’un réel qui s’avère fragmentaire, paradoxal, qui échappe et fond entre les doigts.
La conscience, séduite par le réel concret, qualifiable et mesurable, amoureuse de son éclat, envieuse de sa substantielle assurance, convoite ces attributs qui lui font défaut. Mais elle n’éprouve que surprise et déconvenue quand elle s’en approche. Le concret est évanescent, les mesures ne font pas deux fois le même compte, l’éclat qu’elle voit ici est un reflet qui vient de là, cette affirmation d’existence est un charme qui ne résiste pas à la corrosion du temps.
Alors, comme elle ne parvient pas à s’éclairer avec la lumière du réel, la conscience dépitée se détourne et se fabrique à tâtons une idole.
Enfin, justement, l’histoire est tragique dans la mesure où sa colère la pousse à prendre sa créature pour une idole, c’est à dire à vouloir croire qu’elle peut remplacer le réel et qu’en fermant les yeux très fort et assez longtemps, elle les rouvrira pour découvrir qu’une substitution totale a été opérée, que sa magie a réussi, qu’elle est parvenue par sa ruse et son intelligence à corriger cet incorrigible réel.
A vrai dire, pour être capable de croire en son propre mensonge, il faut que la conscience commence son voyage avec une intention malhonnête : dédaignant la peine, l’effort et le temps que coûte au chercheur d’or la recherche de la moindre petite pépite, la conscience trop ambitieuse croira pouvoir accaparer tout le trésor d’un coup, et par tous les moyens ; elle ne découvre le plus souvent que l’amertume d’un désir frustré. Sa déception la pousse à la vengeance et à l’autodestruction.
Le concept est comparable au couteau de survie, sa nécessité est vitale, il peut trancher dans le vif pour assurer la subsistance, mais si la faim devient pure convoitise, ce n’est plus la justice qui le maniera, mais la folie destructive.
L’intelligence du réel, dans le règne animal, fait correspondre l’observation à l’adaptation. Il n’y a pas de hiatus entre la perception et l’action nécessaire, c’est une intelligence instinctive qui est toute réaction.
L’intelligence humaine a développé une autre voie, ou plutôt l’a élargie. En plus des réactions instinctives, elle a inventé une autre faculté qui transforme la perception en représentation abstraite. La conscience est ce regard extérieur que l’humain porte sur l’intimité de son existence. Le concept est l’outil et le matériau de cet édifice qu’est la conscience.
Mais si les règles de l’harmonie ne sont pas respectées, l’édifice sera laid, malsain, sordide et bancal et s’écroulera sur la tête de son auteur.
La conscience grandit, s’affirme dans sa complexité subtile grâce au concept. Les langues conservent les traces archéologiques de ce processus d’élaboration : à l’origine était la parabole, toutes les religions du monde sont des histoires où les forces cosmiques sont figurées par des êtres ou des objets signifiants.
Le concept est alors étroitement lié au réel, il est issu de l’observation des phénomènes concrets ; en inventant des mots qui représentent les choses et les rapports entre les choses, la conscience se donne la connaissance de sa perception. Le langage est l’outil conceptuel abstrait qui rend intelligible le chaos du concret.
Mais l’outil mal utilisé peut déraper, entamer la main qui voulait travailler le bois.
L’état naturel du vivant est d’être en état de participation active avec le monde. Il est partie du réel et le réel le pénètre de part en part. Les formes, les couleurs, les sons, les odeurs, les vibrations, les multiples interactions, auxquelles la conscience n’a pas encore donné de nom, impressionnent et modifient cette entité à la fois singulière et partie commune au tout du réel.
Pour conserver la singularité de cette existence, pour assurer la survie de cette entité singulière, il faut la différencier du tout, il faut l’isoler en puissance autonome. La vie animale ne perçoit du monde que ce qui est utile à ses besoins physiologiques. L’esprit humain est capable de perceptions infinies, mais la nécessité pratique l’oblige à des découpages conceptuels dans le réel, il survit grâce à des mots dont le sens est donné, grâce aux idées toutes faites.
La vie personnelle repose sur l’habitude, la vie en société tire sa cohésion de la coutume ; ces apparences de continuité sont des états nécessaires à la vie du corps ou du groupe pour une bonne économie de gestion, comme dans une maison bien ordonnée, chaque chose est censée demeurer à une place déterminée afin qu’il ne soit pas nécessaire de remuer ciel et terre pour se saisir du moindre objet.
Mais la place des choses est affaire de commodité et qui peut demander d’autres arrangements ; la coutume est basée sur un alphabet de communication, ses signes ont une valeur établie de monnaie d’échange à l’intérieur du groupe, mais de nouveaux produits peuvent entraîner une modification des signes et de leur taux.
Il est aisé de se laisser berner par l’apparence de continuité, d’assigner à ces segments temporels une vie éternelle, de qualifier leur existence d’absolue, de leur attribuer une autorité de droit divin (absolu et divin étant d’ailleurs des concepts taillés sur mesure pour les besoins de la cause).
La raison et l’affectivité peuvent alors se disputer en tirant alternativement sur les deux bouts de l’argument : ces concepts sont nécessaires, donc ils sont définitifs et indiscutables; ils sont contestables puisqu’ils sont contingents.
Les deux positions sont contradictoires et véritables, opposées tout en étant dignes d’affirmation.
La seule façon de démêler cet imbroglio est de savoir si l’on s’occupe du chat ou de l’idée de chat. La connaissance en soi n’est rien, si elle n’est connaissance du réel. Le concept est évidé s’il n’est action.
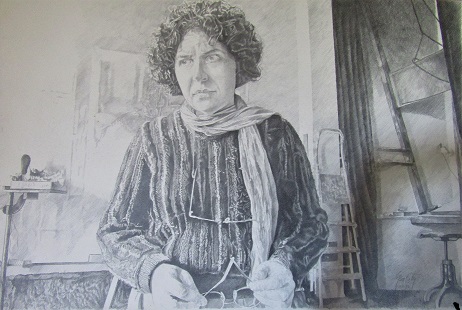
Un jour,
un escargot nageait dans un buisson d’écume
un soir,
un hérisson grognait dans un nid d’épluchures
mais la lune s’émut,
chatouillée,
et piqua de sa faucille endormie
le ver,
qui devint papillon.
29. 4. 1972
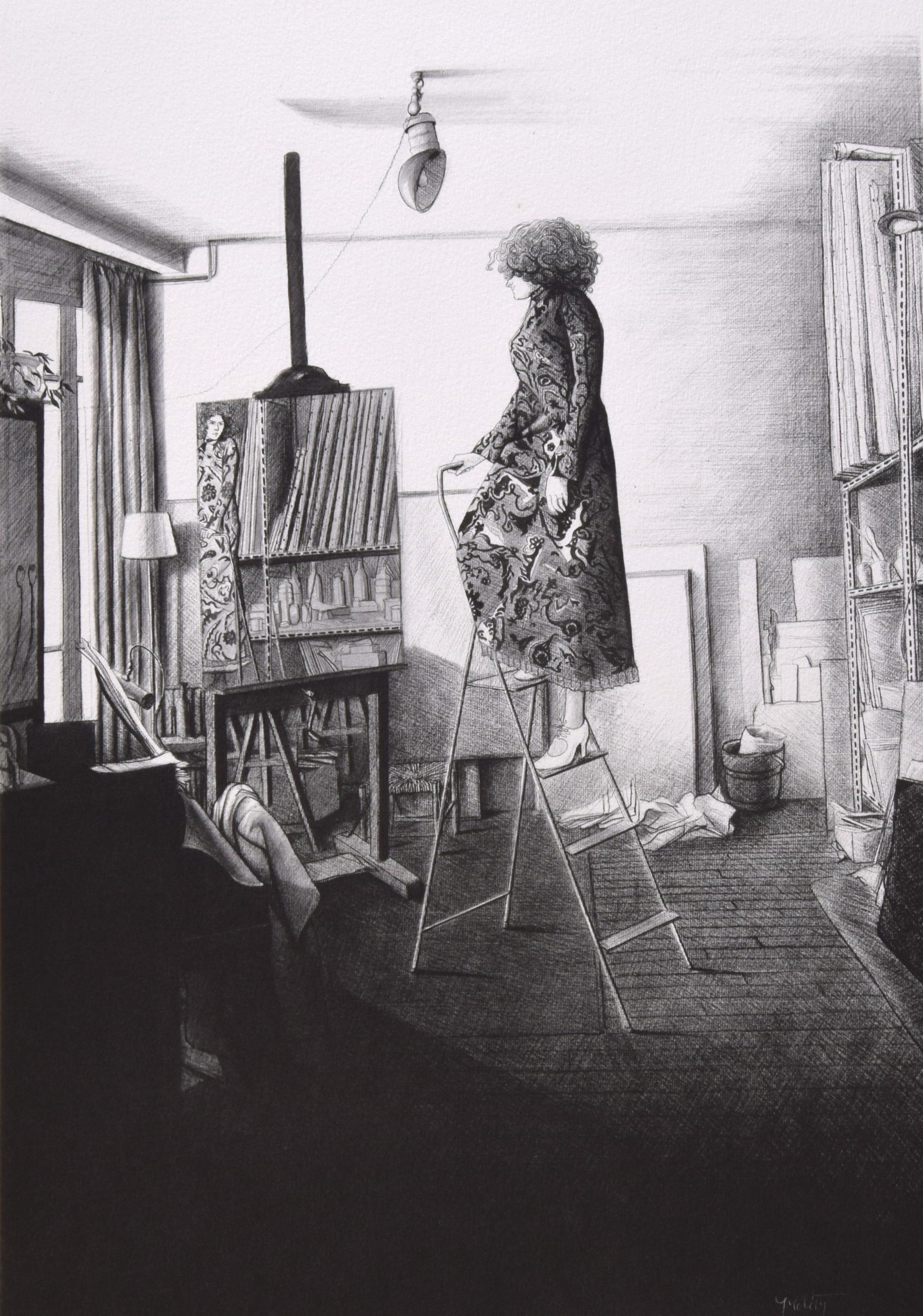
Concept
L’acte conceptuel est le modus operandi de l’existence humaine. Quelque soit le degré de savoir, de culture, d’intelligence et de technique, l’être humain se distingue par une structure spécifique permettant à son activité cérébrale de n’être pas exclusivement liée à celle de son corps, comme c’est le cas pour l’animal.
Cette indépendance de la fonction mentale est une spécialisation de la puissance cosmique, qui provoque et qui tient la cohésion d’un organisme. Pour assurer son existence, la créature développe des capacités pour se nourrir et se défendre. Au lieu de constituer une carapace, des griffes ou du venin, l’évolution s’est engagée dans la diversification neuronale du cerveau et concocte la faculté conceptuelle, un outil pour survivre.
Cette adaptation psychique est la version humaine du mouvement universel de la matière. Ainsi constituée, l’intelligence humaine, réflexive et abstraite, s’intéresse tout d’abord à ses relations avec son environnement immédiat, parente en cela de l’intelligence instinctuelle animale. La fonction de la faculté conceptuelle est d’assurer à l’organisme la satisfaction de ses besoins. Grâce à sa puissance psychique, l’esprit peut saisir les liens structuraux qui régissent l’interaction des corps matériels. L’intelligence conceptuelle humaine est capable de concevoir un outil extérieur à son corps. Elle est invention et non seulement adaptation.
En plus de sa vocation technicienne, l’acte de pensée qu’est le concept vise à comprendre tous les rapports qu’il rencontre. L’esprit formule ses expériences et les fixe dans des produits mentaux. Il fait œuvre métaphysique en créant des concepts pour capter tous les aspects de son activité. Ces objets virtuels que sont les concepts forment l’univers psychique dans lequel l’humain évolue si bien que les finalités du corps sont toujours l’aire du jeu de l’esprit.
Le pouvoir conceptuel donne à l’humain la faculté d’œuvrer sur le possible, c’est à dire d’agir sur la matière qui n’est pas constituée en caractères mesurables, comparables à ceux de son propre corps. Le corps animal agissait au sein de la matière présente, conditionné par le mouvement cosmique. Le corps humain, qui conserve cette posture charnelle, acquiert le pouvoir d’agir sur la matière qui n’est pas ici, qui n’est pas maintenant, qui n’est pas déterminée.
Si le corps humain est physique, l’esprit, qui dépend de lui, est métaphysique. Le « concept » est utile à la vie humaine, il lui permet de maîtriser la matière qui est le substrat de son existence. Il est aussi capable d’entrer en vibration avec ces états de la matière qui ne concernent pas immédiatement la singularité de son corps. Le pouvoir d’abstraction est la force, l’aptitude métaphysique est la vertu de l’humain.
Mais cette puissance porte la menace de sa désintégration. En effet, le danger inhérent à la faculté conceptuelle humaine est de confondre les produits idéels de son pouvoir psychique avec ceux de sa maîtrise concrète sur la matière. Comme elle se sert des uns pour obtenir les autres, elle a toujours tendance à les considérer comme étant de même nature. La confusion s’établit quand elle attribue aux notions virtuelles dont elle peuple son univers mental les caractères déterminés des substances matérielles du monde où elle se meut. Les occasions sont myriades où l’intelligence humaine s’empêtre dans ses pouvoirs et prend le mot pour la chose.
Les images mentales de l’humain se constituent en événements psychiques qui sont les indicatifs de l’acte. Mais si les concepts sont bien les outils de présentification du projet, ils demeurent malléables et indéterminés. La création de nouveaux concepts peut augmenter la puissance d’agir mais les concepts eux-même sont insubstantiels.
La distinction entre l’intelligence conceptuelle et l’intelligence pratique est légitime sur le plan fonctionnel mais elle conduit à une erreur essentielle. En effet, c’est la même faculté conceptuelle qui préside à la fabrication du pain et à celle des œuvres « intellectuelles ». La différence qui existe entre ces activités tient à la manière dont cette faculté est utilisée. Il serait insensé de croire que l’intelligence pratique humaine n’est pas basée sur la formation du concept puisque tout acte humain procède nécessairement d’un rapport d’abstraction avec le monde extérieur. Il est vrai cependant que certaines activités humaines sont plus « intellectuelles » dans la mesure où elles utilisent les concepts comme les matériaux même de leur mise en œuvre.
Mais si la formation de concepts est le mode utilitaire obligé de l’existence humaine, là n’est pas l’essence de sa structure. Tout organisme en effet a partie liée avec le reste du monde et sa vocation cosmique est d’agir en fonction d’un ensemble à tenir et à constituer. Pour le monde animal, c’est la force appelée Instinct qui orchestre ce jeu. Pour l’esprit humain, c’est un état mental d’ouverture, en partie réflexe, en partie voulu, qu’on peut appeler Untuition, qui permet à la Raison d’utiliser ses pouvoirs conceptuels dans un projet d’harmonie.
2006
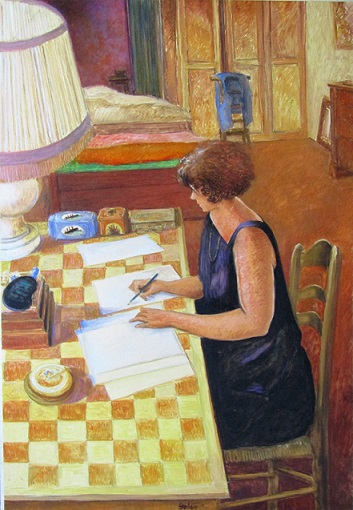
Commentaires récents