La fable place les protagonistes dans la situation originelle. Il faut donc entendre que leur existence autonome n’est possible que dans un temps mythique. En fait, ils ne prennent figure que par et dans l’histoire.
A l’origine humaine, comme avec l’instinct et l’intelligence animale, il n’y avait qu’une visée d’attention. Cette extase du regard a suscité la répétition, fait naître la mémoire d’une synthèse mentale et engendré l’invention du signe abstrait qui permet de retrouver la forme et d’y imposer la main.
Mais par filiations répétées, la réalité se dote de familles formelles dont les rejetons ne connaissent plus leur commune origine, n’assument d’autre fonction que le développement d’une progéniture selon les lignes affirmées de leur propre différentiation.
Dans le développement individuel, l’autonomie de ces différentes fonctions assure l’harmonie de l’autogestion de l’organisme tant que la circulation reste libre entre les différents secteurs d’investissement.
Mais qu’un événement vienne à provoquer la surexcitation d’un complexe psychique, le déséquilibre engendré entraîne le refoulement de certains éléments et le sur-investissement des autres, ou d’un seul.
Or, au départ historique de l’aventure humaine, la fonction conceptuelle n’est pas donnée d’emblée. Elle n’existe pas encore chez l’enfant, les anthropologues constatent l’absence de concepts dans les langues primitives, pourtant riches en pensée abstraite. Le fait que certains colonisateurs aient constaté cette lacune et aient porté un jugement de stupidité à l’encontre de ce type de pensée permet d’évaluer l’état du déséquilibre mental de ces individus-là ou de la “culture” dont ils se réclamaient ; déséquilibre d’autant plus accusé qu’il affichait ingénument l’amnésie de ses propres origines, le berceau de cette civilisation “aboutie” se trouvant dans la pensée grecque qui, au temps pré-socratique, fonctionnait sans concept.
Un argument triomphaliste se permettrait de conclure de cette remarque au “progrès” de la pensée occidentale qui se serait perfectionnée depuis ces temps reculés. Ce serait encore doter les concepts de progrès et d’évolution d’un quantum de surinvestissement qui seul peut aboutir à ce jugement d’autosatisfaction.
Les traces de ces appréciations survoltées ne manquent pas dans l’histoire, elles sont racontées dans les récits de conduites fanatiques, de l’Inquisition et de toutes ses filiales qui succombent au principe d’ambivalence en prouvant par la haine la vérité de la religion d’amour – à toutes les pratiques politiques, économiques ou domestiques, personnelles ou publiques, qui tendent, par une fixation à l’objet, à inverser le désir d’harmonie, à obtenir un résultat contraire au but qui s’offrait au désir ; par exemple devenir l’esclave d’une drogue ou d’une richesse dont on espérait la puissance et le bonheur, transformer la “culture” en consommation, nuire aux individus concrets au nom d’un principe abstrait, causer le pire en prétendant vouloir le mieux.
Inexorablement, une qualité poussée à l’extrême devient vice. Un développement outrancier provoque la maladie. Ce qui fut bon peut être nocif en un autre temps et en d’autres lieux.
Il convient donc de veiller et d’activer un champ de forces où vive le conflit, où se cherche l’équilibre éternellement instable dans sa relation construite avec le paradoxe.
Pour garantir cette vitalité, il faut éviter d’hypostasier les concepts, en se déchargeant la conscience de la responsabilité individuelle sur quelque notion abstraite, personnifiée en projection idolâtrique. Il vaut mieux renoncer à croire que l’on serait définitivement tranquille et confortable si seulement l’on trouvait la bonne formule d’installation.
Cette hypostase, comme les poupées russes, se présente à plusieurs échelles de grandeur mais avec la même figure : prendre un concept pour une réalité, c’est lui prêter une substance fixe, dotée de propriétés déterminées, à laquelle on attribue cette qualité appréciable de rester posée là où l’on pourra la reprendre quand on voudra.
En traitant la notion abstraite comme une valeur concrète, nous pensions avoir un sol ferme sous nos pas. Mais voilà qu’il se dérobe à nos pieds. Les expérimentateurs de la mécanique quantique ont fait la même observation que les peintres : à l’horizon profond de la matière, il n’existe plus d’objets individuels qu’on puisse décrire comme dans le langage courant où l’on dit par exemple qu’on voit une table et qu’elle a deux tiroirs et quatre pieds. Les peintres savent que la couleur varie sous la lumière, et avec elle, la forme des choses. Qui plus est, la couleur n’est perceptible que par réaction à ce qui la côtoie : le nom de la couleur sur le tube n’est qu’un concept fonctionnel qui ne décrit pas la nature réelle de telle valeur dans tel espace de tel tableau.
On peut faire la même remarque pour le sens des mots dans la phrase.
Suivons par exemple le fil de la notion de concept. La généalogie du mot nous présente l’idée non-conceptuelle d’associer deux choses en les rapprochant l’une de l’autre, cum-capere, prendre avec. Le verbe concipere se conjugue, le fait accompli, en participe passé, conceptus, en français conçu, dont va naître par abstraction le substantif concept.
Dans le dictionnaire Robert, la carte d’identité du mot annonce que le concept est un acte de pensée aboutissant à une représentation ou à une idée générale et abstraite. Mais de même qu’il n’y a rien de commun entre un acte réflexe, un acte de foi, un acte d’autorité, un acte de complaisance, un acte médical, un acte administratif ou le dernier acte de la comédie, le concept a plusieurs chapeaux qui font de lui à chaque fois une toute autre créature.
Dans la pratique courante, le concept apparaît le plus souvent comme le rythme d’un vers dont on ne peut retrouver les mots, qu’on chante sur “la la”, comme le petit Nicolas qui psalmodiait la table de multiplication sans les paroles.
Sa définition en est “tout objet de pensée, individuel ou général, vague et mal formé ou analysable”. Si l’on n’a pas la capacité d’en faire une description précise, à quoi peut bien correspondre concrètement le concept de démocratie, le concept de confort ou celui d’art ?
Sur le plan psychique, cet “acte de pensée”, efficace comme une pulsion inconsciente, s’apparente à la propension de réaliser un ordre qu’on a reçu sous hypnose. Il n’est pas conscient mais il est déterminant. Il fonctionne là comme une passion affective, où l’on aime aveuglément, où l’on croit sans être à même de prouver, où l’on adopte sans y penser les attitudes et les comportements d’un code.
Tout autre est le concept issu d’un travail de réflexion, qui prend acte d’un réel et lui taille un vêtement sur mesures. Ce concept-là mérite intégralement sa définition d’acte de pensée aboutissant à une idée abstraite.
Seulement, il reste une créature abstraite.
Il ne s’habille pas des plumes du paon afin de se faire prendre pour un réel tangible. Il affirme modestement sa nature de schème opératoire, falsifiable au gré des exigences du réel, et se prête à la pratique d’un conducteur qui pense aller en droite ligne de chez lui à la ville voisine et tourne pourtant son volant de droite et de gauche pour suivre les méandres de la route.
Telles ne sont pas les performances conceptuelles ankylosées des intégristes de tout acabit, dont le plus grand souci est d’annihiler tout ce qui ne va pas dans le droit fil de leur idée fixe. Contrairement au concept bâti sur mesure, qui habille harmonieusement l’individu pour lequel il fut taillé, et se prête mal à d’autres conformations, le concept informe s’endosse comme un sac, convient à tout en effaçant toute distinction.
Le bon concept est un adjuvant, le mauvais une coercition. Il est bon quand on l’utilise pour ce qu’il est, comme un outil bien affûté, manié avec soin, choisi pour accomplir une tâche précise, déterminée par d’autres facultés.
Il est mauvais quand on l’installe en lieu et place de ses autres facultés, qu’on l’instaure en tyran qui prétend assujettir et soumettre toute diversité.
C’est l’ignorance et la paresse qui l’invitent et lui permettent d’imposer son règne injuste : ils proclament en chœur que la puce est devenue sourde si elle n’obéit plus et ne saute pas, quand on lui a coupé les pattes ; que la maison n’est plus humide quand on y a installé des doubles vitrages aux portes et fenêtres ; que le “bon sauvage” était bien plus heureux que nous, dans sa caverne ; que depuis la création des puces électroniques, l’art a changé de propos.
Le bon concept, comme l’élégance, ne se remarque pas.
Adapté à la situation qui l’appelle, il semble être une force naturelle et aller de soi.
Il est pourtant le fruit d’une attention, d’une patience, d’une persévérance, d’une ingéniosité qui sont les éminentes qualités de l’intelligence humaine. Mais s’il renie sa parenté et se sépare de Mnémosyne et d’Intuition, il devient monstrueux et nuisible.
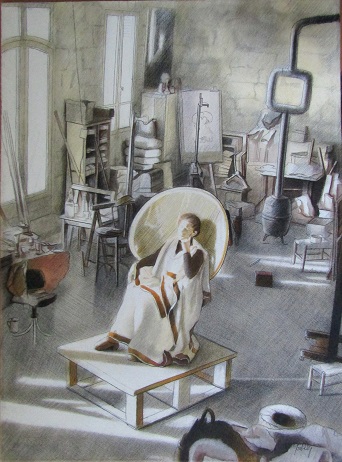
VI
C’est dans la pourpre vespérale
quand la nuit touche à la terre
et que sa pulpe étreint l’espace
et l’horizon palpite seul
dans le faisceau mouvant
où l’ambre rose circule en l’or
coulant à flots de miel,
c’est la musique absolue d’une étoile,
sereine, après l’illusoire violence du jour.
19.10.1972
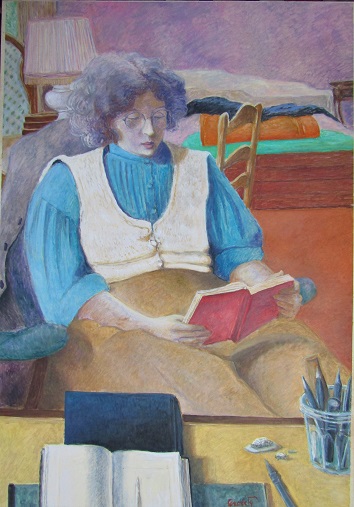
Conscience
Les annales de Tacite offrent le témoignage du sens premier du mot. Est tibi Augustae conscientia, tu as la connivence d’Auguste. Scio, c’est savoir, conscio ( cum et scio) c’est partager la connaissance de quelque chose avec quelqu’un, être dans la confidence, participer, être complice.
Ce savoir, c’est aussi la connaissance claire de son propre sentiment. La remarque de Tite-Live, conscientia virium et nostrarum et tuarum, la claire conscience qu’ils ont de nos forces comme des leurs, montre bien que cette connaissance est à la fois objective et réflexive.
Elle implique une évaluation. Cicéron mentionne optimae mentis, une conscience qui a le sentiment d’avoir eu d’excellentes intentions, ou dans le cas inverse, cum conscientia scelerum tuarum agnoscas …du moment que, conscient de tes crimes, tu reconnaisses… il évoque une présentation morale de la conscientia animi, la voix de la conscience. Ce concept devient absolu quand le mot signifie l’idée même du bien et du mal, comme dans la conscientia morderi de Cicéron qui parle de quelqu’un souffrant de remords de conscience.
Mais quand dans l’Enéide, Virgile décrit le loup, lupus, conscius audacis facti, conscient de son acte audacieux, il y a tentation d’un glissement anthropomorphique. Ce que démontre la conduite animale est plus un savoir-faire qu’un savoir, car le mobile de l’acte est un enjeu physique. La conscience dont jouit l’animal est la somme de mesures sensorielles qui lui permettent d’agir « à bon escient », c’est à dire de façon pertinente, qui convienne à son projet de survie corporelle. Cette capacité de perception animale est très fine et l’on peut dire que sur le plan de l’information sensorielle, la « conscience » animale est bien supérieure à l’humaine.
Justement, la conscience humaine n’est pas essentiellement conscience de quelque chose bien que tel soit le cas sur le plan existentiel. La structure psychique de l’esprit fait que la conduite humaine se construit par le biais d’une image abstraite, différant du monde animal dont l’information cérébrale commande directement et uniquement l’acte moteur.
Le processus de conscience s’établit donc pour l’humain à deux niveaux : celui de la perception sensorielle et celui de sa mise en forme conceptuelle. Dans ce jeu complexe, la conscience ne se manifeste pas toujours sur le même mode. Il y a des états de conscience spontanée, quand l’adéquation entre le stimulus et la réaction s’établit de manière instinctive. Cette conscience subliminale est le mode de fonctionnement « naturel » du psychisme au sens premier, historique, de l’évolution.
Cette conscience inconsciente n’est cependant pas l’équivalent de la conscience animale en ce qu’elle porte les aptitudes psychiques de l’humain. Elle permet par l’effet de la mémoire de vaquer aux affaires quotidiennes avec un certain automatisme qui résulte en une réelle économie d’énergie. Mais cet habitus qui offre la souplesse peut aussi devenir un carcan. Le savoir de la conscience s’abîme en ignorance et se condamne à l’aveuglement quand la puissance de répétition submerge, bloque ou étouffe la perception. Il faut alors une « prise de conscience » pour rétablir une juste correspondance.
Une telle faillite de la conscience peut se produire quand un trauma initial ne parvient pas à s’intégrer dans une expérience aboutie. L’ébranlement occasionné continue à se faire sentir et tend à se substituer à tout autre stimulus, engendrant des réactions imprévisibles et aberrantes. Ce décalage entre le stimulus présent et son effet potentiel tient à la qualité de l’évaluation conceptuelle. Étant donné que le monde humain est peuplé d’entités psychiques, il suffit que l’imaginaire élabore une forme et s’y pétrifie pour que tout l’organisme réagisse comme en face d’une présence réelle. Ces situations extrêmes sont pourtant le développement morbide de l’état où le réflexe d’habitude a le pouvoir d’inhiber la perception.
Il faut observer aussi que les formes de conscience diffèrent selon les âges de la vie. Les enfants découvrent progressivement la rupture entre leur monde intérieur et les entités externes qui provoquent la volonté. La caractéristique majeure de la conscience enfantine est une participation intuitive intense aux forces du monde qui l’entoure. On dit que les enfants « devinent » les choses. Ils les vivent mais ne le savent pas. La conscience réflexive se construit par le langage et nécessite un long apprentissage. Mais ce processus de conceptualisation a tendance à réduire ou même étouffer la part intuitive de la conscience.
Une vision précise de la distinction des entités est nécessaire pour que la liberté commande la volonté avec justesse et fermeté. Les auteurs de méfaits excusent souvent leur conduite en plaidant qu’ils « ne se rendaient pas compte » de leurs actes. Cette inconscience est d’ailleurs le lot commun de chacun. La plupart de nos décisions sont accomplies avant d’être explicitées au regard du sujet agissant. Nous sommes déterminés par l’appareillage psychique formant notre individualité, composé de tendances génétiques, d’héritage culturel physique et mental, d’expériences personnelles avec leurs agrégats affectifs. Ce mobilier intérieur influence et conditionne nos faits et gestes mais sa présence est trop familière pour être directement perçue. Elle ne peut se laisser deviner à la vision consciente que par un effort d’analyse, dans un grand remuement de ménage.
Il s’avère donc que la conscience de veille est un savoir très superficiel. La « perte de conscience » causée par des accidents physiques, comme le coma, ou psychiques, comme les maladies mentales, n’empêche pas un mouvement actif de la vie intérieure. Elle pourrait même contribuer à dévoiler l’essence de la conscience humaine. En effet, la conscience essentielle, contrairement à la conscience de veille, concerne ce qui ne peut être exprimé. La vertu de la conscience n’est pas cette vision de quelque chose, nécessaire à l’existence, c’est l’aptitude à voir l’invisible.
L’emploi de ces termes « voir » et « vision » impliquant une perception sensorielle peut induire à confusion car ce à quoi s’ouvre la conscience humaine est un univers psychique. L’humain n’est pas seulement présent à son corps mais aussi aux produits abstraits que crée son esprit et qui déterminent sa volonté. L’être humain agit en réaction à ses représentations psychiques. Le bon sens le sait bien qui réfère la conduite à l’instance de la « conscience morale ».
La conscience animale vise à la survie de l’organisme individuel. L’humain intègre cette même attitude en ce qui concerne la dimension existentielle. Mais ce qui caractérise la conscience de l’esprit est une ouverture, une capacité de présence à ce qui n’est pas lui et ne répond pas directement et uniquement aux exigences de son intérêt propre. L’essence de la conscience humaine est de s’incarner dans une autre substance que son unique moi.
2005

Commentaires récents