Pour mener à bien une tâche, il faut se munir des outils appropriés. Ainsi, pour faire bon usage de la fable qui suit convient-il de régler son entendement sur le pas de la métaphore : il ne s’agit pas de projeter point par point les caractères de l’image sur les aspects de la vie courante.
Comme l’annoncent les romanciers, toute ressemblance de ces créatures avec des personnages réels est purement fortuite. Le fait que la grammaire de la langue française exige d’attribuer un genre masculin ou féminin à certains mots n’implique pas de conclure à une identification de leur nature avec les structures psychologiques des hommes et des femmes.
Cependant, les personnages de la fable, nommés par des vocables correspondant aux diverses facultés humaines, réalisent par leur individualité respective un aspect masculin ou féminin.
Or, ces aspects ne relèvent pas du jugement qualitatif anthropomorphique que la pensée occidentale a coutume d’utiliser. Il faut plutôt comprendre le masculin et le féminin comme des images concrètes des principes premiers d’opposition et de complémentarité qui sont les éléments de base de toute appréhension de l’être.
Il n’y a donc pas lieu d’interpréter d’un œil susceptible les qualités prêtées au masculin ni au féminin : l’ombre et la lumière, le fort et le faible, le ferme et le souple sont des attributs de l’être qui se répartissent équitablement chez les deux genres humains sexués.
Mais si les personnages de la fable sont nommés par des termes qui décrivent des facultés humaines, c’est que sa perspective nous est contemporaine. La Fontaine se servait des animaux pour personnifier les vices et les vertus humains (pour l’Académie, le masculin l’emporte) ; Ovide en avait fait des dieux, un(e) poète “moderne” n’a plus qu’un panthéon conceptuel pour parler de l’être de l’homme (et de la femme!). J’ai opté pour l’humain.
Ayant ainsi ajusté nos lunettes, nous pouvons faire connaissance de la fable.
Intuition et Concept, assis au bord de la rivière, considèrent le flux du courant.
Au regard d’Intuition, sont présentes les berges de la rive avec leur flore, les poissons, le soleil, la brume et leurs
exhalaisons.
Concept boude et jette des cailloux dans l’eau d’un air morose. Intuition lui fait remarquer l’apparition de jeux irisés de lumière sur les ronds qui surviennent après chaque lancer de caillou. Mais il n’y voit rien d’intéressant.
Elle pose alors à la surface de l’eau quelques brindilles sèches qui s’en vont canoter prestement. D’un coup, Concept se dresse, très excité, il voit tout, il comprend et l’amont et l’aval, le flux de la rivière et la puissance du courant.
Il s’en va quérir d’urgence Intellect qui se promenait avec Mnémosyne et le jeune Technicologon pour leur parler de sa découverte. Intellect conçoit aussitôt l’intérêt de l’observation et note sur son carnet quelques formules mathématiques y-afférentes. Mnémosyne est charmée et commente avec Intuition la merveilleuse sagacité de leur compagnon. Technicologon, qui s’était éclipsé en clignant de l’œil, réapparaît bientôt chargé de divers objets qu’il dépose près d’Intellect, et se met à discourir à grands gestes et volonté de persuasion.
Intellect est séduit, ils élaborent tous deux le projet d’un ouvrage qui va servir leur intérêt en profitant de l’application de ce nouveau principe et se mettent à la tâche avec enthousiasme sans plus attendre. Mnémosyne et Intuition, désirant participer au jeu, s’approchent et donnent leur avis. Mais à part quelques astuces et conseils de prudence qu’on saisit au vol de leur propos, leur opinion est tenue pour négligeable, on leur signifie d’aller s’amuser plus loin.
Son premier ouvrage achevé, Technicologon, ébloui de sa faconde, persuade Intellect de lui concocter un nouveau plan, pour mettre à l’épreuve son ingéniosité. Sans d’autre critère que la résolution de problèmes techniques, sans d’autre souci que le défi qu’ils posent à leur puissance, sans scrupule pour les moyens, sans regard pour les conséquences de leurs agissements, ils s’en vont de par le monde établir les pièces et les contre pièces de leur machinerie.
Ils ne connaissent plus de repos. Ils n’ont plus d’yeux ni d’oreilles que pour leurs propres performances. Ils n’ont plus foi ni cœur. Ils n’appellent plus Intuition ni Mnémosyne par leurs noms, ils les ont oubliées, ils les ont asservies, enchaînées pour des tâches domestiques et ancillaires.
Quant à Concept, ivre d’orgueil, il est partout, se mêle de tout, se voit indispensable et se croit tel. Il court de tête en tête, il vole de bouche en bouche, il se gonfle et se déclare maître de l’univers. Il bouscule Intuition, en remontre à Mnémosyne et pour se faire admirer, saisit un seau, puise de l’eau dans la rivière, la fait couler par terre et tonitrue : “Regardez-moi, j’ai capté la force du courant.”
En fait il n’y a là qu’un petit pipi, bientôt desséché, que la terre a bu.
Mais Concept est tellement imbu de lui-même qu’il convoque Critique Huissier Commissaire pour lui faire enregistrer le discours fleuve qui découle de son geste. CHC qui se fait appeler par un sigle pour cacher le désordre de ses personnalités, lâche aussitôt la meute des Actions Virtuelles qui l’accompagnent partout. Elles organisent bientôt le tapage et assomment tout ce qu’elles trouvent sur leur passage en proclamant le règne de la princesse Réalité Bancaire.
Ce qu’il adviendra aux sujets soumis à ce pouvoir, la fable ne le décrit pas, il suffit de regarder autour de soi.
Mais il convient de chausser ses lunettes pour en déchiffrer la morale. Un réflexe premier en ferait un fantasme conservateur, ennemi du progrès, enclin à porter une accusation de diabolisme sur le matérialisme technologique. Ce jugement résulterait d’une lecture aussi myope que la naïveté qu’il dénonce. Cela prouverait qu’on n’a pu lire la fable qu’au moyen de la représentation a-priori contre laquelle, justement, elle met en garde.
On aurait prélevé du réel un concept isolé à qui, comme disaient les dévotes dans ma jeunesse, on aurait donné le Bon Dieu sans confession, c’est à dire qu’on s’ingénierait à nommer les qualités spécifiques d’un objet sans examiner ses réactions sous une expérience, à croire un agent sur la foi de ses dires sans preuve de son savoir-faire, ni l’assurance que ses propositions conviennent à la situation.
L’on procéderait à la manière des schizophrènes, en traitant les réalités concrètes comme des choses abstraites, en faisant affluer sur le seul mot l’investissement que devrait porter l’objet.
Il y aurait rupture pathologique entre les différents niveaux de réalité. L’investissement affectif, retiré aux pulsions élémentaires serait uniquement affecté à l’organisation des éléments abstraits du discours ; le monde personnel, victime de la surenchère accordée au jeu des mots, se dessécherait et deviendrait incapable de vivre sa propre identité en accord avec sa propre origine. L’effort de contenir la complexité du réel dans une globalisation chiffrée ferait perdre la mobilité aux divers autres potentiels qui seraient figés en une seule projection. Le conglomérat tyrannique ainsi créé s’approprierait toutes les richesses des autres forces qui seraient contraintes au refoulement.
Il est édifiant de chercher des applications diversifiées de cette fable et de sa formule. Cet exercice pourrait se présenter sous la forme, familière aux écoliers, des thèmes de dissertation :
“Imaginez une famille où les actions de tous seraient régies par les désirs d’un seul.”
“Construisez le plan d’une maison dans l’unique but d’y installer le plus grand nombre possible de gadgets électroniques.”
“Indiquez le concept prédominant qui doit apparaître dans l’organisation d’une ville.”
“Dessinez un vêtement qui puisse habiller uniformément toute une population.”
“Épurez le langage de toute influence étrangère.”
“Établissez
la liste des noms que devront porter les gens que vous fréquentez.”
“Citez les propagandes que vous prenez comme modèles.”
L’effet burlesque de ces formulations provient de la source qu’utilisent les caricatures : l’observation d’un objet couplée avec l’accentuation extrême de ses caractéristiques majeures.
Mais ce procédé, pour pouvoir se produire, doit trouver une matière à exploiter, l’on ne peut caricaturer qu’un trait déjà remarquable par son enflure dans le tableau général.
Comment se moquer de l’harmonie, autrement qu’en l’affublant de ce qui ne lui appartient pas, en collant des moustaches sur le visage de la Joconde ou en chargeant ses mains d’un trousseau de clefs ? Duchamp et Léger exprimaient par ces gestes iconoclastes et infantiles la douleur et la colère qu’ils éprouvaient au spectacle de la laideur physique et morale de leur temps.
Ce métaplasme sarcastique de la figure revendique son insolence. L’intention est assassine, mais de quoi ? Pour ridiculiser l’image, on aurait pu donner au paysage un caractère incongru, en y ajoutant un panneau publicitaire ou quelque structure utilitariste.
C’est à la figure humaine que s’en prend ici le vandale. Il montre le personnage rabaissé au niveau de la fonction domestique, la pauvresse humiliée dont le visage est barbouillé de noir, la beauté perdue, contrefaite et oblitérée par le masque du travesti.
La haine est la compensation juridique de l’amour contrarié. Le signifiant de cette inscription annonce donc que son auteur ne peut s’approprier ce que l’image possède. Sa frustration se décharge par la profanation de l’objet qui proclamait son infériorité.
Le fantasme fonctionne par identification, comme le rêve : tous les personnages y représentent le Moi. C’est donc à sa propre identité que s’en prend le profanateur. Il signe la motivation de tous ses actes, Duchamp défigure la forme de l’art avec le postiche du ready-made, Léger croit devoir limiter son sujet à la description des machines qui dominent la vie humaine.
Dans les deux cas, la frustration équivaut à la dégradation de l’humain par sa soumission à la production mécanique. Le jugement passé définit le désir de la beauté comme une illusion qui doit être abandonnée, la seule réalité accessible s’avérant être la performance matérielle mécanique.
L’examen descriptif des lieux dresse donc l’inventaire suivant : l’humanité s’est dotée de moyens qui lui permettent de dépasser ses performances naturelles, le missile frappe plus loin que la balle de fusil, que la flèche et que le poing.
A quoi sert le poing ? A estourbir une proie dont on se saisit aux fins de la manger pour assouvir sa faim. Le lion a des griffes et une formidable mâchoire. Depuis qu’il a dévoré son premier homme, il en est resté là. Tapi derrière un buisson, sous le vent pour ne pas se faire remarquer, l’homme se ronge les poings d’envie, décide incontinent de se fabriquer des missiles qui battent le lion au saut.
De ce désir va naître un monde.

Un idiot chevauchait, pieds nus,
l’aride brume de l’envie
et la raison savante s’effrayait
de la pente accusée
où, d’un geste dolent, il glissait sans y voir.
Sa tête creuse épousait les replis
du vent qu’il prenait pour la mer
et ses mains caressaient l’ombre vague et sereine
d’une chose aperçue,
ses yeux précipités et la bouche pétrie
d’un sourire oublié,
il montait lentement au long d’un précipice aigu
qu’un vertige aurait tué.
Tantôt il s’appuyait au sol
et tantôt replié sous un rai de lumière
il déroulait le fil d’une chanson éteinte
et son corps tout creusé s’envolait
d’une fumée qui danse
de ce monde terrible où il ne séjournait.
5.9.1972
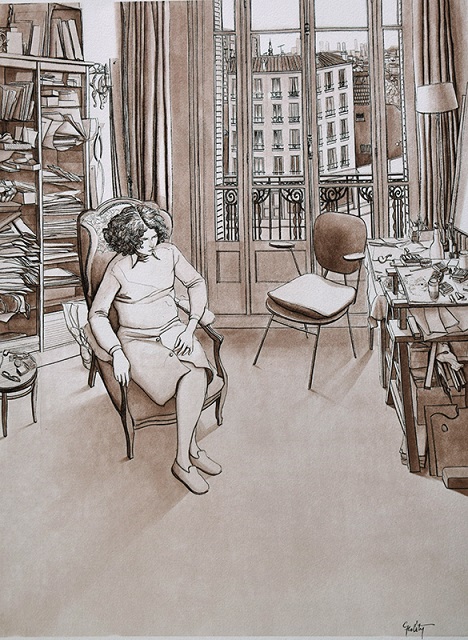
Comprendre
Pour comprendre, il faut isoler. En l’occurrence, « isoler », c’est percevoir une chose ou un fait dans son unicité pour former une image mentale bien définie. L’enjeu de cette opération est de placer cet élément de représentation dans un ensemble adéquat, afin de former un nouvel objet, plus complexe mais cohérent. L’utilité de l’exercice est d’augmenter la puissance d’agir grâce à ces outils subtils et variés.
Comprendre, c’est contenir en soi et d’abord saisir. Prehendere alicujus manum, c’est tenir la main de quelqu’un. Comprehendere, c’est unir, lier, embrasser dans une formule.
Pour l’animal, cette formule est un acte de mise en relation. L’animal comprend par apprentissage que telle expérience entraîne une conséquence dont il appréciera la valeur intrinsèque. Le désir ou la crainte s’ensuivront pour guider son comportement futur. L’humain possède aussi cette intelligence réflexe.
Mais cette mémoire instruite par l’expérience se combine chez l’humain avec celle des objets psychiques formés par l’histoire culturelle et personnelle. Pour l’humain, comprendre c’est former une synthèse sur des plans multiples, dans une tonalité intuitive, affective, esthétique, sentimentale, et intellectuelle.
Cependant, considérer le mode psychique de l’esprit peut susciter la confusion car l’acte de comprendre n’est pas tout entier contenu dans l’acte verbal de l’aptitude conceptuelle. Bien souvent, l’adéquation ressentie qui est le propre de comprendre ne peut être traduite en parole. Comprendre la peinture, la musique ou les mathématiques n’implique pas d’élaboration verbale. Ces langages-là sont l’expression de fonctions psychiques spécifiques, mettant en jeu des facultés physiques innées, visuelles, auditives et d’ordonnance théorique. Toutefois, la sensibilité de l’amateur n’est pas une puissance créative. La compréhension intuitive présente donc deux versants, si l’on peut dire, qui correspondent à la pratique de la contemplation et à celle de la création impliquant une connaissance et une aptitude techniques.
Si l’essence de la compréhension est d’unir des objets disparates dans un projet d’harmonie, l’exercice dépendra de la nature des objets auxquels le sujet peut avoir accès.
Le paysage culturel forme la base axiomatique de la performance. De même que l’animal « comprend » d’autant mieux la situation qu’il affronte quand il est familier des éléments qui la composent, l’humain ne peut espérer comprendre ce dont il n’a aucune expérience. Par exemple, la jeunesse n’est pas en mesure de comprendre les réactions dues à l’âge. Dans les rapports sociaux et politiques, il importe de tenir compte des expériences (voire des traumatismes) vécues historiquement par les protagonistes. A défaut de peser les motivations, l’on pourra se méprendre sur la qualité des comportements et sur leurs intentions. Ainsi préparée, la compréhension n’équivaut pas à l’approbation mais elle ouvre la voie à la résolution d’un conflit plutôt qu’au choc frontal.
Cette compréhension affective qui tire tant à conséquence est le fruit de la parole humaine. La vie psychique subsiste et croît par le langage. L’intuition peut capter les forces virtuelles en action mais pour les utiliser, il est essentiel de leur donner une existence, c’est à dire une forme et de les poser là – devant la conscience, figurées par leur nom.
Comprendre, c’est lier ce qui est saisi. Pour saisir, il faut qu’un corps use de tous ses sens. L’on n’apprend pas à faire du vélo par un exercice mental. Comprendre une situation, c’est la respirer, la toucher, éprouver sa durée dans les os, les muscles et le sang. Cette dimension sensorielle, déposée dans le verbe ou tout autre forme symbolique ouvre le champ de l’esthétique.
Pour que les forces vitales, c’est à dire le désir et la volonté, se décident à comprendre, il faut qu’elles aient intérêt à saisir. L’acte primordial est manger, toute existence a le souci d’acquérir, d’intégrer, de digérer ce qui lui est profitable. L’accord entre l’organisme et l’aliment est la condition nécessaire. La puissance d’agir qui en découle en est la démonstration. Il est patent que l’on fait mieux ce que l’on aime, que l’on agit en fonction de qui l’on aime et que l’on peut refuser de comprendre ce qui fait peur ou ce qui déplaît. Les petites incidentes qui émaillent si souvent le langage « n’est-ce pas, tu sais, comprenez-vous, si vous voulez, tu piges … » sont des appels à la bonne volonté de l’auditeur qui est prié de transcender son point de vue afin d’adopter le sens qui est donné aux mots par le locuteur.
C’est l’intérêt qui conditionne le sens et mobilise l’intellect. L’aptitude humaine à produire des outils psychiques lui permet un champ d’action qui se diversifie toujours plus et lui donne une puissance qui dépasse ses capacités physiques. Mais si l’humain fait correspondre ce pouvoir grandiose avec son seul intérêt particulier, il ne com-prend pas ce dont il est capable.
2005

Commentaires récents