XVI 16
Il s’ensuit que toute œuvre humaine qui prétend résumer son être à sa signification verbale est conceptuelle et a perdu l’esprit. Cette proposition qui paraît provocante est pourtant illustrée de façon persuasive par la vie aventureuse des mots. “Terrible” par exemple est l’adjectif issu du latin terrere, qui épouvante. Mais le sens conceptuel varie selon qu’il s’agit d’un roi, d’un enfant, d’un effort, d’un appétit ou d’un “type” terrible. Le mot se prête complaisamment à des associations aussi lointaines qu’implacable, turbulent, fatiguant, extraordinaire ou enthousiasmant. Autrement dit, le concept ne dit précisément rien qui ne soit affirmé au préalable par un être de chair et de sang.
L’attitude conceptuelle ne peut avoir souci de l’être. En prise sur la généralité, le concept est indifférent à la richesse paradoxale du vécu.
C’est pourtant au concept que nous demandons l’ancrage propre à la réflexion. Le flux de la perception est trop complexe pour être utilisable : sa richesse nous met dans la situation critique de “l’embarras du choix”. Il faut opérer un arrêt sur image dans le défilé constant des perceptions pour pouvoir mettre la main sur l’objet ou l’idée à prendre.
La représentation conceptuelle est le véhicule de la connaissance scientifique, cet effort incessant vers la raison de l’être. Le concept est le bras ouvrier du principe de Raison qui veut appréhender la loi, le temps et le lieu de ce qui se produit.
Mais si la Raison affirme par le moyen du concept, elle est à même de proclamer sa falsifiabilité, car la vie d’un concept et sa vérité dépendent de la situation qui a permis de l’engendrer. Or, ce contexte est une coupe artificielle, abstraite, réalisée pour la commodité technique au sein du mouvement éternel.
Si donc le concept est nécessaire à l’explicitation ontique du monde, il est inopérant pour son dévoilement ontologique pour la simple raison qu’il ne peut exister à ce niveau.
Ces deux mots sont des concepts récents qui décrivent une expérience aussi vieille que l’humanité.
Regardons d’abord en deçà de l’humain. L’animal, la créature vivante est un être-dans-le-monde qui perçoit, qui a des affects, une intelligence instinctive et une faculté d’adaptation à son environnement.
L’invention qui transcende cet état est le concept abstrait qui transforme la créature en un être-au-monde. La conscience n’est plus du monde, mais d’un moi qui est au monde.
L’animal a conscience de son attachement à sa territorialité, mais il n’a pas conscience de la territorialité. Il la vit, il ne la sait pas. Si l’on décrit la créature animale dans une perspective anthropomorphique, en lui adaptant la méthode conceptuelle humaine, on peut dire que sa situation est enviable, puisqu’elle vit pleinement sa vie, sage et calme, sans angoisse métaphysique.
C’est la faculté conceptuelle en effet qui crée la nécessité du souci de la métaphysique et qui suscite l’exercice de la théologie et de la philosophie. Pour les humains, le mot ontique décrit l’être concret de l’expérience. Il n’est pas besoin pour les animaux d’établir une telle notion car eux ne pratiquent pas l’ontologie. Ils n’ont pas à penser l’être en tant qu’être. Ils vivent absolument la complexité inter-relationnelle de leur présent.
Le territoire d’un hibou défunt est immédiatement investi par un jeune hibou en quête d’un domicile à prendre. S’il connaît approximativement la superficie nécessaire à son terrain de chasse, il ignore les frontières de celui-ci, bien qu’elles ne varient pas beaucoup d’une génération à l’autre. Ce sont les voisins qui lui font savoir nettement quand ses excursions le font sortir de ses bornes.
Il connaît intimement les repères de son monde.
Mais contrairement à nous, il ne connaît ni la négation, ni la généralité. La négation est conceptuelle, on ne la rencontre nulle part dans la nature. La généralité est la négation de la vie qui est uniquement, intensément particulière, là, maintenant.
Dans la pratique humaine, il s’opère un chassé-croisé entre l’ontique et l’ontologique : le champ concret de l’ontique en appelle à l’abstraction du concept, le plan spirituel et abstrait de l’ontologie en appelle à l’intégrité vitale du concret.
L’erreur du bon sens est de considérer concret le domaine matériel de la vie courante et intellectuel l’abstraction de la philosophie. Il ne se rend pas compte qu’il gère la matière par et grâce au concept qui est abstrait et général, tandis que les œuvres de l’esprit lui permettent d’éprouver le pur phénomène de sa vie.
La querelle des systèmes dualistes, par exemple celle de l’idéalisme et du matérialisme provient de ce malentendu : ils se situent aux pôles opposés d’une même analyse conceptuelle qui ne prend pas garde à la véritable nature de “l’humain”.
Observons à nouveau notre hibou : ses informations sensorielles agissent ensemble, l’ouïe avec la vue, pour former un plan de vol qui doit réussir, en s’appuyant sur le vent, à faire contact avec la forme décelée, minuscule, qui ne se trouve à un point de l’espace qu’un infime moment du temps.
Son acte coïncide absolument avec sa connaissance.
Mais on ne peut dire de lui que sa connaissance ait un “sens”, ni qu’il possède une perception signifiante de ses sensations. Nous sommes incapables de nous mettre à sa place : nous ne pouvons pas demeurer au stade éprouvé, chaud, vécu, de la sensation. Notre perception déborde du sensible.
Cette propension nous offre une puissance plus diverse et plus étendue que n’a le simple instinct. Mais c’est elle aussi qui, mal contrôlée, provoque en nous cet état de malaise qu’aujourd’hui on nomme le “stress”, qu’on pourrait nommer en français, dans une formule un peu trop assonante, “rétention de tension”.
Approchons nous de la fenêtre pour voir si le chat dort sur son coussin. Et puis pénétrons violemment dans la pièce en claquant la porte : instantanément, le chat est en alerte, toutes griffes et tous poils dehors. Une analyse clinique enregistrerait une poussée subite des taux d’adrénaline et de cortisone qui retomberaient à leur niveau normal dès que le chat, en nous reconnaissant, déciderait qu’il n’y a pas de danger.
Mais si c’est à nous qu’est infligée la même peur, notre réaction ne va pas finir avec l’arrêt de la sensation et l’évidence qu’il s’agissait d’une fausse alerte. Notre affectivité va rentrer en conférence avec notre imagination pour élaborer un drame conceptuel et cette rumination conservera la dépense chimique et entretiendra l’organisme dans un état de panique, nocif puisque ces munitions fabriquées pour un combat de survie effective sont accumulées sans être utilisées.
L’on voit bien dans ce cas comment le concept incite l’organisme à tourner à vide. Un conteur pourrait en faire le héros d’une de ces histoires de génies dont les services causent plus de malheur que de bonheur à leurs maîtres. Le concept est un géant qui exécute les ordres de façon littérale. Il est, comme on dit, fort et bête. Il ne comprend pas quand on lui dit de ne plus faire ce qui était son occupation présente. Il n’obéira qu’à un autre ordre précis, concret, sans souci de motivation ni de conséquence.
Il ne peut en être autrement puisque le concept est un outil. Ce n’est pas lui qui peut avoir la vision synoptique de la situation, ce n’est pas lui qui fait corps avec le réel.
Dans les contes modernes de science-fiction, le robot, qui est la nouvelle version du génie, est l’acteur principal de scénari-cauchemars où la puissance mécanique subvertit l’ordre de la sensibilité, à moins qu’il ne s’humanise en se montrant capable d’intuition, de fidélité, de cœur et d’amitié.
En effet quand on lui laisse libre jeu, le propre du concept est son intolérance. Il est autiste, paranoïaque et schizophrène, incapable d’échange, d’empathie ni de sympathie. Il est tel qu’en soi-même, claquemuré dans sa suffisance. Essayez, pour voir, de réconcilier deux concepts. Celui de droite ignore celui de gauche qui n’a même pas idée de son existence. Une argumentation entre deux humains menée à coups de concepts ressemble à un dialogue de sourds : chacun poursuit son idée fermement attachée à des rails divergents. Pour qu’ils se rencontrent, il faut l’intervention d’une autre puissance qui, comme un aiguillage, provoquera la disparition des deux systèmes pour en créer un autre. Il reste la matérialité des rails, mais avec une autre intention.
L’antagonisme des discussions de tout ordre qu’elles soient provient de ce que les adversaires s’attachent à la finalité logique de leur concepts. Celui qui dit que le verre est à demi vide n’aura jamais raison de celui qui affirme qu’il est à demi plein. On peut tirer des faits et des chiffres la démonstration d’une preuve et celle de son contraire.
Le concept de vérité aboutit à la constatation que la vérité n’est pas conceptuelle.


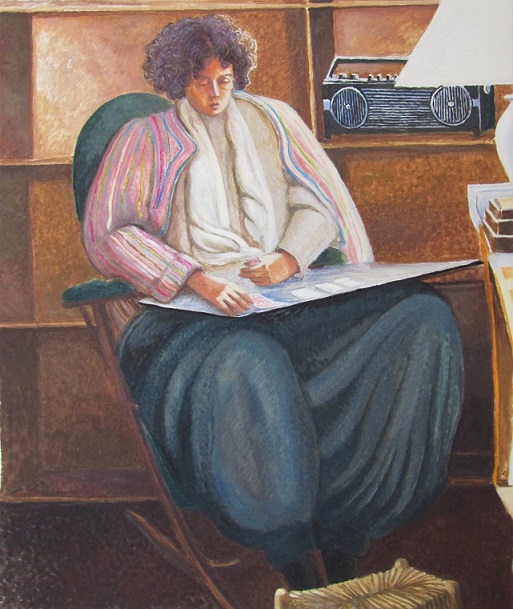
Commentaires récents