13
Il faut loger ici quelques remarques.
Toute histoire est un drame. Un conte est le rapport épique d’un conflit, la tension nécessaire à la résolution. Le bonheur et la vie tranquille ne sont pas souvent le thème des romans, car sans tomber dans le mauvais goût de l’ultra spectaculaire, il faut bien, pour que l’on puisse raconter une histoire, qu’il “se passe” quelque chose. Il fallait l’épisode du mouchoir pour construire le drame d’Othello. Sans mouchoir, pas de crise. Cependant, la crise est la résultante d’une tension préexistante. Elle est le cœur du drame, mais elle n’est pas le corps du sujet.
D’autre part, la même histoire peut être accommodée de mille façons. Shakespeare et les manchettes des journaux à sensation traitent des mêmes passions. L’angoisse nucléaire était la version de l’Apocalypse pour le milieu du XXe siècle. Depuis, nous en avons inventé d’autres.
Toutes ces remarques illustrent la difficulté de notre propos. Pour décrire l’état de santé d’un malade, il faut évoquer ses “crises”. Pour parler de l’art, il faut décrire ce qu’il n’est pas. A travers toutes ses crises, on en suit la quête, comme le fil d’Ariane. Il ne faut pas cependant confondre l’être et l’apparence, identifier le malade avec ses symptômes.
Mais qui serait un individu sans son costume ?
Si donc ce sont les attributs concrets de l’habit qui donne souvent l’identité judiciaire du corps, il ne faut pas perdre de de vue que le concept de costume n’a pas d’apparence.
Le précédent chapitre tentait de former une collection des costumes d’un mot. Ainsi, le dernier-né peut être dessiné: le concept d’art a vécu. La mode est à l’art du concept.
La technologie actuelle a su créer des tissus chimiquement composés, qui ne sont pas “naturels” comme l’étaient la laine ou le lin. Ces tissus “conceptuels” servent pourtant le but immémorial d’habiller l’être humain. Cependant, la forme des habits qui suit les mœurs et la mode est toujours conceptuelle.
C’est aujourd’hui que l’art officiel se réclame du concept. Mais le phénomène n’est pas nouveau, si bien que l’on peut tenter une formule qui vaut pour tous les temps :
C’est la part du concept dans une œuvre qui fixe son être historique.
Mais c’est la part qui n’appartient pas au concept qui fait l’être de l’art.
Il faut d’abord considérer les deux aspects de cette présence du concept dans la vie, que nous appellerons succinctement la matière et la manière.
Toute activité humaine procède de l’intuition. Elle s’allie au concept pour matérialiser un objet ou une action. Le concept est le père de la matière.
Il reste à traiter la manière de cette matière qui peut être dosée différemment de concept et d’intuition.
Encore faut-il intenter le procès de la représentation des mots : depuis le début du XIXe siècle, l’intuition est devenue synonyme de divination, qui fait saisir spontanément à la conscience ce qui n’est pas encore démontré. Cette réduction de sens correspond à l’usage préférentiel de l’association entre concept et intuition. Dans la mentalité scientifique qui prédomine de nos jours, le réel est ce qui peut être démontré, la démonstration a recours au concept, donc l’intuition ne serait qu’un palier du mouvement qui se parfait dans le concept.
Or, l’intuition ne peut se réduire à son commerce avec le concept.
Un exemple d’utilisation du mot dans son sens réducteur concerne la question des nombres premiers. Dans la recherche et l’identification des nombres premiers, la logique, dit-on, triomphe de l’intuition, qui ne peut parvenir au but de l’opération en devinant le résultat. C’est que l’on considère l’intuition comme un outil inférieur de l’intellect, alors qu’à l’inverse, c’est l’intellect qui est l’instrument de l’intuition pure.
La science psychologique a contribué à établir cette notion de l’intuition pratique en caractérisant une fonction psychique d’appréhension directe du réel par l’adjectif “intuitif”. Le langage courant et l’imagination s’approprient alors le mot en parlant d’une faculté raffinée de discernement, et de façon plus matérielle encore, d’avoir le pressentiment de quelque chose qui n’est pas encore arrivé.
Ces emplois légitimes mais vulgaires du mot masquent sa vérité. L’Intuition précède le stade matériel, elle est le fondement de toute appréhension concrète ou abstraite du monde, elle n’émane pas du sujet qui regarde le monde, elle est l’accès à cet entre-deux du sujet et du monde.
Dans une généalogie mythique, si le concept est le père de la matière, l’intuition est la mère du concept.
Quand elle s’unit au concept, comme les sirènes, elle doit changer de nature pour vivre sur terre, elle doit prendre les traits d’une faculté psychologique d’action utilitaire et affective. C’est le concept qui va délimiter le champ d’action, choisir le nom de la progéniture et leur mode d’éducation.
A l’aube de l’humanité, les bébés concepts ne s’occupaient que de la chasse. Quelques uns, bientôt, se spécialisèrent en prêtres des rites de la vie et de la mort. Ils chantaient la terre avec la voix de leur mère.
Et puis, de ces unités spécialisées naquirent des garçons et des filles concepts qui délaissèrent le champ de la mémoire vivante pour se vouer uniquement à l’institution de rapports de force et de systèmes de pouvoir. Ils avaient les moyens de la matière sensible, elle opéra leur séduction en les persuadant qu’elle seule était réelle. Ainsi se conçut le sujet qui se mit à tuer pour l’objet, et par contrecoup, la diplomatie.
Au cours des temps, l’arrangement conceptuel des différentes civilisations varie, c’est toujours la représentation dominante qui organise les armées, commande l’industrie, décrète les règles de l’art.
De nos jours, le bouffon officiel de la princesse Réalité Bancaire, qui régit le monde entier de son pouvoir absolutiste, est un art qui se réfère avant tout de la cotation boursière. Son appellation de “conceptuel” correspond seulement à la teneur majoritaire du terrain mental contemporain.
Nous vivons en effet dans un paysage de structure conceptuelle prédominante. Nous évoluons dans un monde où les repères poussent de façon aussi imperceptible que nos cheveux. Aussi sommes-nous aveuglés par l’effet de la familiarité.
Mais que ferait un pèlerin roman de nos feux rouges, de nos sens giratoires et des bretelles d’autoroute qui défient les lois naturelles du temps et de l’espace ? Il s’orienterait d’après la lumière du soleil qui lui indique l’heure, la topographie des lieux et l’orientation des points cardinaux. Il saurait mieux que nous se guider sur une terre inconnue, mais il serait incapable de suivre les repères conceptuels qui le téléguident sur une piste étroite et exclusive.
Il n’aurait pas la maîtrise de nos concepts matérialistes, mais il aurait le réflexe, par exemple, de dessiner sur son visage le signe de la croix en passant devant un calvaire au carrefour. Il marchait sur une terre d’apparence encore assez “naturelle”, mais il portait dans toutes les fibres de son être un monde conceptuel d’obédience religieuse.
Et ces concepts-là pouvaient pervertir aussi bien que les nôtres.
Pensez à la situation du peintre Enguerrand Quarton devant le contrat que lui envoie Dom Jean de Montignac concernant la réalisation d’un tableau d’autel pour l’église de la chartreuse de Villeneuve-lès-Avignon, daté du 25 Avril 1453. “Il y aura l’image du Paradis et dans ce Paradis on verra la Sainte Trinité, et il n’y aura pas de différence entre le Père et le Fils ; le Saint-Esprit sera en forme de colombe et Notre-Dame représentée de face, comme il siéra à Maître Enguerrand ; la Sainte Trinité posera la couronne sur le chef de Notre-Dame.”
“D’un côté de Notre-Dame se tiendra l’ange Gabriel et, de l’autre côté saint Michel. A droite, il y aura saint Pierre et saint Paul ainsi que d’autres apôtres; de l’autre côté saint Jean-Baptiste avec d’autres patriarches et des prophètes. (Suivent les noms des saints à représenter.)”
“Du côté du couchant, il y aura l’église de Saint-Pierre de Rome, une partie des murs de Rome, le château Saint-Ange et un pont sur le Tibre ; dans la dite ville, l’église de la Sainte-Croix où saint Grégoire célébrait la messe. A l’extérieur de Rome, on verra le Tibre se jeter dans la mer. De l’autre côté, il y aura une partie de Jérusalem : d’abord le mont des Oliviers où se dressera la croix de Notre-Seigneur au pied de laquelle il y aura un chartreux en prière. Et, sur le côté droit, l’église ou se trouve la tombe de Notre-Dame.”
“Sur la deuxième montagne, on verra Moïse et son troupeau et Notre-Seigneur sous forme d’un feu au milieu des buissons.”
“Dans la partie droite, il y aura le Purgatoire où les anges conduisent ceux qui se réjouissent en pensant qu’ils iront au Paradis. Sur le côté gauche, il y aura l’Enfer. Dans le Purgatoire et l’Enfer se trouveront toutes les classes comme il siéra à Maître Enguerrand.”
“Le dit Maître Enguerrand déploiera toutes ses connaissances et tout son talent dans la peinture de la Sainte-Trinité et de la bienheureuse Vierge Marie et sera guidé par sa conscience.”
Ce texte et son image forment une vue synoptique de l’époque, en exposant tous les critères dogmatiques des hiérarchies théologique et sociale et dessinent une architecture téléologique caractérisée. La terre en bas, où l’on ne voit que des bâtiments d’église et des morts en instance de jugement, le ciel en haut peuplé de saints qui, tels des courtisans, tendent leurs mains et lèvent leurs yeux adulateurs vers le trône de nuages où siège la Trinité.
L’esthétique use des rouges, des bleus, des ors, couleurs privilèges de la symbolique somptuaire.
L’image est construite par et sur un concept auquel le peintre a soumis son art. Pourtant, à y regarder de plus près, l’on peut découvrir des signes de rébellion. A la base du tableau, occupant une tranche mince sous la croûte terrestre apparaît un grouillement de démons et d’humains. Mais ces lieux épineux sont deux états bien différenciés : de l’un s’échappe un pape nu qu’un ange attire par les mains, de l’autre, un fugitif se fait saisir aux pieds par les pinces d’un diable cuirassé.
Or, en contradiction flagrante avec ses injonctions, Maître Quarton a placé l’Enfer à dextre et le Purgatoire à senestre de son image, inversant ainsi l’interprétation des auspices où la gauche est défavorable. Le deuxième indice est bien sinistre quoiqu’à peine perceptible : dans les soucoupes de nuages blancs où sont assis le Père et le Fils apparaissent de gros points bleus, tassés dans la bande étroite qui n’est pas recouverte par la pourpre de leurs manteaux. Ce sont des têtes humaines qui font penser, quand on les remarque, à ces suppliciés que l’on enterrait jusqu’au cou. Enfin, formant hémicycle autour des trois personnages et de la colombe est une zone indécise couleur de feu avec des étincelles dorées. L’on peut y deviner la représentation de silhouettes d’anges avec leur auréole, mais le détail perturbant est la configuration de leurs ailes qui, repliées au dessus de leurs têtes, forment une série de cônes pointus surmontés de cornes effilées. On dirait que le feu de l’enfer avec ses flammes crépitantes a tout dévoré, jusqu’aux régions célestes.
Une vingtaine d’années plus tôt, vers 1435, Fra Angelico peint sur bois la scène du Couronnement de la Vierge. La matière conceptuelle est identique : une image est construite par symétrie de plusieurs groupes entourant une scène principale dont les acteurs accomplissent le même geste.
Mais si le concept préside à l’existence matérielle de l’image, il n’intervient pas ici dans sa composition structurelle.
Les couleurs ne délimitent pas des entités isolées, elles forment contrepoint, tant par leur tonalité que par leur disposition. Chacune des marches qui construisent l’ascension à l’espace du couronnement est une frise variée dont le dessin léger fait vibrer les mêmes verts, les bleus, les roses et les ocres dorés des vêtements des saints et de leurs auréoles. La partie supérieure du panneau carré, surélevé au centre pour accommoder deux triangles de ciel autour du toit sculpté d’un dais, résonne d’une fanfare céleste : les longues trompettes des anges dessinent un rayonnement qu’accompagnent les regards des saints, chaque visage centré sur son intériorité.
Si donc l’on peut reconnaître dans les deux images un même thème religieux, identifier une esthétique d’époque, l’effet phénoménal des deux œuvres est incomparable.
L’une illustre des concepts, l’autre opère un saut dans l’inexprimable. Pour la première, il suffit de décrire les objets de la représentation et d’établir le commentaire théorique de leur signification symbolique pour parvenir au “sens” ultime de l’image. Pour l’autre, la description et le commentaire sont bons à signaler l’existence matérielle de l’œuvre ; son sens réside en la contemplation même de son corps matériel. L’une s’achève en l’idéalisation du concept, l’autre ouvre l’accès à l’intuition.
Qu’en est-il, pour l’œuvre de Maître Quarton, des signes cachés de rébellion contre le dogme qui impose son thème à l’artiste ? Ils sont eux aussi exprimables par des concepts verbaux : l’inversion signifiante des régions du bien et du mal met en doute le bénéfice pour l’esprit humain de l’institution ecclésiastique. Le tapis parsemé de têtes évoque le pouvoir de vie et de mort des tyrans sur leurs esclaves et la liberté bafouée, l’hypocrisie des puissants dénoncée par l’apparence équivoque de la garde des chérubins.
Il serait tout à fait erroné d’en conclure tout simplement que Maître Quarton était un mécréant tandis que Fra Angelico, moine sincère et pieux, avait la foi.

XIII
Hors le poète qui dansait
sur son destin folâtre
fulminant d’arquebuses saillies
et dragonnant les mots
cuirassés d’habitude vilainie
mais lui, tout caparaçonné
de vagabonde forfanterie
fidèlement fleurissait sa muse
de ces pleurs
qu’en chemin d’aventure incessamment
lui causaient
les radins propos de ces babilleurs de fortune
-lèvres grinçant gercées à force de sottise
oreilles longues d’un pied, si tant battues
par le vent, toute l’année,
de l’aveugle mensonge…
mais trêve, mon voisin,
vous n’écoutez pas la musique.
10.4.1975

Image – Imagination
Ce vocable dit la quintessence du psychisme humain. Il énonce la capacité de l’esprit à vivre des actes virtuels.
Faire une image est l’acte humain par excellence. Le langage en est l’indice et l’outil. Si l’agir caractérise l’existence de toute créature, la faculté de produire l’image réflexive est l’apanage de l’humain. Ago, je fais, je suis et je mets en mouvement. I(n)m-ago, je considère cet acte en situation, imago, je construis une figure de l’acte. L’imago, pour Cicéron, est alicujus picta, le portrait de quelqu’un et d’abord de l’ancêtre, l’image en cire portée aux funérailles. Cette imitation de l’apparence n’est plus matérielle quand le mot signifie fantôme, songe, spectre ou écho, gloria virtuti resonat tamquam imago, la gloire est comme l’écho de la vertu. Le mot devient la référence d’une comparaison, une évocation par la pensée de choses, de personnes ou de concepts : modestiae imagine, sous le masque de la modestie, ou tristium laetorumque, l’évocation de choses tristes et agréables.
L’objet que produit l’imagination, abstrait ou concret, évoque l’apparence du réel. C’est la concrétisation d’un vécu. Cet événement psychique est spécifique à l’humain dont la capacité neuronale s’est déliée de la seule fonction motrice. Mais ce pouvoir de projeter l’acte dans un système abstrait engendre la confusion au niveau de la description des faits. La notion « d’image mentale » est une rétro-projection de l’aptitude à produire une image concrète. Comme l’affirme Jean Paul Sartre dans L’imagination : « Il n’y a pas, il ne saurait y avoir d’images dans la conscience. Mais l’imagination est un certain type de conscience. L’image est un acte et non une chose. L’image est conscience de quelque chose. »
Faire acte d’imagination, c’est utiliser le cerveau humain dans sa fonction originale. C’est poser le corps en situation virtuelle. C’est provoquer la réaction du système entier dans une situation qui intéresse le psychisme. Les créations de l’imaginaire sont donc conditionnées par l’intention de l’acte. La liberté détermine l’imagination.
« Avoir de l’imagination » est le cliché d’une notion réductrice qui se détourne du sens de l’acte pour ne considérer que l’apparition du matériel utilisé. Pourtant, le plus souvent, l’imagination ne fonctionne pas avec des images, ni visuelles ni verbales.
L’imagination est une activité qui produit une synthèse des aptitudes psychiques et physiques. Comme il est évident chez le jeune animal, l’organisme exerce spontanément ses puissances et cherche à connaître ce qui l’entoure. L’imagination est le jeu des pouvoirs psychiques de l’humain, dont l’esprit, par sa préhension métaphysique, évolue dans une dimension qui n’est pas celle de son corps.
Dans ce jeu, la réceptivité, la sensibilité de l’observation, la précision analytique de la vision, la juste appréciation des rapports prédominent sur la fabrication d’un assemblage d’éléments disponibles. Avoir de l’imagination, c’est plutôt se détacher des concrétions conceptuelles répertoriées afin de réussir à capter les potentialités qui forment alors de nouvelles figures, uniques et authentiques.
L’imagination peut dévoyer sa fonction comme un organe physique et gangrener l’organisme. Car si l’imagination s’avère être la faculté de rendre visible une entité psychique, elle est issue d’un corps substantiel qui se dispose à agir selon la forme des images virtuelles que le cerveau convoque. Les fantasme crées par l’activité psychique humaine seront en phase avec le projet de l’individu, en fonction de l’équilibre qu’il entretient entre ses diverses puissances.
Les influences extérieures, celle de la culture et du milieu existentiels, les tendances dues à la structure individuelle soumise aux aléas de l’expérience, toutes ces données sont la flore et la faune d’un jardin que l’on cultive en composant avec les caractères du terroir et des conditions climatiques. Les composantes psychiques, l’intuition, l’intellect, la sensation, le sentiment sont les produits cultivés qui tous exigent un nutriment.
L’imagination est l’exercice responsable du développement harmonieux de tout l’être, corps et âme.
2006
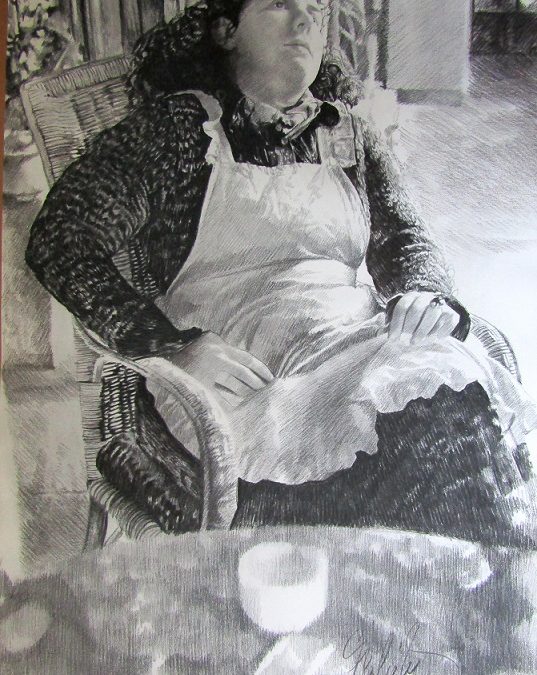
Commentaires récents