§2 De la nature cosmique de la diffusion
L’analyse reprend ici son fil conducteur qui est l’examen de l’origine. Mais pour mener à bien cette quête, il faut d’abord éclairer la notion même d’origine. La raison pratique la considère le plus souvent dans ses dimensions spatiales et temporelles en la situant dans des expressions telles que l’origine d’un conflit ou celle d’une ligne d’autobus. La plate-forme commune est la notion de commencement ou de point de départ. Le sens premier est celui du mot latin oriri qui note la naissance ou l’apparition du soleil. L’on perçoit bien le caractère conceptuel tout relatif du langage quand l’on observe que si l’orient est bien le côté de l’horizon où l’astre du jour se lève, tous les points du diamètre terrestre mériteraient ce nom aux yeux d’un vivant qui en suivrait la ligne. Quant à la naissance du soleil, elle n’a d’existence que dans l’esprit de ce producteur de concepts égocentrique puisque c’est lui qui apparaît dans sa pirouette cosmique aux rayons du soleil.
Le langage humain est donc habile à signifier la conscience en nommant tous les états du monde mais l’esprit humain a tendance à borner son pouvoir à cette performance matérialiste en faisant toujours primer les facteurs existentiels dans sa représentation.
Or, l’origine est un processus éternel. L’origine est l’éternel retour du même. L’origine est un perpétuel commencement. Ces traductions maladroites d’une intuition fondamentale démontrent l’indigence du langage humain à transcender les puissances du physisprit. Car, en l’occurrence du phénomène humain, son origine est aussi son projet. La vocation humaine consiste à dépasser les limites spatio-temporelles qui caractérisent l’enracinement existentiel de son organisme.
Atteindre cet objectif, c’est participer à la dynamique universelle en accordant la volonté humaine au mouvement des choses, à l’autre, au tout.
Malheureusement pour le repos de l’esprit, “atteindre l’objectif” est encore une image concrète qui évoque un voyage et son but, bien localisé. L’aventure humaine n’est pourtant pas destinée à son seul corps qui n’en est que le véhicule, indispensable mais qui ne contient pas l’intention du trajet qu’il permet.
Recouvrer l’origine, c’est donc agir dans la conscience de l’unité multidimensionnelle. C’est permettre à l’esprit de s’ouvrir à l’intuition pour ne pas s’affoler devant la diversité des apparences. Comprendre l’origine, c’est présenter chaque segment d’existence à l’épreuve d’une intelligence absolue, qui n’est, bien sûr, pas incarnée dans l’individu mais demeure son aspiration, jamais désavouée.
En ce qui concerne le thème ici traité, le souci de l’origine permet de voir que la diffusion de l’information est la formulation technologique (précieuse et sophistiquée) d’une réalité universelle : le tissu vivant des relations entre tous les étants individualisés, qu’ils soient matériels, biologiques ou spirituels.
La diffusion, c’est la transformation de la flore et de la faune due aux changements climatiques résultant d’influences astrales. C’est la transmission des attributs génétiques, c’est l’information animale et florale que charrie le vent, c’est le parfum d’une fleur qui se répand tout alentour. La diffusion, c’est aussi l’entraînement de l’exemple, des mœurs, du fou rire, du bâillement.
Entendre la diffusion dans son acceptation première, c’est permettre à la conscience humaine de recouvrer son intégrité. En effet par le sortilège de la nouveauté, tel un éclair qui aveugle, le sens moderne nous accapare et tend à faire admettre une souveraineté. Cette usurpation nous rend infirmes et peut nous désespérer.
§3 Du style conceptuel de la diffusion
La deuxième conclusion de la fin du §1 s’interrogeait sur les causes de cette dérive matérialiste du sens de la diffusion. Pour élucider ce phénomène, construisons une fable en utilisant le procédé de La Fontaine qui figure la gent animale singeant le comportement des humains.
Il faut évidemment faire un grand écart d’imagination puisque l’histoire va doter les oiseaux de la technicité. Las de migrer par ces longs vols épuisants et tout aussi hasardeux, d’ingénieux volatiles s’avisèrent de créer une compagnie avicole qui institua des transports collectifs à destination des sites concernés. L’on réduisit le nombre des points d’atterrissage en les choisissant pour des raisons pratiques de rentabilité économique. Un calendrier des vols fut établi sur la moyenne statistique annuelle des conditions favorables à la migration. Pour éviter les cohues aux points d’embarquement, il fut alloué des tickets dont la distribution était établie sur un système de répartition qui comptabilisait la quantité de progéniture de l’année précédente. Pour satisfaire aux besoins de ces groupes importants de voyageurs, on organisa aux alentours des ports de débarquement des campements approvisionnés qui devenaient en général des villégiatures saisonnières, car les oiseaux déboussolés par le brutal changement horaire n’aspiraient plus qu’a être gavés automatiquement et sur place.
Mais bientôt, de graves incidents compromettaient la situation. Outre des pertes considérables occasionnées par les variations accidentelles et désastreuses du climat dans les pays du départ ou ceux de l’arrivée, l’on constata des troubles de la gestation, de la nidation et du comportement général de toutes les espèces. De plus, des plaintes furent enregistrées qui provenaient des lieux de passage auparavant fréquentés. Un audit général permit de conclure qu’on s’était leurré sur la finalité de l’entreprise. La migration n’est pas seulement le changement d’un site ponctuel à un autre, c’est le processus tout entier qui s’accomplit par ce moyen. La valeur du voyage n’est pas sa destination, c’est l’aventure détaillée qu’il élabore.
Comme il est plus facile d’avoir l’esprit critique pour les autres que pour soi-même, continuons à dénoncer les agissements systématiques de ces fabuleux oiseaux.
En profitant d’un mode mécanique de transport, ils avaient aussi modifié les contingences du voyage. La machine semblait faciliter la réalisation du projet : ils se déplaçaient plus vite et plus aisément qu’auparavant. Mais cette efficacité se trouvait acquise aux dépends d’autres facteurs, alors éliminés de l’opération. La morale de l’histoire annonçait que cette réussite était un échec : à quoi bon migrer si l’on a omis de donner l’opportunité aux nouvelles générations d’apprendre à migrer ? Tout l’enseignement que l’on pouvait acquérir dans ce voyage au long cours serait inaccessible, à moins d’organiser des cours théoriques, mais qui ne vaudraient pas la pratique et l’expérience. Outre ce déficit qui venait grever le destin des oiseaux eux-mêmes, l’opération provoquait la ruine des rapports qui s’établissaient auparavant sur leur passage. La vie de la flore et de la faune qui profitait ou subissait naguère leurs escales s’en trouvait profondément déséquilibrée. Un dossier synoptique fournissait une analyse qui permettait une synthèse réaliste : une migration consistait-elle simplement à changer de place, ou le fait de changer de place permettait-il tout un ensemble d’événements qui n’auraient pas eu lieu sans lui ? Fallait-il favoriser ces phénomènes, de nature aussi diverse qu’ils soient, ou bien convenait-il de se féliciter de les avoir supprimés ?
Parvenus à ce point de l’histoire, il faut quitter la fable pour élaborer une morale à nos fins. Car s’il est plaisant de costumer les animaux de nos défroques, c’est parce que nous savons bien qu’ils n’en ont pas l’usage. C’est le caractère incongru du procédé qui nous fait rire. Ce qui leur fait défaut pour nous ressembler, c’est la capacité de former des concepts. Cette fable est une histoire impossible parce que les animaux ne sont pas capables d’isoler une image mentale, de donner un sens abstrait à cette image, de construire un comportement à partir d’un mot qui a pris valeur d’image, de fonder l’acte sur le mot. La migration pour eux n’est pas un concept, c’est une harmonie vécue entre la vie de leur corps, le devenir de leur espèce et celle des étants du monde où ils évoluent.. C’est un tout dont ils n’isolent aucune partie, car l’instinct est Un en eux.
La diffusion est donc, à proprement parler, l’interaction universelle des particules et des organismes individualisés. Mais l’esprit humain dont le mode opérationnel utilise les images abstraites est éternellement confondu par son propre pouvoir. Quand il se choisit une tâche, il fait porter toute son énergie créative sur la matérialité des moyens. Il est tellement préoccupé par l’aspect technique de l’opération, il est tellement fier de son ingéniosité qu’il en oubli de considérer le rôle de sa créature. Il est comme un auteur qui, pour composer une pièce, assemblerait fortuitement des bribes de monologue, des dialogues et des discours parfaitement hétérogènes. Un spectateur qui verrait l’ensemble sans être averti du procédé chercherait à lier ces matériaux hétéroclites et s’ingénierait à supputer une intention discernable dans ce monstrueux chaos.
§4 Effets déformants de la diffusion conceptualisée
Ce spectateur y parviendrait dans une certaine mesure car toutes choses sont liées sur la terre et dans le ciel. C’est à la fois le mérite et la naïveté de ce procédé littéraire qu’est l’écriture automatique de prétendre révéler le sens caché que n’atteint pas le discours construit par la logique d’un conscient utilitaire. Née de l’aspiration toujours vivace au pouvoir de la divination, l’écriture automatique est une version moderne des oracles de la Pythie. Mais dans les deux cas, l’interprétation des signes est une élaboration conceptuelle. Quelque soit le moyen, la boule de cristal, les tests psychologiques, les entrailles des victimes ou le vol des oiseaux, la divination tend à révéler l’unité de l’être.
C’est bien l’aspiration qui la détermine mais elle ignore la vérité qu’elle pressent car sa pratique est basée sur la multiplicité de la matière.
Le paradoxe est un phénomène humain : l’instinct vit la diffusion par et dans l’acte vital ; l’esprit humain ne peut atteindre la vision de l’unité que dans la contemplation car l’acte incité par l’intelligence conceptuelle la disloque. Quand les chiens se mettent à hurler dans l’instant qui précède une explosion, quand les arbres modifient leurs émissions chimiques pour se protéger d’un danger qui ne les a pas encore atteints, ils prouvent l’harmonie en action qui régit tous les étants du monde. Ils vivent un niveau de sensibilité matérielle dont l’existence nous étonne (et nous contrarie) tant que nous ne l’avons pas justifiée par une formulation conceptuelle, qu’elle soit magique ou scientifique.
L’avènement de l’image abstraite dans le mode humain de
de fonctionnement élargit le champ de vision mais tend à exclure tous les points du champ qui ne sont pas apparents dans l’instant. Nous nous conduisons souvent comme un cuisinier qui pose une casserole de lait sur le feu et se concentre trop longtemps sur une autre tâche délicate. On dira de lui qu’il “n’est pas à ce qu’il fait”.
La liberté qui est l’apanage de l’humain, c’est à dire la nécessité où nous sommes d’avoir à déterminer la finalité de nos actes, est souvent occultée par la fascination pour l’acte lui-même. Ses composantes matérielles provoquent un entraînement compulsif dont l’effet peut contrarier l’intention. Par exemple, l’intolérance qui recourt à la violence est issue d’un système idéologique qui devrait l’exclure, l’inquisition religieuse en est un cas, les dictatures qui se réclament d’un idéal politique en sont une autre version. Dans toutes ses convulsions historiques, l’esprit humain s’attache à la lettre de son programme, en fixant son attention sur le concept explicite : le dogme pour le fanatique religieux, l’égalitarisme pour le révolutionnaire, le profit pour le gestionnaire etc. … Les moyens ne sont considérés qu’en fonction de cet unique aperçu si bien que l’on s’empêche de voir que les conséquences atteignent des résultats contraires au but souhaité, l’insulte à la foi, la haine sociale, la ruine collective.
Ce mouvement fatidique d’inversion est toujours le fruit des représentations soliconceptuelles des humains, qui peuvent mettre à mal les découvertes les plus précieuses. Quand un poète philosophe forge un nouveau concept au potentiel d’universalité, cet instrument d’utilité publique court cependant le risque d’être employé de manière confuse. Actuellement, par exemple, la représentation se débat dans une dispute débilitante à propos du “renversement des valeurs”. Sans doute, la faute incombe-t-elle en partie au traducteur qui emploie le verbe renverser sans préciser s’il s’agit du renversement de la soupière, d’un bateau, d’un mur, d’un trône ou d’un obstacle. Dans tous les cas, le sens de l’expression est basé sur la vertu matérielle de l’objet. Mais pour un parapluie, il n’y a plus de connotation négative puisque, renversé, il devient canne.
Quand il s’agit des valeurs, qui sont des concepts, le renversement matérialiste incite tout bonnement à la désignation de leurs contraires, définis verbalement. Que serait le contraire d’une valeur ? Ainsi, les terminologies s’affrontent-elles en des joutes irréelles qui ne se soucient ni de la subtilité des conduites ni de la complexité des situations. Un mot, un concept, une valeur ne sont pas des objets dont les propriétés sont isolables et identifiables. On peut être patriote sans être chauvin, on peut défendre son bien tout en restant accueillant, on a pu, sans doute, être allemand au début du XXe siècle et national-socialiste sans être ni “nazi” ni raciste.
L’illusionnisme de la représentation conceptuelle nous est cher parce qu’il nous permet d’opérer des classifications et des systématisations dont le charme est, à nos yeux, qu’elles simplifient la complexité de notre situation et nous épargnent une vigilance onéreuse. Nous préférons nous fier à la technique et compter pour notre salut sur une solution matérielle. Dans un espace envahi par un gaz délétère, il vaut mieux, en effet, disposer d’un masque protecteur. Mais la diffusion des idées obéit à d’autres lois. Nous pourrions bien mourir de peur si l’on nous surprend avec l’image d’un lion rugissant, mais cette projection fantasmatique ne nous dévorera pas.
Devant ce paradoxe de l’humain qui aspire à l’harmonie mais ne parvient à vivre la diffusion qu’en la rabattant sur un détail concret de son vécu qu’elle érige en absolu, contrevenant ainsi par ses actes à son projet le plus cher, la nécessité s’impose d’en examiner de plus près le mécanisme.

Lexique
Psychique
Le mot psychisme pourrait nommer la fonction cérébrale qui opère la polarisation de la conscience et produit l’humain. L’activité cérébrale des animaux se déploie dans une utilité purement physique. L’évolution instaure un système plus complexe qui délie le couplage avec le réseau moteur et offre à l’espèce humaine un intérêt différencié, à la fois physique et mental.
Paradoxalement, le plus difficile pour l’esprit est de prendre acte de cette spécificité. Il semble que pour l’humain, percevoir sa nature revient à contempler son propre dos. On peut suivre cet effort dans l’évolution sémantique du mot. Il y a 2400 ans, Xénophon, dans les Mémoires de Socrate, décrit bien l’homme tout entier avec les deux termes de psyche et de soma. Mais alors psyche signifie l’âme, le souffle, comme principe de vie. Le mot peut désigner une personne vivante, son caractère et son génie. Hésiode l’emploie pour évoquer la nature des animaux, Isocrate quand il parle d’apprivoiser celle des bêtes sauvages. Pour les humains, Sophocle ou Platon signifient l’âme comme intelligence, Xénophon ou Eschyle le siège des désirs, l’appétit matériel, c’est à dire l’estomac. Dans l’Iliade, c’est l’ombre, l’âme d’un mort.
Psyche personnifiée a des ailes, comme Eros qui la tourmente, peut-on lire chez le poète Nicandre. Pour Platon, la psyché apparaît comme sortant d’une chrysalide et l’âme ne pouvant s’épanouir qu’en échappant à la geôle corporelle. Chez Dante, Psyche est devenue le « papillon angélique », le symbole de l’immortalité.
Cet amalgame du physiologique et du cérébral se retrouve autour de la racine men que la langue latine choisit pour dire, avec Lucrèce, mens animi, la faculté intellectuelle de l’esprit. Cependant, pour les grecs, menos est l’âme comme principe de la force physique, de la vigueur des humains, des animaux, des forces de la nature. C’est l’âme comme source des passions, comme courage et ardeur. C’est l’âme comme principe de volonté.
Pour l’intellectualité, on peut trouver trace de l’étymologie grecque dans le noerus, intelligent, de Tertullien et puis la famille du mot disparaît pour n’être utilisée en français qu’à la fin du XIXe siècle, dans le vocabulaire philosophique de la phénoménologie. Pourtant, noema est la source de la pensée, la réflexion, la méditation, le moyen du sens, de la prudence et de la sagesse. L’usage actuel de cette racine est purement philosophique : « noétiquement » signifiant chez Sartre « par la pensée ».
Le mot « psychique », défini par opposition au physiologique et à l’organique est pourtant récupéré au XIXe, employé au sens de principe vital puisque l’on emploie l’expression de « psychisme animal » pour décrire la composante affective du comportement, la psychologie de tout organisme vivant.
Il semble donc que l’humain peine à nommer sa différence. Au cours des siècles précédents, la représentation occidentale façonnée par la doxa religieuse inféodait le corps à l’âme en dotant celle-ci d’une origine divine, comme étrangère à la vie. Il fallait dompter par la grâce du Créateur la part physique, animale, de l’humain. Bien que des poètes comme Saint François d’Assise accordent la possession d’une âme aux animaux, l’imaginaire figurait le Mal sous les traits de ces créatures inférieures qui semblaient terrifiantes, dégoûtantes et enclines à toutes les violences. Avec la lente pénétration des idées d’évolution et de laïcité combinée avec une foi scientifique, la représentation s’est inversée. Comme l’on a justement observé l’intelligence animale qui consiste, selon l’étymologie du mot, à percevoir par les sens et à relier ces perceptions pour déterminer un acte et parfaire un comportement, l’on a logiquement déduit que l’humain est un animal comme les autres.
Un nouveau progrès de lucidité exigerait la cohérence et connaîtrait l’arbre au fruit qu’il porte. Chez l’animal, l’acte utile « extravertit » la conscience. Le sujet animal voit l’objet dans la relation qu’il peut avoir avec sa propre existence. La conscience humaine découvre qu’elle peut fonctionner « à vide », sans intérêt physique. Le sujet « introvertit » la conscience de l’objet pour le faire évoluer sans les immédiates conséquences matérielles que l’acte physique engendre.
Le premier acte typiquement humain consiste à former trace de cette aptitude à vivre un intérêt qui n’est pas uniquement physique. La main qui se teint de couleur et imprime sa forme sur le roc est l’exercice de cette nouvelle fonction cérébrale. Aucun animal n’a eu besoin de dessiner la perception de ses sens physiques.
Le mouvement de conscience réflexive est le fondement de l’Art. Le poète crée un univers dont le destin n’appartient qu’à ce pouvoir mental dont il dispose. La beauté du monde où l’animal évolue ne concerne que l’humain. Mais cette faculté d’admirer la relation harmonique des choses entre elles est le fait d’un corps qui a toujours la tâche d’assurer son existence. Alors, ce pouvoir de contemplation, l’humain va l’exercer au profit des besoins qui nourrissent la vie. L’évolution qui a développé cette fonction psychique a privé cet organisme des défenses physiques dont disposent les animaux. L’humain capable d’observer la qualité des corps matériels qui l’entourent conçoit de l’utiliser : la technique, fille de l’art, est née. Le langage signalétique des animaux se double d’un ensemble toujours croissant de symboles qui visent à préciser le pouvoir technique et à fixer la mémoire de cette production. Le langage conceptuel humain se structure en un corps virtuel capable d’explorer l’univers matériel.
Et c’est là toute l’ambiguïté de la nature humaine. Tandis que l’organisme animal est une parcelle de matière déterminée par le mouvement global, l’humain se définit par une capacité à prendre part à ce mouvement, non plus seulement en tant qu’objet agi mais en tant que sujet agissant. Tout acte d’un humain démontre cette bipolarisation de ses fonctions cérébrales, en alerte vis à vis des perceptions sensorielles et des informations de ce réseau abstrait que construisent les forces psychiques.
Cette puissance d’agir, nouvelle pour un organisme individué, participe plus directement de la puissance créative de la matière qui assemble et désassemble. Elle se situe, si l’on peut user d’une métaphore spatiale, dans la zone qui précède l’apparition de la substance, celle du possible inqualifiable.
Ainsi pour l’humain s’instaure un état de déséquilibre chronique, car les forces matérielles qui concrétisent le possible agissent pour et par la globalité tandis que le pouvoir psychique humain est localisé dans un organisme individuel. Le risque est alors pour chacun d’user de ce pouvoir créateur à des fins d’intérêt particulier, provoquant fatalement des réactions chaotiques et désastreuses. L’autre écueil pour l’esprit est de se laisser fasciner par le plaisir que lui procure le jeu de cette puissance conceptuelle. L’un des dangers que suscite une telle fascination consiste à confondre qualitativement les forces de l’univers matériel avec la configuration virtuelle engendrée par l’action qu’on y joue.
Les produits conceptuels deviennent alors pour l’esprit des réalités tangibles. Cette méprise engendre des types de comportement plus proches des réactions instinctives primaires à l’œuvre dans les conflits d’intérêt que de la complexité subtile et compréhensive d’une pensée. Le caractère dramatique d’une telle confusion est que ces créatures virtuelles que l’on croît réelles sont traitées par des moyens techniques inventés par l’astuce psychique, avec des conséquences très concrètement destructives.
Il est vital de bien évaluer sa force physique pour savoir en user, il en est de même pour la puissance psychique de l’humain qu’il est de plus en plus dangereux pour lui même et pour les autres d’utiliser sans connaître véritablement sa nature.
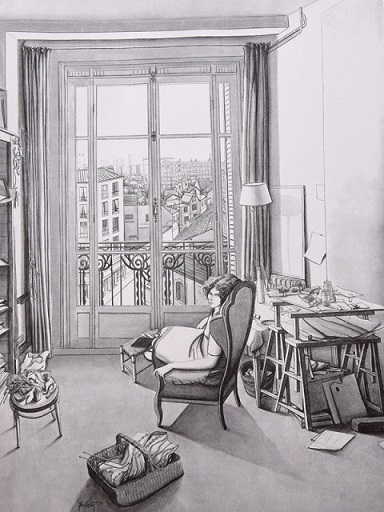
Commentaires récents