§5 Radiographie de la diffusion chez l’humain
Tandis que les étants de l’univers s’expliquent ou se déploient de manière qui nous semble “obéir” à des “lois” que nous essayons de formuler, l’esprit humain s’est distingué par la formation de cette dimension nouvelle qui consiste à porter un regard sur la matière qui détermine son existence. Il est ainsi, pourrait-on dire, assis entre deux chaises. Par son corps physique, il participe au mode opérationnel de tous les autres étants. Mais la conséquence de sa puissance cérébrale d’abstraction est la capacité d’une vision harmonique qui provoque une puissance de volonté dépendante d’une liberté. Pour illustrer l’état humain, on peut se figurer un véhicule sans chauffeur dans lequel le héros (Liberté) doit sauter pour prendre les commandes et rectifier la trajectoire afin de parvenir au but et d’éviter la catastrophe. La gravité de l’accident serait proportionnelle au degré de puissance de la volonté par rapport à la largeur, à la précision, à la qualité de la vision.
En effet, le danger qui guette la faculté cérébrale est l’outrecuidance. L’orgueil est bien la cause de la Chute. Car le Concept qui veut ce qu’il peut, ne voit cependant que ce qu’il sait, c’est à dire que l’esprit humain accorde sa gouverne à la conscience conceptuelle sans s’apercevoir qu’elle est agie par des ressorts ignorés.
Dans la communication, la représentation conceptuelle se figure la conversation à l’image d’un télégramme : quelques mots essentiels forment la substance et suffisent à l’efficacité du message. En vérité, la part des mots dans le télégramme est celle de l’énoncé des plats dans un repas. Il permet seulement de dire ce qu’on va manger, à moins que, méprisant le rôle purement descriptif, il ne vise aussi à façonner le prestige social du restaurant qu’il sert par un intitulé quasi littéraire. L’idée que l’on se fait de la communication est presque totalement composée des artifice culturels dont on l’entoure. Sa nature disparaît sous les ornements de sa pratique. La conscience s’accroche à l’emballage conceptuel, idéel et technique et ignore le cœur vivant de l’événement.
Sans doute ne peut-il en être autrement, puisque la nécessité existentielle humaine exige l’emploi préférentiel de l’image abstraite qui va permettre l’emprise sur le monde. L’écran visuel interne qu’est la conscience est donc entièrement accaparé par les concepts et préoccupé par le jeu de leur organisation. Le scénario dont dispose la conscience pour une relation de son expérience est succinct, il ne décrit que ce qui peut être dit, le langage utilitaire se construisant par affinité avec les qualités substantielles de la matière qui compose l’événement. Le plus souvent, la conscience que l’on a d’une situation s’apparente aux présentations dérisoires d’une mauvaise émission dite littéraire qui se contente de vanter “l’histoire” des livres qu’elle recommande. Et pourtant, le sens d’une conversation n’est pas lisible dans les seuls mots des phrases qui la verbalisent.
La diffusion de la communication n’est pas conceptuelle. Elle apparaît en révélant la structure de l’humain. Elle participe des trois niveaux de notre existentiel, le physisprit, le mentique et le spirituel. Le terme de communication est la formule conceptuelle qui désigne la sensibilité humaine en action. La diffusion, qui est la conséquence de l’acte, s’organise en fonction des matériaux qui l’occasionnent, le physique, le cérébral et la conscience réflexive. Chacun de nos actes, jusqu’au plus banal, exprime l’état de notre corps, sa structure personnelle et ses potentialités acquises par l’expérience dans le temps. Chacun de nos mouvements, chaque pensée, chaque parole est l’explicitation des capacités mentales qui exploitent l’énergie d’un corps, de ce cerveau dans ce corps là. Le degré de conscience individuelle, c’est à dire la capacité d’agir pour l’harmonie de cet organisme physico-mental avec le monde et l’autre, détermine la qualité de l’acte. Les conséquences diffusées de cet acte seront au diapason de cette qualité.
§6 Le vécu de la diffusion
On appréciera le degré de conceptualisme de notre époque en comparant cette représentation de la diffusion originelle avec celle qui circule de façon consensuelle aujourd’hui. Le mot diffusion est pour nous synonyme de distribution matérielle des ouvrages et de vulgarisation des idées. La tâche que pressent là l’esprit humain lui paraît digne de l’investissement d’un effort, la gestion de la matière étant toujours plus conviviale à la faculté conceptuelle que la douloureuse remise en cause qu’exige la recherche de l’origine. Dans cette perspective en effet, la Raison n’est plus maîtresse mais servante, le moindre de ses élans devant être soumis à inspection, non point en regard d’une efficacité, mais de la justice de son intention.
Quand elle respecte sa place hiérarchique dans la nature humaine et qu’elle se positionne sur la voie d’accès à l’Intuition, la Raison devient observatrice et s’aperçoit que son vrai rôle est d’admirer plutôt que de réguler. Elle conçoit, par les actes manqués, les lapsus, les omissions involontaires, que son corps “trahit” la pensée qui se croit dominatrice. Elle découvre que les choix sont faits avant qu’elle ne puisse en formuler la façon. Elle a peine à discerner les enjeux réels d’une situation. Un graphique pourrait montrer, au dessous d’une ligne horizontale, le réseau infiniment complexe des interactions physiques et mentales qui jouent le drame incessant de l’univers et puis, au dessus, les quelques bulles d’un dialogue socialement et culturellement admissible. Qui n’a jamais éprouvé que l’état général physique, affectif et mental d’un interlocuteur pouvait profondément modifier sa conformation personnelle au point que les paroles énoncées et même les gestes semblaient émaner de cet espace intermédiaire plutôt que de son propre chef.
La logique des relations est sans préjugé, elle enregistre l’intégralité des éléments qui sont fournis par la rencontre et livre une opération de synthèse qui informe à nouveau les organismes en question. Le comportement de chacun est alors la résultante d’une multiplicité d’adaptations et de réactions aux influx, qu’ils soient reçus du milieu physique, des constituants chimiques, affectifs ou spirituels des étants réunis.
Le procès de l’opposition entre nature et culture n’est-il pas né de cette observation que le milieu d’évolution influe si profondément sur l’être personnel et social qu’il le confond avec son propre cœur ? Les maniérismes du corps, de la diction, des comportements, des attitudes mentales d’une époque ou d’un pays sont à l’esprit humain ce que l’air et l’eau sont à la vie biologique, des éléments de base qui permettent à l’organisme individuel de se développer en acquérant une conformation particulière.
La mode en effet n’est pas le phénomène superficiel que l’on est tenté de croire quand on veut dénoncer ses manifestations extrêmes, qui n’en sont que la caricature. La mode est habitus, c’est la manière d’être d’un individu, constituant un ensemble de signes socialement codés. La composition d’un tableau particulier est affaire personnelle, chacun peut y affirmer son individualité, mais les éléments concrets de cet assemblage proviennent d’un fond commun d’apparence variable selon les temps et les lieux. Les modes, les coutumes et les lois sont les matériaux qui caractérisent un groupe humain et constituent son bien identitaire qu’il peut se battre pour défendre. Et pourtant, cette conformation qui définit l’individu est le résultat circonstanciel d’un hasard de situation. Tous ces fils qui forment la trame de son existence lui confère son apparence mais n’en sont que les caractères secondaires. Ce qui est essentiel, c’est l’échange incessant qu’il entretient avec le milieu qui est le sien.
Il apparaît donc que cette diffusion formatrice est largement inconsciente. Ce qu’il reçoit et ce qu’il émet n’est pas décidé par l’individu qui en vit l’expérience. Cela ne signifie pas qu’il soit la proie d’un déterminisme impérieux, la tâche de sa liberté consistant justement à traiter de manière avisée les éléments qui lui sont échus. Ce qui importe, c’est que la sensibilité humaine s’exerce à l’accueil de ces influx qui la rencontrent. C’est à chaque milliardième de seconde que nous vivons l’instant décisif qui va transformer notre vie. Nous sommes bombardés en permanence par des forces diverses qui nous obligent à une réaction immédiate, d’adaptation ou d’opposition. Le fait que la faculté conceptuelle soit seulement capable d’en faire l’inventaire et ce, pour le plus petit nombre de cas, n’empêche pas ce travail intense de s’accomplir.
Quand la Raison proclame son pouvoir et affirme sa superbe, ne faut-il pas lui rappeler que nos réflexes les plus intimes, physiques et mentaux, sont le fruit de cultures ancestrales, que les penchants, les tendances, les opinions que nous nous approprions sont les résultats d’expériences et de décisions que nous n’avons pas nous-mêmes vécus, que nous sommes perméables aux humeurs chimiques et affectives des corps qui nous côtoient, que ce commerce élémentaire est l’essence même de notre existence, qu’il nous fait vivre et mourir ?
Mais la diffusion n’est pas seulement le milieu structurant de notre individualité, c’est aussi le champ d’action de notre liberté.
§7 Aspects qualitatifs de la diffusion
Sur le plan matériel, la diffusion est un déterminisme inéluctable. Le lion, l’aigle et la fourmi n’ont quasiment pas le choix de leurs mouvements, ils sont agis par l’instinct qui régule en contrepoint l’harmonie de leur comportement avec celle de l’environnement.
L’humain est également soumis à cette loi naturelle mais sa faculté conceptuelle la modifie par un pouvoir d’interférence. L’intelligence humaine n’est plus seulement la capacité d’adaptation au milieu mais l’aptitude à l’invention. Cependant, les niveaux humains du physisprit, du mentique et du spirituel existant dans l’interdépendance, ce phénomène du mimétisme va se produire à l’intérieur même du processus conceptuel qui sert à la création.
Le phénomène de l’imitation est ainsi complètement différent chez l’humain : tandis que dans la nature instinctuelle le mimétisme est la propriété de se rendre semblable aux apparences du milieu, cette capacité s’établit dans le comportement humain au niveau de la finalité. S’il y a contagion par l’exemple, l’implantation dans l’éthique individuelle dépend de la représentation : le spectacle du talent, du vice ou de la vertu ne suffit pas à déclencher l’action, il faut encore qu’une économie voulue établisse un accord entre l’incitation qui provient de l’extérieur et le mobile qui est interne. Deux personnes issues d’un même milieu, ayant connu la même éducation, ne réagissent pas de façon identique à la même situation. Cette différentiation est le fruit de la volonté de choix des individus. Mais quand il y a passivité, c’est à dire régression au stade instinctuel de la diffusion, le mimétisme des opinions et du comportement se dessinera dans un motif obligé qui produira le sectarisme, le conformisme, l’esprit de caste et de clocher.
L’une des manifestations exemplaire de la diffusion passive se révèle dans le comportement des masses. L’attraction commune que subit une foule poussera les individus qui la composent à des actes qu’ils n’auraient jamais commis seuls. Le fait que bien souvent les personnes ainsi entraînées éprouvent le remords et s’étonnent “d’avoir perdu la tête” appelle une remarque. Le commentaire usuel qui décrit le caractère irréfléchi, généralement brutal de ces conduites émet le jugement que, chez ces humains là, la nature animale a repris le dessus. Inspiré par La Fontaine, le pauvre animal dénoncerait la mauvaise foi hypocrite de cette assertion. Il est certain qu’un troupeau d’éléphants affolés dévaste tout sur son passage. La raison qui l’élance ne connaît pas de frein, il piétine indifféremment tout ce qui advient sous ses pas. Mais la bande de malfaiteurs, de quelque milieu qu’elle soit, n’est pas mue par la panique, elle délibère et choisit ses crimes et ses victimes. Quand il s’agit de désigner un coupable, c’est le degré de responsabilité qui compte. La nature animale est innocente, c’est la Raison qui sait que sa puissance doit être pensée. L’attitude indigne d’un être humain qui perd la tête consiste à s’excuser en arguant de sa nature animale, mais sa plaidoirie est vicieuse puisqu’elle oublie qu’un acte humain est toujours issu de sa faculté conceptuelle et n’aurait jamais pu être inventé par les puissances de l’instinct.
Il faut comprendre la fascination qui produit cette dégénérescence de la Raison. Ce risque et ce danger sont inhérents à la nature humaine : par sa faculté conceptuelle, la volonté est susceptible d’un désir qui transcende l’intérêt de sauvegarder l’organisme. Ce désir veut rencontrer l’unité de la création. C’est lui qui inspire les plus hautes valeurs humaines et se réalise en l’art, en l’amour, en l’héroïsme, en la capacité de dépassement de soi. Et c’est là qu’il peut faillir et se convertir en sa parodie. On a vu le sortilège s’exercer par exemple sur les foules écoutant Adolf Hitler qui avait le don d’émouvoir cet élan. Ils répondaient tous d’un seul cœur, d’une seule âme et d’une seule voix en jubilant et clamaient Ein Führer, Ein Reich. Ils étaient tous unis, heureux, transportés, ils ne faisaient plus qu’un. Mais ils avaient “perdu la tête” et leur Raison étouffée par les vociférations de cette passion ne pouvait plus leur faire entendre que cette belle unité s’exerçait non pas pour l’être, mais contre lui, aux dépends d’un pseudo ennemi.
Là est le paradoxe tragique et spécifique à l’humain. Doué d’un pouvoir qui lui confère une autonomie d’action, il fonctionne en déléguant cette puissance. Sa liberté consiste en effet à définir la finalité de ses actes, mais la loi du moindre effort qui est un principe naturel d’économie, le pousse à choisir un maître qui lui épargnera ce travail difficile. Tous les entraînements de masse, l’attrait des sectes, la séduction des idéologies, la force des conformismes de tout poil proviennent de cette paresse engendrant cette lâcheté qui consiste à se prétendre libre en se rendant esclave. La nature humaine qui réfère sa puissance de volonté à sa faculté conceptuelle découvre qu’elle doit soumettre cette faculté conceptuelle à une instance orientatrice. Quand elle ne choisit pas la Vérité qui la fait Une avec l’Être, elle s’adonne à l’adoration d’un petit dieu et en fait de perdre la tête, c’est à corps perdu qu’elle se vautre dans la fange des soliconcepts. Nous sommes tous et sans trêve sollicités par ces tyrans que sont nos projections mentales précipitées par le désir sur des charmes bien concrets, tant il est plus évident d’adorer le visible que d’aimer l’invisible.
Une telle déclaration peut paraître fumeuse et “mystique” et pourtant, une conscience ouverte sur l’innommable, c’est à dire l’esprit non-conceptualisé, est la seule garantie d’une Raison “raisonnable” qui peut guider l’impétuosité passionnelle du désir vers sa véritable destinée de responsabilité.
L’enjeu de la diffusion chez l’humain n’est donc pas matériel, il concerne l’intentionnalité de l’acte.

XXVII
Ce n’est point que je les réprouve,
mais ils me grincent.
Leurs faits ni leurs gestes ne me coïncident
nul bonheur à les ouïr,
ils me palatent à vrai dire,
comme brouet fade et mal cuit.
La sauce tourne et déliquesce
si je les assaisonne.
Je me languis comme un gourmet
condamné aux agapes d’une pauvre cantine
et suis trop souvent contristée de remords nauséeux.
Je me prends alors, dans ma triste anémie,
à maudire toute chère, à vilipender
fruits et fromages, les rôtis, les laitages
et jusqu’aux vins que la nature
offre pourtant à généreux loisir
à qui sait les cueillir.
Ah! Qu’il me souvienne enfin de tant de mets
délicieux, exotiques, excitants, spirituels,
dangereux, denses et raffinés, tout pétris
du goût vert de la sève jaillie
des profondeurs du gouffre
et nourrie de l’abondance des saisons.
18.6.1978
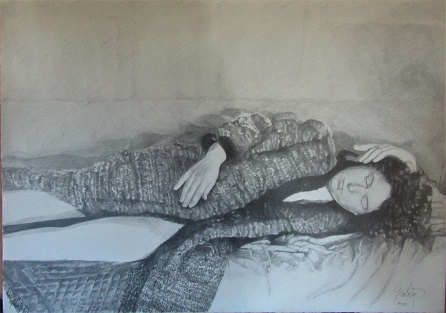
Commentaires récents