§13 Examen de la vertu fondamentale de l’Instinct
Pour connaître ce qu’est l’avatar humain de l’instinct, il faut d’abord recouvrer la notion de son origine cosmique. Cette force apparemment autogène est une variante de celle qui génère le mouvement des particules. Il ne faut pas la penser selon sa matérialité présentifiée, l’on sait en effet que l’anti-matière et les trous noirs ne ressemblent pas à l’univers où nos sens se reconnaissent, et que pourtant leur étrangeté constitue sa structure essentielle. Les lois physiques qui gouvernent notre monde ne sont pas celles qui actualisent un autre état de matière, elles sont pourtant conniventes et connexes.
Les créations religieuses et métaphysiques d’une culture sont assorties à ses conceptions de la matière. La nôtre ayant privilégié le niveau mentique ou idéatique de l’esprit, l’imagination religieuse a logiquement attribué la création du monde à une volonté, qualifiée d’absolue, nommée divine. Le crédit des formations conceptuelles grandissant au fil du temps, l’image de Dieu s’est laïcisée dans la fonction du Grand Horloger dont par la suite on a gommé jusqu’au fantasme lors de l’exploration des espaces sidéraux. Aujourd’hui, la cosmogonie scientifique pose l’hypothèse des “trous noirs” comme moteurs de l’énergie créatrice de l’univers. La description matérielle s’est affinée mais le mystère garde son opacité car l’image du moteur pose la question de l’agent qui le fait tourner.
Cause, origine, facteur, principe, force, tous ces mots peuvent être substitués au Verbe du dieu créateur sans pour autant clarifier la situation, à moins peut-être de faire l’économie de la notion de temps. Car le concept de création appelle l’idée d’un commencement, d’un après et d’un avant, mais si l’événement illustré par le terme explosif de Big Bang était le centre d’un cercle, le lieu de sa circonférence décrivant le temps, on pourrait installer l’image d’un infini sans bornes temporelles qui permettrait d’ailleurs encore la dispute terminologique de ses attributs, définis matériels ou divins.
Contentons-nous du système conceptuel contemporain et considérons cette dynamie responsable de “l’évolution” qui roule sur la flèche du temps.
Que le temps soit cause première ou conséquence de l’existence de la matière, il est certain en tout cas que c’est sa transformation qui date le temps. Cette solidification du possible dans un lieu du temps génère l’irréversibilité de l’être. Une fois qu’une rencontre a produit un état défini, son être appartient à l’immortalité. Il ne peut plus ne pas avoir été. Le fait d’être “conservé” au sein du temps, alors même qu’un étant a terminé sa portion d’existence, équivaut à celui d’accéder à son tour au rang de cause. Une existence donnée influe sur celle de tout autre à venir. La transformation évolutive est une comptabilité rigoureuse qui enregistre tout, fait travailler tout avec tout, si bien que les résultats de cette loi inexorable sont à la fois inéluctables et imprévisibles.
Une considération hâtive de cet état de fait pourrait tirer deux conclusions évidentes bien que contradictoires : l’existence subit un déterminisme implacable, la création est permanente et l’avenir reste à déterminer. “On ne sait jamais…” avec “tout est écrit…” sont les deux presse-réalité qui nous servent à maintenir debout la rangée de nos représentations paradoxales. Parmi ces couples d’opposés, on peut compter le matérialisme et le spiritualisme, les sectateurs de l’objectif et ceux du subjectif qui se confrontent belliqueusement mais ne peuvent se passer les uns des autres.
Comme nous le savons bien par nos passions, nous vivons de rencontres, nous sommes affectés par le monde et par autrui, que nous impressionnons. Pourtant, le drame de notre existence humaine consiste à pouvoir isoler chaque étant par notre faculté d’abstraction.. Nous prenons à la lettre l’image du microcosme et nous considérons chaque organisme comme une entité autonome et, fantasme extrême, autosuffisante. Le fâcheux vis-à-vis de cette folie consiste à ne pouvoir se structurer selon le principe d’individuation et à se sentir douloureusement ou à l’inverse à se laisser indifféremment pénétrer par toutes les influences éventuelles.
Ainsi que le prouve notre physisprit à la Raison, nous sommes un centre d’échange permanent qui prend et donne à son milieu pour le meilleur et pour le pire, aussi bien du corps individuel que du monde où il se manifeste. Bien sûr, cette évaluation qualitative est le fait de la Raison qui s’est imposée à notre insu dans la réflexion et dans la phrase. En effet, pour notre Raison, l’événement le plus important est notre existence et tout ce qui peut la favoriser est jugé digne et bon. Mais notre corps, qui est cosmique avant d’être rationnel, nous donne l’assurance qu’à ce niveau l’essence de l’être n’est pas l’individu organique mais la relation entre les éléments.
Voilà pourquoi la maladie est pensée cruelle, qui ne respecte pas la logique que nous édifions sur le désir individuel mais qui tient compte de tous les éléments cosmiques entrant en lice avec cet organisme et son état particulier.
La force créatrice étant la rencontre, l’association de deux qui produit un troisième, va naturellement varier son phénomène selon la matérialité des entités concernées. Le destin des galaxies, l’électricité, la photosynthèse et la pluie sont des événements conséquents à des jointures diverses qui peuvent encore confluer en d’autres conjonctions. Les événements de l’espace les plus étrangers à notre monde humain sont issus de l’interaction de ce mouvement infini dont le temps n’est qu’un caractère secondaire.
§14 De l’instinct chez le vivant
Ce flux survient dans les espaces intergalactiques et il se manifeste diversement sur la terre. Les humains, qui peuvent nommer et classer, définissent ces aspects par les pouvoirs qu’ils démontrent. L’instinct est l’impulsion qu’un être vivant doit à sa nature et par extension son comportement, c’est à dire les moyens qu’il emploie pour atteindre l’objectif que cette tendance lui fait désirer atteindre.
L’instinct est donc une manifestation circonstanciée de cette puissance, de cette volonté, de cet émoi, de cette effervescence universelle. La vie des astres, l’invention des espèces, le glissement des strates géologiques, les propriétés mécaniques ou chimiques des éléments sont les phénomènes de cette force qu’on peut se figurer unique tant qu’on n’en considère que le principe et non les matérialisations.
Évidemment, la multiplicité aussi bien que la disparité de ses incarnations ont à ce point troublé la conscience humaine qu’elle a eu besoin, pour se donner des repères, de personnifier cette “volonté” en la localisant par l’action d’un dieu. Mais le grave inconvénient de cette représentation est d’être à l’image de l’humain et de tendre à tout réduire à cet état qui module l’existence humaine et qui est notre niche cosmique à nous. On ne parlera pas de l’instinct du vent, on n’attribuera pas de volonté au volcan, mais ceux qui ont vécu un tremblement de terre ont eu la sensation qu”il” cherchait à les atteindre, tel un fauve aux aguets.
L’instinct est donc une notion qui caractérise les êtres vivants et qu’on emploie le plus souvent pour qualifier des comportements d’espèce. L’instinct de conservation est subdivisé en instinct sexuel ou de reproduction et en tous ceux qui assurent les moyens de la survie, l’instinct de nidification, l’instinct migratoire ou celui de mellification, par exemple.
L’instinct est une part de la puissance qui active l’univers avec tous ses royaumes (y compris ceux dont nous n’avons pas la moindre idée). C’est une “part” qu’il ne faut pas se figurer comme la tranche d’un pain, mais plutôt comme la variation d’un thème musical. Le possible y est toujours à l’œuvre, qui façonne l’imprévisible à partir du déterminisme matériel. L’évolution décline ses variations tout en observant les lois de la matière engagée dans la production d’organismes particuliers. Le caractère inné de l’instinct correspond à son attribut d’éternité, la mutabilité de ses apparences à son fatum temporel. L’irréversibilité existentielle du temps engendre pour nous l’illusion de la finalité.
La puissance cosmique n’a pas de “projet”, au sens que nous lui donnons, c’est à dire l’image pré-vue d’un acte ou d’un bien que nous nous efforçons d’obtenir. C’est notre appartenance au temps qui nous fait commettre ces naïvetés anthropomorphiques : nous imageons l’instinct par l’analogie pitoyable de l’aveugle éperdu, ou bien de celle, jugée absurde, du voyageur qui part sans décider de sa destination. L’autre profil de l’instinct est représenté par la cruauté d’un tyran qui se joue de nous, s’amuse de nos tourments, feint de nous accorder la liberté tout en étant bien décidé à nous détruire irrémédiablement.
Toutes ces affres sont inconnues des animaux qui sont “bêtement” installés dans l’instinct et qui, s’ils regimbent parfois contre leur sort, ne sont pas conscients de leur révolte. Ils ne sont pas révoltés, d’ailleurs, puisqu’ils n’ont pas la faculté humaine de projeter hors d’eux-mêmes une image virtuelle. Ils ne peuvent donc pas pratiquer la révolte, c’est à dire se retourner contre cette volonté qui les propulse et qui serait alors perçue comme une puissance étrangère. Quand ils renâclent, qu’ils luttent, ou qu’ils résistent, c’est la force cosmique investie dans l’instinct qui les agit et les incite à faire primer leur individu sur les obstacles et les adversaires qui le mettent en péril. A ce niveau, le conflit est un aspect de la rencontre. S’il s’exerce une violence, c’est sans intention, la destruction de l’un prise en compte dans l’économie générale qui les concerne tous.
Dans l’instinct, la souffrance des bêtes existe mais elle n’est pas réflexive. Leur vie individuelle évolue sur la voie directe de l’instinct qui est l’explicitation pour les organismes vivants du mouvement cosmique universel. Tel n’est pas le cas pour les humains.
§15 Transformation de l’Instinct chez l’humain
La conscience humaine s’est basée sur un possible que n’ont pas rencontré les autres espèces qui ont matérialisé d’autres façons. Nous envions parfois leur force, leur adresse, leur résilience, leurs poils ou leurs plumes, elles n’ont pas notre imagination. L’accentuation sur l’adjectif possessif signifie que la leur n’est pas de même nature. On pourrait dire que l’image animale est naturelle tandis que la nôtre est perverse dans le sens où elle est capable de détourner la performance primitive de l’image qui accompagne l’instinct.
Pour l’animal, l’image est la jointure entre l’individu et le monde, qui permet l’acte et l’adaptation. Tout organisme vivant est relié au monde par des antennes sensitives qui sont tout à la fois la définition de son individualité et les moyens de la perpétuer. L’image est l’intégration à l’organisme particulier des caractères matériels ponctuels de son monde, qu’il lui est nécessaire d’apprécier pour inventer le mouvement qui convient pour l’habiter. L’image est donc la structure de l’acte vital.
Mais aux dimensions terrestres de l’espace et du temps qui conditionnaient l’image du règne animal, les facultés mentales de l’espèce humaine vont en ajouter une troisième, qui est celle du rêve ou du possible.
Il est important de constater ici, encore une fois, que le langage est conceptuel et comme tel, obéit à l’intention qui le conduit en créant l’objet mental désiré tout en laissant l’impression au sujet responsable de ce langage qu’il n’a fait qu’observer en le nommant un objet objectif pré-existant. Quand l’imagination humaine demande au concept de fixer une image, celle-ci prend aussitôt à ses yeux une valeur d’objet. On aura donc couramment l’impression que le système des “valeurs” par exemple aura été donné, révélé tout entier avec ses attributs matériels définis. Cette naïveté s’étonnera ensuite que les valeurs, changeant de forme comme toute chose terrestre, aient l’air de vouloir mourir…
En fait, l’esprit humain se constitue en échappant à l’attraction matérielle que subit l’instinct. Cette force vitale qui se manifeste en pulsion chez les êtres animés est la spécialisation adéquate de la force cosmique universelle. Matérialisée pour régir le vivant, elle est perçue dans son état de potentialité par la puissance humaine où elle agit et dont le support physique acquiert une capacité mentale réflexive.
L’imagination humaine est donc apte à connaître la force créatrice dont dépend sa vie individuelle. Mais le terme d’imagination ne doit pas faire entendre l’existence d’une image concrète : l’imagination humaine est une conduite (de même que l’image était acte pour l’instinct). Nous appelons Intuition cette puissance humaine qui est l’incarnation du mouvement universel et qui est caractérisée, dans cette incarnation, par la faculté d’utiliser des produits mentaux virtuels, les concepts.
Pour s’aider d’une image évocatrice, il faut penser que l’Intuition participe du “niveau” où s’opère la création de l’instinct et des outils conceptuels, niveau de cet état où notre matière n’est pas encore caractérisée.
§16 La Raison dérivée de l’Instinct…
Nos catégories sur la matière nous sont tellement coutumières qu’il nous est difficile de percevoir qu’elles ne sont fondées que sur l’habitude. Nous pensons évident de faire équivaloir le réel au tangible. Nous ressentons par couple d’opposition, le noir n’est pas le blanc. Nous raisonnons justement que ce qui est ici maintenant n’est pas ailleurs au même instant. Alors, qu’allons nous faire de ce qui n’a pas de lieu, pas de temps, qui n’a pas de corps, qui n’est pas matériel ? “Ce qui” est encore un terme abusivement descriptif pour évoquer cet indicible.
Il est vain de chercher un terme précis puisqu’il se référera fatalement de la matière et de ses lois. Les ombres spirituelles qui hantent le corps de la matière y sont indissolublement liées. L’idéalisme philosophique veut donner corps aux idées.
Mais le pouvoir absolu, le principe de puissance qui fait voler le papillon est identique à celui qui crée ou fait imploser les astres. Cet acte principal qui n’est pas un sujet, qui n’a pas de volonté puisqu’il n’a pas de corps, qui ne dépend pas des lois de la matière telle que nous la sentons, il nous faut donc le penser hors de l’espace, hors du temps, hors même de notre pensée qui s’enracine dans les images.
L’un des précipités de cette puissance est notre terre qui se meut dans l’univers, où s’activent les éléments qui s’ordonnent en substances diversement qualifiées. Cet ordre se complexifie et par tentatives répétées, se hiérarchise en espèces qui s’inventent des atouts de perfection. La rose est aussi parfaite que le lézard puisqu’ils ont tous deux réalisé la manifestation de la puissance originelle et ont atteint le degré le plus haut dans leur échelle de valeurs. Leur vie instinctive est une image du principe créateur.
L’espèce humaine s’est dotée d’un plus haut degré de complexité qui lui a permis de coupler harmoniquement la voie de l’instinct. Si l’on figurait l’univers comme un paysage habité, l’instinct serait une tortue qui chemine laborieusement, épousant avec application chaque repli de la terre, mais sans vision panoramique. L’intuition serait un oiseau dont la vue atteint partout l’horizon, qui peut voler en tout sens, accompagner la tortue et puis revenir, dans notre fable, en arrière du temps. Cette image ferait apprécier les tessitures respectives de l’intuition et de l’instinct, mais cette personnification fabulatrice qui les différencie ne devrait pas faire oublier que les deux tons sont émis par la même voix, qu’il s’agit partout de la même puissance, autrement apparue. Comment s’étonner que l’imagination humaine ait rêvé le panthéisme et ait peuplé ce panthéon de dieux d’apparences si diverses.
Si donc Saint François d’Assise avait raison d’apprécier en dignité l’existence de nos frères et sœurs les bêtes, son prêche leur était bien inutile puisqu’ils n’avaient pas dévoyé l’Instinct par la Raison. Car si le terme d’intuition évoque le pouvoir créateur universel présent en l’humain, les modalités de cette présentification sont spécifiques à l’espèce humaine et n’appartiennent qu’à elle.
§17 La Raison déracinée de l’Instinct…
L’humain n’est pas un animal raisonnable. S’il l’était, cette formule signifierait que la conscience humaine a simplement superposé la raison à l’instinct. Et puis, il y a dans l’adjectif raisonnable une connotation d’équilibre et de mesure qui serait, en dernier examen, beaucoup plus le fait des animaux que des humains.
Au contraire de cette définition de continuité linéaire, il faut dire que l’humanité a essentiellement rompu avec l’instinct. L’humain n’est pas un animal parce qu’il s’est coupé de ce processus vital élaboré qu’est l’instinct. Les fonctions organiques, toute la vie du corps, jusqu’aux battements du cœur et aux contractions péristaltiques, sont en relation directe avec ses facultés cérébrales d’abstraction. La digestion est dépendante de son pouvoir de former des concepts.
Il ne s’agit pas de la dépendance d’un esclave à son maître ou d’un objet à son propriétaire, dont il est censé pouvoir user à sa guise, mais de la relation interactive où les parties composites sont chacune déterminante du tout.
Tous les mouvements du physisprit, toutes les activités mentales, toutes les valeurs spirituelles ont leur fondement dans la nature spécifique de l’imaginaire humain qui, en se départissant de l’étroite spécialisation de l’instinct, s’est ouvert à la potentialité du chaos.
La nature humaine est grandiose et misérable. Elle est telle un cercle brisé, paradoxe irréductible. Chaque personne exprime l’essence universelle mais son être particulier est étranger à ce Tout. Son être désire l’absolu, sa vie l’en exile. Sa chair serait en paix si sa conscience ne la projetait hors de soi.
L’être est acte. Mais pour l’être incarné, l’acte est pensé selon les dimensions de la matière car son corps est lié au temps et au lieu. Pourtant, l’Acte suprême est immatériel et nous le savons car nous en émanons. L’acte créateur n’est pas à confondre avec l’instant ponctuel de notre conception. La cause prochaine de notre existence est bien située dans l’ordre de la chair mais notre être ne se réduit pas à cette incarnation. Les autres créatures, astrales, minérales, végétales et animales participent comme nous du mouvement universel et leur être existentiel a la même essence que la nôtre. Notre corps le sait bien qui évolue par attraction comme les astres, qui subit le poids de la pierre, dont la chair s’épanouit et s’étiole et meurt comme une bête.
Mais si notre existence dépend de la chair, la manière dont elle fait exister notre être n’est pas identique à celle qui régit les autres étants. Ce qui nous différencie des autres créatures, c’est que nous savons que notre être est de même essence que le leur. Ils existent, nous savons que nous sommes.
A vrai dire, notre conscience se complaît le plus souvent à gérer les modalités de notre existence. La contemplation de son être demande à la chair un sacrifice consenti. L’inconfort immanent à la conscience humaine s’éclaire par la compréhension de cette dualité constitutive : la conscience réflexive est le moyen de l’existence humaine, la conscience de son être l’oblige à transgresser le plan de cette existence. La conscience permet l’existence humaine, en elle s’implante la puissance de la volonté individuelle mais cette conscience et cette volonté sont fondées dans l’être qui n’est pas individué. La chair est le sol de la conscience, qui prend là sa racine et en tire tous ses états, mais elle est écrasée par ce savoir qui transcende son existence et ses droits. La conscience est de l’être, la chair est de l’existence ou de la vie.
Il s’ensuit que la conscience individuelle dépend de la vie de l’organisme de la personne considérée, mais cette relation de fait ne décrit pas l’être réel de cette personne, qui n’est pas enfermée dans ses limites existentielles.
§18 La Raison esseulée se crée un ancrage à son image
Voilà le secret essentiel que l’humain voudrait tant oublier bien qu’il l’ait pourtant toujours connu. Ce possible qui engendre la matière, tous les états d’énergie et ce que nous appelons par référence à notre milieu, l’antimatière, ce possible est notre véritable nature.
Si nous figurions dans un défilé tous ces états (y compris ceux qui nous sont inconnus, mentionnés par des espaces blancs), nous verrions passer la créature humaine en son temps et son lieu. Bien sûr, cette proposition est absurde puisque l’image d’un défilé nécessite pour se manifester l’espace et le temps qui sont nos caractères et non pas ceux de tous les autres états. Mais elle tente d’évoquer pour notre imagination charnelle la parenté qui nous lie à tout l’univers.
L’histoire religieuse racontait qu’un ange avait voulu rivaliser avec Dieu. La faiblesse de cette imagerie théologique est qu’elle chosifie les éléments idéels de sa vision. Le résultat de ce traitement aggrave la confusion qu’il espérait résoudre, car en réalité, Dieu, l’Ange et la tension de rivalité ne sont qu’un seul et même drame, la nature humaine. Dieu est ce possible dont nous sommes créateurs, l’Ange est une matérialisation de ce possible, dans une forme aussi parfaite que son état de créature singulière peut le réaliser, la tension de rivalité est l’enjeu de l’existence humaine, écartelée entre son rêve absolu et ses limites caractérisées.
Il est loisible de raconter par le menu les détails de cette aventure épique de l’histoire humaine, mais une synthèse compréhensive permet de faire émerger le lieu commun de toutes les cosmogonies. La conscience humaine ne se contente jamais d’exister, elle veut toujours faire le point de sa situation et, pour ce faire, traite les images qui peuplaient la vie instinctive dans les différents systèmes conceptuels qui sont à sa portée. L’intuition à l’œuvre dans ces expositions est concrétisée en divers matériaux mais toujours sous la forme de personnage conceptuels.
Si bien que l’on considère le même processus en application qu’il s’agisse de la déification du Soleil, de la Terre, que l’on adore Mithra, Zeus ou tous les dieux imaginables, par exemple l’Argent ou le Progrès. Ces concrétions conceptuelles sont la projection, nécessaire à l’équilibre humain, de son être non matérialisé.
Mais il était tout aussi nécessaire qu’au cours des âges de cette vie humaine l’esprit connaisse la nature de ces projections, autrement dit qu’il s’emploie régulièrement à démythifier ses mythes. Dans l’opération, il s’embrouille d’ailleurs quelque peu.
L’utilité de la démythification réside dans le fait de reconnaître la valeur réelle de l’objet qui porte le poids du mythe. Son importance et son caractère sacré ne tiennent pas à la matérialité de sa figure mais à son caractère de représentant délégué d’une conception abstraite. La notion d’idole témoigne du glissement accidentel et de la tentation d’attribuer à l’objet sacré la possession en propre d’un pouvoir qu’il n’est là que pour représenter. Il convient donc de démythifier l’objet sacré pour revitaliser la fonction du mythe. Mais dépoussiérer le mythe a pour but de le voir dans tout son éclat, non pas de le démystifier en révélant qu’il était trompeur. Croire en l’objet était une erreur qu’il est bon de dénoncer. Mais déboulonner une idole particulière ne signifie pas tuer le sacré. Le sacré n’est pas non plus une bombe qu’il faut s’employer à désamorcer avec délicatesse. Prétendre tuer le sacré avec violence ou subtilité est un leurre. On ne peut supprimer le mythe, on ne peut que faire varier l’apparence de son objet signifiant.
On ne peut tuer le mythe. L’humanité érigera toujours une nouvelle image du sacré parce que ce processus lui est aussi vital que l’air à ses poumons. Le mythe est la fonction qui structure l’âme humaine. Celle-ci apparaît quand la complexité de l’organisme physique lui permet d’inventer un nouveau mode d’existence : les images qui géraient les interactions des singularités avec le reste du monde deviennent autonomes, ne sont plus l’acte indivis de l’instinct.
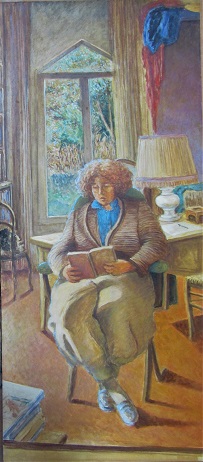
XXIV
Jeunesse émaciée du printemps
visage trop lisse et fervent
masquant dessous les traits triomphants et dorés
qui le ceignent
la fugace candide auréole
qui déjà se nimbe étonnée de douleur,
enfin l’odeur fervide et sûre
de l’antan disloqué, revenu.
Genèse effarouchée
naissant du vieil hiver
ralliant à l’inconnu
des forces qui le saignent,
s’imprègne de moisson,
glanée de par les temps,
et du masque fripé
fait rejouer le mythe étincelant.
1976

Commentaires récents