IV
Le thème de ce chapitre, qui est la diffusion de l’information, semble avoir besoin de l’étai d’un rappel pour s’épanouir. La critique du Concept établit que la définition de l’humain comme “animal raisonnable” provoque une confusion essentielle. La Raison est bien le propre de l’espèce humaine, mais l’erreur consiste à se figurer qu’elle se superpose à la vitalité physiologique et transforme l’humain en un animal supérieur. En réalité, le scénario n’est pas celui d’une addition, mais celui d’une dissociation.
La capacité humaine à produire des images abstraites et des concepts assume la défense de l’organisme qui chez l’animal est assurée par des moyens purement physiques, tels que les griffes, la carapace ou le venin. La téléonomie découvre que le projet animal est la viabilité. La finalité de l’acte animal est confondue avec cette intention de survie pour l’individu et son espèce. La faculté conceptuelle humaine modifie le projet de l’être vivant quand elle invente l’autonomie de la production d’images par rapport à l’acte de survie. L’esprit humain est alors tenté de placer la finalité de ses actes dans la lignée de son pouvoir d’action. Cette confusion l’entraîne à vouloir fonder l’éthique dans la Raison, et d’autre part à incriminer son héritage animal pour faire le procès des méfaits qui lui sont imputables en tant qu’humain. Depuis vingt siècles, la philosophie occidentale engagée dans cette impasse a pourtant paradoxalement étoffé le dossier qui permet aujourd’hui à la conscience humaine de formuler autrement sa situation.
Toute vie est une force agissante, la matière se constitue par choc et mutation, le mouvement est le vecteur de la création universelle. Quand la conscience humaine regarde cette évidence, elle peut considérer le sort individuel et subir un vertige de néant puisque tout ce qui existe est broyé par cette force implacable. Ou bien, elle peut transcender cette vision et porter son regard sur l’harmonie du tout qui supporte en fait les existences individuelles.
L’animal fait corps avec cette force cosmique, il l’exerce, il la subit, il respire, vit et meurt dans cette détermination. L’humain la confronte et entend la maîtriser. C’est dans l’exercice de cette maîtrise que se joue le drame humain. La force qui le fait vivre le fait aussi souffrir et mourir, tout comme l’animal. L’addition de l’esprit humain consiste à inventer des palliatifs, la dissociation provient du fait que bien souvent le remède amplifie le mal, car le concept qui s’obsède sur un pouvoir particulier ne tient plus compte de la vision harmonique et de la responsabilité. Soumise à la force cosmique, la volonté humaine qui s’abandonne à la puissance conceptuelle veut contrarier sa sujétion, et ce faisant, renie l’harmonie et produit la violence.
En résumé, l’organisme humain est une vivante contradiction : il vit et meurt selon la loi incarnée dans l’instinct, la force cosmique ne le traite pas autrement que les autres particules ; la conscience qui habite cet organisme le distingue de toutes les autres espèces parce qu’elle se voit exister dans cette dépendance et, par ce fait, vit une liberté.
La conscience qui lui offre ainsi le choix de ses actes est traitée par la faculté conceptuelle qui s’avère constituée en schizophrénie. L’intelligence conceptuelle, repliée sur elle-même, s’adonne à la rêverie de sa propre logique, perd le contact avec la réalité de l’autre et du monde, délire et s’affirme par l’autodestruction. Pour que la conscience recouvre la puissance de viabilité qui était le bienfait de l’instinct, il faut qu’elle maîtrise les tendances d’aberration du Concept qu’elle utilise pour gérer la matière. La pensée conceptuelle fait obstacle à la pensée digne de l’être humain. L’esprit humain doit sans cesse veiller à contrôler son mode opérationnel, le Concept, par la raison supérieure d’harmonie qui lui vient de l’Instinct dont il s’était échappé par la Raison. Le sens est un cercle, un infini, une éternité.
Cette synthèse originelle radiographie la structure anthropique et désigne l’axe naturel de tout acte humain. L’adjectif “naturel” est employé ici dans le sens où le bon sens veut l’entendre quand il proteste contre une monstruosité. Le fait qu’il pèche souvent par naïveté en opérant une classification maladroite ne trouble pas la justesse de son intention. Ce qu’il dénonce est la capacité purement humaine de donner corps à des êtres nuisibles. Est nuisible ce qui s’exclut par essence de la communauté des êtres et des étants. La nature cosmique procède par essai d’association. Quand elle s’engage dans une voie improductive, elle n’insiste pas. Les collections de monstres naturels n’ont jamais de série. Seul le concept humain peut créer des existences avec une intention isolationniste.
Ce n’est pas la Raison, ce ne sont pas les concepts qui sont en cause, le danger, c’est qu’il est loisible d’user de leur merveilleuse faculté créatrice dans une volonté de rupture, de césure, d’indépendance orgueilleuse. Le mal, la perte du salut, la chute de l’ange et de l’homme sont les métaphores métaphysiques et religieuses de cette potentialité humaine à ériger son processus existentiel en absolu, à déifier sa Raison, à croire que sa puissance est la justification de ses actes.
Dans l’examen de toute activité humaine, il est donc nécessaire de tenir présents à l’esprit ces divers facteurs associés : la dérive potentielle du concept quand il s’arroge le droit en abusant de sa puissance et la correction permanente qu’apporte à cette décadence la force héritée de l’instinct, qui chez l’homme apte au Concept se nomme Intuition
§1 De la diffusion, au sens (actuel) le plus restreint
En axant le principal de ses forces sur l’information scientifique de la matière, la civilisation occidentale a entraîné une conséquence négative de sa prétendue maîtrise : la croyance exclusive qu’il suffit de connaître la matière physique pour expliquer le réel.
Cette croyance a restreint le sens moderne de la diffusion à la simple criée des faits d’actualité. Les bulletins radiophoniques, télévisuels, les livres, les journaux, les revues périodiques et les placards Internet serinent à longueur de temps d’une voix polyglotte la même illusion.
Ce sont des actes d’adoration tels que matines, laudes, vêpres et complies (sans compter les prières intermédiaires) auxquels s’adonnent les suppliants de l’information. Ce qu’ils demandent aux média, c’est de leur fournir leur dose quotidienne de “réel”, qu’il soit boursier, politique ou de faits divers. L’illusion consiste à croire que la connaissance des faits d’actualité que l’on empile dans sa journée par une formulation répétitive est pour l’individu la dimension essentielle de sa présence au monde !
Il y a deux aspects à cette pratique morbide : d’une part, l’on succombe à la tentation “conceptuelle” de confondre la connaissance mentale d’un fait avec le vécu d’une expérience intégrale physique, affective et spirituelle qui seule compte efficacement. D’autre part, l’on se borne à la croyance matérialiste en la nature même de l’information qui correspondrait, dans son sens le plus étroit, à l’objet même que l’on voit circuler. Or, cette notion d’une information concrète devrait logiquement comprendre tous les objets mentaux qui, par leur corps physique, sont capables de circuler. Pourtant, l’on est à même d’observer que les espaces technologiques de diffusion n’accueillent pas tout ce qu’il serait matériellement possible d’y loger.
C’est donc que l’information ne réside pas dans l’apparence qu’elle habite. Elle présente l’intention qui la forme. La diffusion actualise cette intention.
Si l’on examine les modalités de cette diffusion (au sens moderne le plus restreint), il s’avère que c’est le pouvoir qui détient le moyen qui pourra réaliser son intention. Ce principe est magistralement exemplifié par l’actuelle main-mise des puissances d’argent sur les média. L’on y voit clairement que l’intention ne porte pas tant sur la nature des objets distribués que sur la quantité d’argent que leur distribution peut signifier. Cette obnubilation causée par la volonté du profit va conduire à des choix et à des exclusions différentes de celles qui étaient opérées par la censure des pouvoirs autoritaires d’autrefois.
A première vue, la liberté gagnerait à cette nouvelle situation puisque l’expression n’y est plus restreinte au respect d’un dogme préconçu comme c’était le cas dans les pays ou les époques où la terreur et la nécessité d’obéissance émanaient du siège où trônaient le prêtre, le roi ou le tyran. Le poids de la censure va s’exercer comme naguère sur le rival, à cette différence près que le territoire disputé est plus conceptuel et représente une part de marché.
Seront désormais supprimés tous ceux qui risqueraient d’attenter, par leur simple existence, à la suprématie financière en place. Non plus arrêtés mais ignorés, non plus embastillés mais assignés à résidence, non plus exilés mais bénéficiaires d’aide sociale et de subventions qui ont la vertu tout à la fois de conserver la vie du corps et de museler l’esprit, les citoyens se révèlent être dissidents par le simple fait d’espérer prendre part à la diffusion dans l’espace public. Le chien féroce de la globalisation du bénéfice mord tous ceux qui l’approchent.
Tandis que l’ancienne censure visait le contenu de la pensée, la nouvelle attaque le fait même de son apparition. C’est dire que les possesseurs des moyens de diffusion organisent la disparition de tout ce qui est unique, structuré, consistant, remarquable et exigeant, au bénéfice de la production démultipliée du commun, du vulgaire, du songe-creux et de l’épate-nigaud, sans parler de l’obscène flatterie pour la séduction facile.
Quand un soliconcept est assigné au rang de pilote, la société qui s’adonne à sa gouvernance subit les aléas de la position qu’il ordonne. De tous temps, la faiblesse humaine a consisté en la tentation d’acoquiner la volonté en la soumettant à la passion, elle-même entichée d’un concept. L’on conçoit bien que le comportement d’un individu est influencé, sinon déterminé, par ses représentations. Plus il est dominé par une idée exclusive, plus il trahira cette obsession dans sa conduite, qui sera raide et mesquine. Si tel est le lot d’une personne affectée de sclérose spirituelle, celui de la société dont il est membre ne pourrait être plus avantageux. La circonstance aggravante qui concerne le groupe est que, l’union faisant la force, la séduction semblera plus persuasive. Devenue consensuelle, on la trouvera même plutôt conviviale.
Le soliconcept prévalent à notre époque n’est ni plus ni moins nocif que les idoles qui ont régné en d’autres temps sur d’autres civilisations. C’est son apparence qui diffère. Il a son propre visage et ses composantes matérielles spécifiques. Le début du paragraphe Un de ce chapitre rappelait comment la civilisation occidentale avait développé préférentiellement son information sur la maîtrise de la matière. Les conséquences de cet enrichissement technique se font subir de manières diverses mais inéluctables sur l’existence de tous les étants de la terre. Le caractère bénéfique et l’aspect nuisible de ce “progrès” sont si intimement liés que pour en débrouiller l’écheveau il faut une discipline d’autocritique permanente. Sa méthode consiste en une confrontation perpétuelle de la possibilité matérielle de l’acte avec le souci de sa valeur. Sans cet ajustement incessant de la matière à la métaphysique, l’humain s’engage dans des aventures aberrantes.
En ce qui concerne ce vocable de diffusion, qui est à l’origine inspiré par la liaison cosmique universelle, la représentation soliconceptuelle de rentabilité technologique le rétrécit jusqu’à ne plus signifier que l’organisation de la distribution, dont le contenu est déterminé par le moyen. Le résultat de cet assèchement du sens de la diffusion est significatif : n’existe que ce qui est connu, n’est connu que ce qui est publiable, n’est publiable que ce qui est accessible au plus grand nombre et donc rentable.
L’argument de la censure et le choix des diffuseurs organisent la gestion de la marchandise autour de l’accessibilité. D’abord, la disponibilité physique de l’objet, condition sine qua non de son acquisition, ensuite l’omniprésence massive d’un même type d’objet sont la garantie du profit maximal d’une diffusion globalisée. Ce qui est là, disponible aux yeux du public, doit emporter son assentiment. N’a plus droit de cité la diversité requise par les besoins de publics différenciés.
Le bienfait économique s’autodétruit quand il n’écoute plus que la logique de son argument technique. Parangon du jargon de la rentabilité, ce qui “marche” est forcément nuisible puisque sa raison d’être est insidieusement passée de la communion au sophisme, du commerce à l’autarcie, de l’échange vital à l’autophagie.
L’accentuation actuelle de la diffusion qui porte sur une distribution consensuelle correspond à une attitude d’auto-aveuglement. Elle ne veut voir que la courbe du geste. Elle ignore sa cause et son intention. Pour alerter l’entendement, il faudrait comprendre qu’en réalité les réseaux médiatiques technologiques sont à la diffusion ce que le geste est à la pensée.
Cette capacité conceptuelle que l’évolution de son corps a fournie à l’humain lui donne la possibilité d’agir sur le monde mais aussi la tâche de définir le critère de l’action. L’impulsivité infantile de la passion doit être contrôlée par une adulte responsabilité. La tentation demeure d’infléchir le désir vers la seule avidité, malgré le constat communément admis de la déliquescence et de la nocivité de cette voie. Pourtant, si la tension d’exigence est bien le propre de la nature humaine, nulle malfaisance, même relevant d’une pratique générale, ne pourra entraver ce destin, ce défi.
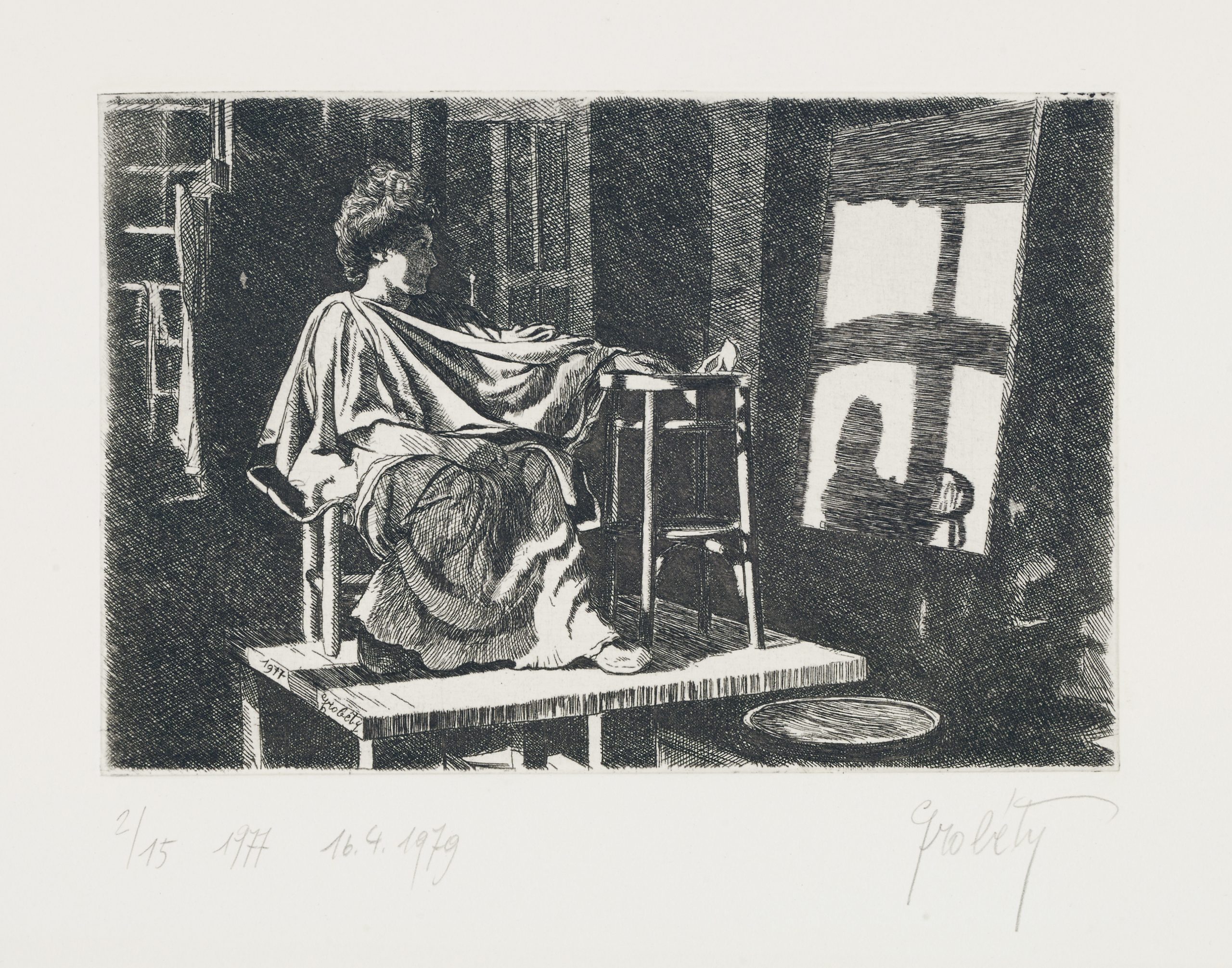
Réel / Virtuel
La définition académique apparaissant au dictionnaire présente l’opposition du réel et du virtuel. Le réel est actuel, effectif et formel tandis que le virtuel évoque ce qui n’est qu’en puissance et possible dans un être réel.
L’étymologie n’oppose pas les deux racines. Res est la chose, l’être, la circonstance, la cause d’une existence ou d’un événement. (Rien, non rem, nulle chose, abolit cette existence.) Virtus est la qualité spécifique dans l’affaire, qu’il s’agisse, virtus arboris, de la valeur d’un arbre, virtutes oratoris des qualités d’un orateur, ou virtus animi, de la vigueur morale ou plus précisément, puisque virtus vient de vir qui signifie « homme », des qualités viriles de l’âme.
L’adjectif virtualis que forge le latin scolastique isole cette qualité morale et permet de nommer cette puissance abstraite qu’est la virtualité. Plus tard, en science mécanique, puis en physique atomique et en informatique, le mot virtuel qualifie une force non matérialisée. Par contre, ce que l’on appelle de nos jours la « réalité virtuelle » est un événement formel. Mais bien que l’image produite par les moyens de l’informatique apparaisse en trois dimensions, cette matérialisation ne concerne que l’optique et ne fait pas intervenir les autres sens qui composent la perception de la réalité concrète.
Dans la représentation commune, ce qui est réel est la substance tangible (et l’on frappe du poing sur la table pour illustrer cette présence physique). Le reste « n’existe pas » et fait partie des créations de l’imaginaire. Pourtant, cette vision claire est naïve puisqu’elle ne tient pas compte du vécu mental qui, pour ceux qui en font l’expérience, est une réalité qui s’impose.
C’est donc autour de la faculté psychique de l’humain qu’il faut chercher, car c’est bien la polarisation de la conscience engendrée par sa puissance d’abstraction qui est la cause de ce hiatus entre l’actuel et le possible. Pour le monde animal, l’existence est vécue physiquement dans un monde concret. Les affects et les émotions procèdent en totalité des aventures du corps et ne produisent d’autre élaboration cérébrale que celle dont les impulsions commandent les réactions physiques appropriées. Il n’existe pas chez l’animal de prospective mentale. La représentation commune du réel serait donc une méconnaissance de la vraie nature de l’humain puisqu’en faisant la preuve du réel par sa dimension effective et formelle, c’est la situation existentielle animale qu’elle décrit.
La cause de cette ignorance de soi provient sans doute de la fonction psychique elle-même et des modalités de sa genèse. Le hasard constituant en œuvre dans le mouvement de la matière procède par bond d’efficacité. Ne demeure que ce qui forme une synthèse cohérente. L’entreprise collective qu’est l’organisme hérite avec un capital acquis la tâche de cultiver ses chances de survie. Le corps est armé pour se défendre. La nature invente des spécialisations qui, pour l’animalité, sont strictement physiologiques. Une autre voie se dessine pour l’humain qui se développe à l’instar du pouvoir constituant de la matière. Sa capacité psychique lui permet d’agir sur la substance matérielle. L’intelligence créative de l’humain ne se contente plus de s’adapter au monde mais cherche à le manipuler.
Ainsi, l’humain est avant tout préoccupé par son action sur le monde. Il voit l’objet, il le façonne et le pétrit. Cette passion créative accapare la conscience au point qu’elle s’identifie avec sa créature, oubliant dans son élan de considérer le processus qui lui permet son geste. Sa capacité d’action sur l’état de substance est pourtant la conséquence de son aptitude à invoquer le possible. Le geste humain qui informe le concret dépend de son pouvoir sur l’abstrait. L’intervention de l’esprit sur le visible est le fruit de sa vision de l’invisible.
Sans l’humain, la réalité n’existe pas. Pour l’animal, l’existence est vécue, mais n’est pas perçue. Le « réel » est un concept fonctionnel de l’esprit, qui a besoin de regarder jouer dans sa main le mouvement provoqué par sa puissance de volonté. La réalité existentielle de l’humain se joue autour de ce pouvoir d’appréhender le possible. La réalité de l’esprit, de l’humain, c’est le virtuel. La cause raisonnable d’une opposition des concepts de réel et de virtuel est que l’humain est le lieu d’un virtuel incarné.
2006

Commentaires récents