XX 20
Dans le passé, les œuvres de nature conceptuelle étaient aussi majoritaires. Si nous avons la nostalgie de la beauté ancienne, c’est premièrement que l’intuition présente opère une purification du souvenir, travaille à conserver la matière des œuvres de valeur éternelle et néglige les autres. Ainsi peut-on expliquer ce mystère de la “postérité” qui juge et rend grâce à des œuvres méprisées dans leur propre temps, leur exprime une approbation que leurs auteurs n’ont jamais connue.
Mais il serait vain de croire que cette appréciation posthume est due au meilleur jugement d’une génération et de mépriser la précédente, moins perspicace. Nos contemporains, à nouveau, n’ont d’yeux que pour les hochets de la mode et sont aveugles à ces œuvres essentielles qui agissent et sont la structure de l’époque.
Il faut le regard immémorial de l’intuition, qui ne se souvient pas, qui ne compare pas, mais revit l’émergence de l’être au monde, pour rendre justice à ces œuvres qui lui profitent. Les découvreurs sont aussi rares que les inventeurs et leur rôle tout aussi méconnu par la reconnaissance publique qui, plus tard, s’approprie le bien.
La mémoire de la doxa tourne donc naturellement les yeux vers le passé quand elle évoque la beauté. Le présent est occupé par les concepts d’utilité. La puissance de volonté est accaparée par les désirs existentiels. Les présents de tous les temps ont subi l’attraction prépondérante du concept qui nourrit les corps, amuse les esprits, thésaurise les connaissances. Cette activité fort légitime tend à occuper tout le champ de conscience. L’on est si bien établi, si bien sécurisé par la richesse de la fortune conceptuelle qu’on croit la posséder en droit quand on en jouit en fait. On oublie que la récolte des fruits est fonction de l’existence de l’arbre.
Cette propension conceptuelle qui est la force de l’être humain est aussi sa faiblesse quand elle s’isole dans sa vertu et se prend pour le principe créateur. Toutes les époques ont subi l’entraînement de cet orgueil du concept, les objets d’art de toutes les civilisations en portent la cicatrice, plus ou moins profonde.
L’intuition présente qui cherche la beauté est détournée par le concept qui la transforme en objet et la “trouve” dans le passé. L’on vivra dans le regret à moins de résister à cette illusion en dépassant tous les concepts passés, présents et à venir, en référant l’apparence concrète changeante à la vérité de son essence qui n’est pas, selon le concept, l’acte dans sa matérialité, mais selon l’intuition, est la capacité à faire choix de l’acte.
Mais il est une deuxième raison qui aujourd’hui nous incite à ne “retrouver” la beauté que dans les performances du passé. C’est que la prolifération des concepts, en même temps qu’elle offre (à certains) une vie matérielle plus satisfaisante, donne une tâche plus lourde à l’esprit qui veut se constituer dans son être.
Pourtant, ce n’est pas dans un contrat social, ni dans un paradis de confort, ce n’est pas au bout d’un devenir idéologique ni par l’exploitation de la science que l’existence humaine peut se trouver un territoire.
La beauté ne peut apparaître que dans la vision de la vérité, par le travail forcément douloureux de la parturition de l’être, le déchirement de la chair qui veut naître à l’esprit.
L’attitude conceptuelle opine que sa technologie peut alléger la tâche. Mais elle raisonne à contre-sens parce qu’elle demeure au stade de la matière substantielle. Elle comprend le caractère du beau par ses manifestations singulières et croit avoir occis la beauté en révélant la valeur esthétique du laid.
Mais Quasimodo sait bien, lui, qu’il est laid. L’œuvre Quasimodo est belle par la forme que lui a donnée son auteur. La laideur objective du personnage prend valeur esthétique par le traitement poétique, ou valeur morale par le triomphe d’autres belles qualités qui changent le centre de gravité de l’individu et rétablit l’harmonie globale de son être.
L’attitude conceptuelle raisonne à rebrousse-poil et cherche le sens dans le nombre et la diversité des possibles. Tout ce qui frappe les sens, interpelle ou choque est déclaré artistique. La vertu conceptuelle est la volonté de valoriser l’aspect intriguant, mystifiant, voire désorientant de la matière. Elle est satisfaite quand le bon sens est livré à l’épreuve du labyrinthe. Quand la sensibilité se plaint d’être abandonnée sans repère, l’attitude conceptuelle s’applaudit et crie au génie parce qu’elle croit avoir trompé des habitudes et révélé la subjectivité à elle-même. Le concept réclame de la sensibilité qu’elle sécrète la substance de son événement et ce qu’il obtient, c’est de faire sombrer le sujet dans un solipsisme désespérant où chacun a sa vérité, certes, parce que le moi est clos sur lui-même, n’est plus instruit que par ses propres concaténations, n’a plus accès à d’autre réalité que soi-même et se consume dans l’autophagie.
L’attitude conceptuelle déterminait de nombreuses œuvres du passé qui misaient sur la signification spectaculaire de leur thème plus que sur la nécessité formelle, mais la perversion spécifique de ce qui s’appelle l’art conceptuel aujourd’hui, c’est qu’il se définit par une intention diamétralement opposée à la pratique de tous les autres arts qui organisent la matière.
Au lieu de voir le sens intuitif trouver expression par la forme, la doctrine de l’art conceptuel prétend que le sens est issu de l’installation matérielle. Cette hypothèse justifie la recherche maniaque de la nouveauté, des inventions les plus incongrues, l’absence de toute forme (tableaux blancs, musique sans son, poème sans parole) et même l’absence de tout objet, si vide soit-il, puisque le sens est construit par la déposition du concept (extensible et malléable à souhait puisqu’il est abstrait).
Le caractère pathétique de cette position est qu’elle singe la théorie de la forme en la prenant à l’envers. Le concept a bien vu que le sens du poème ne résidait pas dans son thème mais dans son corps matériel. Mallarmé répondait à Degas qui se plaignait de ne plus avoir d’idées : “Mais ce n’est pas avec des idées qu’on fait un poème, c’est avec des mots!”. Le concept a bien entendu la leçon, mais il l’applique avec ses moyens. Selon sa nature d’intendant de la matière, il ne voit pas la différence entre le mot et la chose et “installe” des objets pour faire du sens. Il croit que l’assemblage de ces objets sera signifiant puisque ces objets ont un sens, mais il ne tient pas compte du fait qu’ils ont déjà le sens et seulement le sens de leur situation concrète et existentielle. Le sens conceptuel de l’installation aboutit à la plus grande confusion. (Une poubelle a-t-elle le sens de l’ordure qu’on jette ou de la propreté qu’on entretient ? ou bien encore son profil stéréotypé de poubelle évoque-t-il le gâchis de la consommation outrancière ?).
L’attitude conceptuelle raisonne à vide parce que ses prémisses n’ont pas d’assises.
Pour que l’œuvre ait un sens, il faut qu’il soit inexprimable, il faut donc supprimer tous les sens qui le sont.
Périodiquement, les purs esthètes, les artistes de tempérament, les vrais révolutionnaires, opèrent la sauvegarde de l’art. Ils le désembourbent de ses théories. Les querelles de “l’art pour l’art” sont des ratiocinations de l’attitude conceptuelle. Le véritable art engagé est celui qui est vivant et un objet d’art n’est vivant que si son but est la délectation, en premier lieu de l’artiste lui-même. Son but est de laisser la preuve de la conscience humaine. La délectation est le lieu essentiel du drame de la rencontre du sujet et de l’autre. La rencontre, tout à la fois dangereuse et délicieuse, est la seule réalité. Les théories peuvent servir à l’expérience mais quand elles se complaisent en elles-mêmes et qu’elles se détournent du réel, elles trahissent cette intention transcendante qu’est l’art.
Dans l’œuvre s’affirme un être-à-soi capable d’altérité.
Dans tout art conceptuel, qu’il soit abstrait, figuratif ou concret, l’être est indifférent. C’est une tentative d’expliciter l’être-au-monde en ignorant ce sur quoi il est fondé. Le sujet “disparaît” devant “le surgissement de la réalité”, voilà le dogme qu’il proclame. L’art conceptuel se meut dans l’horizon des sciences et en adopte servilement la manière. Il croit se contenter de démontrer les structures ontiques du monde. Il veut copier la démarche scientifique qui se fie et se fonde sur ses objets et féconde ses modes de procéder. Mais l’art conceptuel s’en tient au concept, aplatissant l’objet sous le concept, il traite l’objet comme un concept et prétend que l’objet est le concept.
L’œuvre vise l’entente de l’être et clarifie ontologiquement ce qui peut être révélé ontiquement. L’œuvre est un autre regard, qui utilise le concept pour considérer ce qui est différent. L’œuvre ne parle ni de l’énoncé ni de l’objet, elle concrétise le rapport énoncé-objet. L’art n’a pas l’être substantiel d’une chose ni l’être abstrait-concret, mental, du concept. L’art dit l’indicible de l’être. L’art est le miroir de la méta-présence.
Notre vieux langage et notre antique Raison se méprennent sur le sens du mot métaphysique, ils sont attachés à leurs habitudes et détestent qu’on les dérange. Il faut respecter la tranquillité des vieillards mais l’esprit humain souffre aussi de l’âge quand il se laisse embourber dans la décadence de la société où il a les pieds historiques.
A son commencement, il a su affirmer sa conscience. Mais qu’est ce que la conscience ? Les racines de notre langue montrent que conscientia vient de cum-scire qui signifie savoir et porter un jugement sur l’objet. La conscience évalue et agit en fonction de cette appréciation. La conscience cherche à savoir, étudie, veut apprendre. Connaître, cum et gnosco, c’est apprécier un objet réel ou vrai, concret ou abstrait, physique ou mental. La connaissance, c’est la capacité de former l’image de quelque chose, de manière précise ou imprécise, mais toujours pertinente (en ceci opposé à “croire” qui n’implique pas nécessairement d’être vrai.) Pour connaître, il faut apprendre, c’est à dire prendere, saisir occuper, atteindre.
L’activité de la conscience est donc de prendre, de s’emparer d’un objet et de le connaître pour survivre. Cela ne se passe pas sans drame comme en témoigne le sens du substantif venant d’apprehendere. L’appréhensibilité est la puissance de pénétration qui permet de voir immédiatement le danger. Mais l’appréhension signifie à la fois le fait de saisir la connaissance et la crainte d’envisager ou d’affronter ce qui est encore à connaître.
Se distinguant de l’animal qui connaît, apprend, comprend, appréhende etc… l’être humain est capable de dire. L’art (conceptuel) est la parole qui illustre la conscience de quelque chose. L’animal a conscience du monde et sa conscience est fonctionnelle. L’humain, qui est-au-monde, explicite sa conscience par les sciences, la technologie, l’art de vivre. Tous les arts (conceptuels) illustrent l’objet matériel de la conscience.
Mais le fait majeur qui fait advenir l’humain, c’est de prendre conscience. Les vrais artistes sont ceux dont l’œuvre réitère cet acte premier qui ouvre à la conscience et l’active. Car le propre de la conscience humaine est de transcender sa condition biologique. L’être humain ne se contente pas de saisir ce qui est utile à sa survie physique, il cherche à nourrir la vie de son esprit. Sa conscience cherche à savoir ce qui n’est pas matériel, ou plutôt faudrait-il mieux dire qu’il cherche à connaître l’état dont est issue la matière telle que nos sens peuvent l’appréhender.
Les vrais artistes sont les scientifiques de la conscience. Les autres, les artistes conceptuels, appliquent les découvertes. Ils sont techniciens ou technologues.
Il y a donc malentendu sur la notion d’art métaphysique. A cause de l’époque où la conscience humaine projetait sa subjectivité créatrice sur une image de dieu et parce que les artistes du temps utilisaient forcément ce thème, la représentation générale a continué d’accoler le mot métaphysique au religieux et au “mystique”, annotant ainsi une attitude d’irréalité.
Il faut penser au contraire que le métaphysique est éminemment réaliste, mais d’une réalité qui précède la matière, la matière substantielle étant le support actuel immanent de nos existences corporelles.
Notre héritage peut provoquer un autre contre-sens. La philosophie idéaliste et platonicienne avait formulé que l’essence précède l’existence. Il s’agissait bien là d’une intuition de la vérité, à condition de ne pas pervertir la formule par une invention conceptuelle en chosifiant l’essence sous la forme d’un dieu ou d’une idée.
La philosophie moderne a réagi à cet état de fait en rectifiant que l’essence se fonde sur l’existence. Cette formule est aussi vraie dans le sens où Maître Eckhart disait que Dieu a besoin de moi pour être. En déconnectant le concept qui avait matérialisé l’essence, la pensée moderne insistait sur la responsabilité effective de l’existence subjective pour féconder l’essence.
La mauvaise foi attisée par le concept en conclut que la forme existentielle de la matière détermine et change la “manière d’être” de l’essence (ce qui est une absurdité, puisque l’être n’a pas de “manière”). Continuant sur leur élan, les tenants de “l’art conceptuel” – qui se dit avant-garde de la fin du XXe siècle – affirment que l’art a maintenant changé de propos.
Ce faisant, ils démolissent les deux niveaux, celui de l’art-teknê, issu de la conjointure du monde et lié à l’utile, aussi bien que celui de l’art de la méta-présence qui en est la dimension verticale et montre la structure ontologique de l’être.
Tous les arts qui utilisent (plus ou moins) le concept mais œuvrent sur la structure ontique des choses et des personnes enrichissent et diversifient notre préoccupation au monde.
Celui qui se veut conceptuel (et ne mérite donc pas le titre d’art) rétrécit le jeu de nos facultés jusqu’à les rabattre à la seule “idée”, abondamment prolixe mais stérile.
Tous les arts-tehnê figurent les arbres de la forêt, les nuages et le ciel qui sont les témoins impuissants d’un drame : “l’art conceptuel” figurant les parents impécunieux du Petit Poucet qui vont le perdre pour ne plus en avoir le souci.
L’œuvre de la méta-présence restitue ce souci par l’agence des petits cailloux blancs qui lui permettent de se prendre en charge et de retrouver son chemin vers la vie.
L’Art constitue l’être.

XX
Oh! Le bon élixir
savourant dans mes veines
la canaille lumière
après la fleur médusée
du morne désespoir couperosé.
Inouï jaspé de monotone
après quelles délices
où conjugués de cris et de soupirs
affleurent, ceints d’une unique candeur
le mirage immutable et comme
embué des effluves du temps
et l’ivoire lunaire vibrant
en les couleurs d’automne.
Oh! Le combat sacré
quand la peur est comme
un sabre au clair
et les odieuses machinations
ululant le mensonge et crachant
le venin des ennemis rampant
piètre concert de vers luisants
évanouis, tronçonnés, mesurés,
bénis par le sceptre royal
de sa gracieuse alcoolique et divine majesté.
11.1975
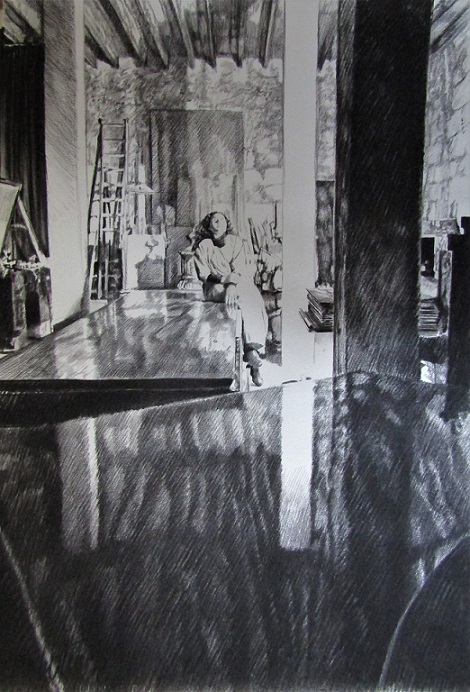
Métaphore
Le mot vient du grec, et signifie trans-port. La métaphore, classée par la rhétorique – ou technique de mise en œuvre des moyens d’expression du langage – dans la catégorie des tropes, est un procédé qui consiste en un transfert de sens.
On observe que l’emploi des figures est général dans tout discours, mais plus ou moins intense et l’analyse distingue une cinquantaine de tours dans les figures de mots, comprenant les figures de diction comme l’apocope (ex : photo, kilo, métro), les figures de construction comme le pléonasme, les tropes (concernant la signification du mot) comme l’allégorie, la métaphore, l’hyperbole, la métonymie ou la synecdoque … et autres figures non réductibles aux trois premiers groupes comme l’allitération ou l’onomatopée. Les figures de pensée qui sont des modes d’expression stylistiques forment un classement aussi nombreux et l’on y trouve entre autres la périphrase, l’apostrophe, la réfutation, la concession, la litote, l’exagération, l’imprécation ou la prosopopée.
Ces figures de style comprennent aussi les tropes comme la catachrèse, la synecdoque ou la métonymie. La catachrèse détourne un mot de son sens propre, mais cette métaphore devient le sens usuel, comme dans les ailes d’un château. La synecdoque prend le plus pour le moins, la matière pour l’objet, l’espèce pour le genre, la partie pour le tout, le singulier pour le pluriel ou inversement. La métonymie (du grec ônôma, le nom) exprime un concept au moyen d’un terme désignant un autre concept … unis par une relation nécessaire (la cause pour l’effet, le contenant pour le contenu, le lieu ou le producteur pour la production, le signe pour la chose signifiée…) La métaphore désigne un objet du nom d’un autre objet présentant avec le premier des rapports d’analogie.
Tous ces tropes procèdent de « la ressemblance établie entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents », ce qui est la définition même de l’analogie.
Cette définition met en scène le drame du langage en décrivant la posture de l’esprit. Le tableau présente l’imagination considérant des objets différents. Ce jugement implique une évaluation et c’est un acte vital. Pour qu’un organisme, en effet, trouve la subsistance propre à satisfaire son intérêt, il est essentiel qu’il différencie les objets qu’il découvre dans son monde. Cette performance est celle de l’intelligence animale qui réagit pour assurer son existence ; c’est un acte de portée physique dans un univers de matière substantielle.
L’esprit apporte une autre dimension à cette réaction existentielle. L’humain voit les objets et porte son intérêt sur leurs rapports structurels et non plus seulement sur l’éventuelle et immédiate utilité qu’ils présentent pour sa survie physique. La définition de l’analogie citée plus haut est donc un pléonasme qui s’ignore puisque c’est l’imagination qui toujours découvre les affinités, les correspondances, les parentés, les relations qui sont à l’œuvre dans les choses et invente un objet de pensée qui les fixe en sa main.
Cette puissance de saisie abstraite va permettre la technique qui est la capacité, non pas seulement d’utiliser un outil comme certains animaux peuvent le faire, mais de le fabriquer par le jeu d’une analyse des propriétés, c’est à dire des caractères du possible de la matière.
L’acte de pensée qui consiste à écrire le chiffre du lien qui unit toutes les choses de l’univers est donc proprement le fait de la puissance conceptuelle humaine. Mais le succès même de cette puissance outrepasse son efficacité : l’esprit tend à confondre l’objet qu’il voit avec l’objet de pensée qu’il conçoit et prend le mot pour la chose. En accordant une nature quasi-substantielle à un « objet de pensée » qui permet de les différencier, le langage court le risque de masquer sa fonction essentielle qui est d’affirmer l’Un dans le Multiple.
Les poètes ne s’y trompent pas et c’est Paul Valéry qui note dans Variété : « Dans l’ordre du langage, les figures, qui jouent communément un rôle accessoire, semblent n’intervenir que pour illustrer ou renforcer une intention, et paraissent donc adventices, pareilles à des ornements dont la substance du discours peut se passer – deviennent dans les réflexions de Mallarmé, des éléments essentiels : la métaphore, du joyau qu’elle était ou de moyen momentané, semble ici recevoir la valeur d’une relation symétrique fondamentale. »
L’étude étymologique des mots enseigne qu’ils vivent tous de la métaphore, c’est à dire du transfert de sens. Mais elle montre aussi qu’à l’origine du langage se trouve la figure d’une activité physique essentielle à la vie.
Toute la puissance conceptuelle du langage et sa virtualité ne peuvent être utiles à l’humain que s’il se remémore que le corps est le lieu de l’esprit.
2006
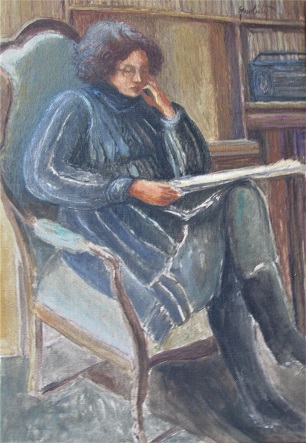
Commentaires récents