XIX 19
Tous ceux qui parlent d’art (avec un grand A) seraient bien étonnés de s’entendre dire qu’ils agitent en l’air un concept qui n’a pas plus d’existence que les chimères de nos aïeux.
A leur étonnement succéderait une superbe colère envers ces propos iconoclastes, dénigreurs et destructeurs de la Grandeur et de la Beauté.
Tous ceux, par ailleurs, qui citeraient la phrase disant que l’art n’existe pas sans l’accompagner de son contexte seraient coupables au titre de ces malfaiteurs qui cachent leur main gauche pour qu’elle ignore ce que fait leur main droite.
Il s’agit maintenant de calmer ceux à qui l’on a crevé la bulle de l’art en les assurant qu’ils n’ont rien perdu d’essentiel. Quand je parlais d’art, autrefois, par mimétisme culturel, je croyais bien savoir de quoi je parlais. Je voulais nommer une valeur suprême, un idéal de beauté, de liberté, la garantie de la vérité. Je ressentais par l’évocation de ces vocables une élévation de tout mon être. Et je ne savais pas que je parlais précisément de rien, car je maniais dans mon esprit un concept indifférencié, réceptacle mental susceptible d’être rempli selon les directives du muséologue de service, le décor et le mobilier changeant avec chaque fonctionnaire.
L’art en général n’existe pas, mais il est nécessaire d’utiliser le concept pour exprimer certaines idées pratiques comme par exemple “la critique est aisée, mais l’art est difficile”.
Car, bien sûr, nous croyons toujours que l’art est la première activité humaine. Si nous sommes obligés de bousculer le concept d’art, c’est parce que dans sa nature d’abstraction, il a obligeamment accommodé tant de choses disparates que, dans ce fouillis monstrueux, il n’est plus possible de s’y reconnaître.
Il ne faut pas s’étonner de ce travail du philosophe qui doit toujours recommencer à définir sa tâche. Concept se moquera de Sisyphe qui roule son rocher jusqu’au sommet de la montagne bien inutilement puisqu’il retombe aussitôt. Mais quand le mythe de Sisyphe est ressenti comme le symbole de l’absurdité de la condition humaine, c’est qu’il est considéré par un penseur conceptuel qui ne voit que par la matière. A moins d’utiliser le mot à la façon paradoxale de Camus* qui définit la “création absurde” comme “cet exercice de détachement et de passion qui consomme la splendeur et l’inutilité d’une vie d’homme”. Et Camus de conclure : “il faut imaginer Sisyphe heureux”. Pour Intuition, l’intérêt de la vie consiste à refaire pour son propre compte un parcours ancien comme si c’était la première fois. En effet, tout le monde “recommence” à respirer et à manger tous les jours et personne ne se plaint de monotonie.
L’art est aussi nécessaire à l’être humain que la nourriture. L’ingestion d’une mauvaise nourriture lui est tout aussi nocive que la pratique d’un mauvais art.
Nous savons que le mot art décrit les objets fabriqués par les humains en honorant la meilleur technique. La conscience humaine se découvre en créant le signe. L’esthétique (la saisie du sensible) trouve par la technique (équilibre et harmonie) un moyen de dévoiler la beauté qui est la vérité de l’union du sujet et du monde.
Le premier artiste (le premier humain, homme ou femme) affirmait la puissance de sa volonté (sa liberté) en nommant par le signe (parlé, chanté ou dessiné) l’être-là du monde qui le concernait au plus haut point (la terre, le soleil, le bison etc …)
Devant cette apparition, il était pris d’une terreur sacrée : il constate que sa créature le regarde. A partir de là, il commence à objectiver l’événement, il forme des concepts qui acquièrent une existence autonome (à ses yeux) et qui ne vont cesser de proliférer à tous les niveaux, d’abord, les forces qui se développent autour de ce regard et qui vont devenir le domaine de la magie, de la religion, de la pensée autour de ce qui lie son destin. Également, les forces de la matière dont il a usé pour accomplir le signe et qui vont se parfaire en technique et en science.
Nous disposons actuellement d’une multiplicité innombrable de concepts philosophiques et scientifiques, mais nous sommes toujours ce premier être, auteur du premier regard et créateur du premier signe.
C’est là notre essence d’être humain, qui ne relève ni de l’espace ni du temps.
Notre existence est quantitativement dépendante du concept qui modifie nos manières physiques et mentales d’être au monde.
Le grand Art est un concept qui évoque notre capacité originaire. Il n’a d’existence que par la grâce matérielle de ces œuvres qui revivent ce premier regard. La valeur de l’art est métaphysique.
La vie des concepts se déroule dans le temps linéaire. Ce monde- là est susceptible de progrès par la logique inhérente à la matière dont les états se succèdent généalogiquement. Le progrès figure une marche, un déplacement et n’inclut pas en soi de jugement qualitatif. N’est pas forcément meilleur ce qui advient plus tard, sinon pour le désir qui n’use du présent que pour enfanter l’avenir. La vérité de l’existence est la croissance, la progression vers son ultime développement qui se parfait en la mort.
L’être n’a pas part à ce cycle matériel.
L’acte de conscience n’est pas de même nature que la pensée réfléchie. La Raison issue de cet état d’intuition invente “l’éternel” pour nommer cette différence, mais comme elle le fait par le moyen d’un langage conceptuel, ce qu’on obtient est la notion d’un temps indéfiniment étiré. L’art est le seul langage qui donne accès à cet acte de conscience qui n’appartient pas au temps et qui est l’acte fondateur de l’humain. C’est le paradoxe de l’art de pouvoir donner à une matière la nature de l’esprit.
Plus un objet s’éloigne de cette intention fondatrice, plus il dénature l’art.
Cependant, parmi les objets (matériels ou psychiques) créés par les humains, il en est qui ont d’abord une fonction utilitaire. Le potier, le tisserand, le forgeron, le menuisier fabriquent des objets qui ont la qualité esthétique de leur technique. Pour les techniques les plus raffinées, de nouveaux noms de métier seront englobés sous le titre “artisanat d’art”.
Les concepts techniques, engendrant en s’adaptant aux besoins qu’ils suscitent, vont créer de nouveaux domaines d’application, tous aussi susceptibles de correspondre aux critères artistiques : une maison, un pont, une voiture, un avion et les autres produits de l’art industriel peuvent être beaux s’ils sont pensés en fonction de l’harmonie.
Mais pour chacun, l’harmonie consiste en l’ajustement le plus précis de toutes ses fonctions. Que penser d’un cercle dont tous les points de la circonférence ne seraient pas équidistants du centre ?
La nature humaine, physique et mentale, a besoin de cette cohérence, elle vit de l’équilibre entre ses parties. Le contraire de la beauté n’est pas la laideur, à laquelle on pourrait donner un qualificatif d’infériorité sur l’échelle du beau.
L’inverse du beau est le nuisible.
Pour l’esprit humain, le nuisible est d’établir le concept au rang de valeur alors qu’il est un moyen.
L’ébéniste veille à poser son ciseau pour qu’il aille dans le sens du bois. Le beau métier consiste à cultiver le geste qui va concilier les vertus de l’instrument et du matériau. L’apprenti insouciant qui ne chercherait pas l’humilité de la maîtrise et prendrait le bois à contre-fil provoquerait un désastre : il ferait éclater le bois et ruinerait l’ouvrage déjà fait.
Quand nous disons que l’art n’existe pas, c’est pour insister sur une question de méthode, car la pensée qui part du concept est une pensée qui travaille à contre-fil et produit les conséquences inévitables. L’intelligence conceptuelle tient lieu pour les humains de griffes et de venin. C’est l’instinct qui commande au lion de sortir ses griffes et au scorpion de piquer. C’est la tendance instinctive qui propulse l’acte et anime les mouvements organiques.
Au niveau humain, l’apparente autonomie du moyen qu’est l’intelligence conceptuelle provient de sa capacité à modeler la matière.
Observons le phénomène.
La capacité de fabrication d’un outil est la première conquête de l’espèce Homo. Le sinanthrope, le pithécanthrope étaient artisans et techniciens. Quelques instants cosmiques plus tard, l’homo sapiens se dote de la pensée abstraite. Il invente l’art. Nous en avons trouvé les traces dessinées ou gravées sur les parois des grottes. Et même quand il fabrique un objet usuel, son caractère déborde le seul aspect utilitaire.
L’impulsion provient, comme pour son ancêtre, de l’instinct, cette force qui assure et trouve les moyens de la survie. Mais par la mutation de l’homme moderne, l’instinct s’est différencié dans le couple Intuition-Concept.
L’idée de fabriquer provient donc de l’intuition. L’idée donne le sens de l’acte à venir. Le sens est fondé dans l’idée mais l’objet créé prend son sens réel dans le motif de sa matérialité. La réalisation de l’objet s’organise autour des pôles de l’esthétique et de l’utilitaire. Les combinaisons de ces deux éléments sont infinies mais pour la clarté de l’argumentation, il convient de simplifier le classement : l’utilitaire combiné à l’esthétique est l’artisanat d’art, l’objet d’art relève de l’esthétique pure.
A l’intérieur de ces deux modes, l’aventure se déploie suivant les axes du concept et de l’intuition. Dans les deux cas, pour l’art et pour l’artisanat, la réalisation de l’objet va se nourrir de l’expérience culturelle. Mais il y a deux façons d’en profiter. La première est de la revivre par l’intuition, en refondant le matériau culturel pour forger de l’unique. La seconde est de procéder par imitation en instituant une copie conceptuelle d’un modèle original. Cette deuxième manière produit des objets de valeur inférieure puisqu’elle se contente de racoler des concepts disparates (l’horreur de Frankenstein peut en être le symbole) au lieu de faire naître un être authentique à partir des matériaux naturels de base.
En ce qui concerne le thème de l’objet, il existe aussi une infinité de références possibles au concept et à l’intuition. Il est possible de concevoir un objet d’art (non utilitaire) qui relève pourtant d’un concept d’utilité, c’est à dire dont le thème ou le motif sont dépendants d’un concept nommable, décoratif, ludique ou intellectuel, par désir ou volonté d’information et de réformation morale, politique ou scientifique.
De toutes ces observations sur la motivation et la technique d’un artefact, l’on peut dégager la formule suivante : plus la part du concept y est grande, moins l’objet a de valeur.
La “valeur” définit en effet la qualité de ce qui est le plus précieux, ce qui “n’a pas de prix” étant la vie et pour un être humain, la vie de l’esprit.
Le concept absolu de l’art se réfère donc de ce qui est le plus “utile” pour l’esprit humain et qualifie ces œuvres qui en opèrent l’éternelle création.
Ce qui s’y passe agit en amont de l’intelligence conceptuelle. Ce n’est donc pas elle qui peut en être témoin.
Dans les images de l’arbre et de la rivière, on peut voir le rapport de l’essence à la matière, de l’unicité au multiple, du principe premier au nombre indifférencié. Les racines et la source ne sont pas là où s’étalent le ramage et la rive.
Ceux-ci sont accessibles au concept qui nomme, décrit, calcule, construit, modèle, transforme ou détruit.
L’enracinement ni la source ne sont localisables. Si l’on coupe quelques racines, l’arbre en fera repousser, si l’on obstrue la source, elle ira jaillir un peu plus loin.
Mais peut-être restera-t-elle souterraine et dans ce cas, l’on pensera l’avoir fait disparaître. On peut arracher l’arbre, on n’aura pas touché l’enracinement. Ce qui est le plus visible n’est pas l’être : on voit mieux la rivière que la source, on pense à la ramure d’un arbre plus qu’à ses racines, mais les feuilles ne peuvent être sans les racines, la rivière n’existe pas sans la source.
Les œuvres d’art sont myriades qui forment le corps analogique aux feuilles. Beaucoup plus rares sont celles qui s’apparentent aux racines.
On peut trouver grand intérêt à ces objets (dits, peints, écrits, chantés, modelés ou sculptés) qui exposent et développent une technique et un thème de nature conceptuelle. Leur utilité, variable selon l’éminence de leurs qualités matérielles, sera décorative, instructive, ludique, thérapeutique dans l’ordre de l’esthétique, de l’information, du jeu, de la critique morale, sociale ou politique. Elles ont toutes place au sein de la communauté, car elles expriment ses états et répondent à ses besoins.
Mais leur existence est fondée sur celle de ces œuvres qui relèvent de l’intuition. Celles-là n’ont pas la même apparence car elles n’ont pas la même nature. On peut les reconnaître à ceci que leur sens n’est pas directement exprimable par un concept (idéal ou formel), car elles ne sont pas construites en forme de rébus.
D’abord, comme on dit en jargon de métier, elles sont bien foutues. C’est à dire qu’elles paraissent simples parce qu’elles sont le produit d’une technique maîtrisée qui parvient à un bonheur d’équilibre sans effet ni tension et qui pourtant ne repose pas sur des règles définissables.
Ensuite, elles ne signifient rien d’autre que ce corps harmonieux, qui l’est par les moyens parfois les plus dissonants.
Ces œuvres-là, quand elles apparaissent, déconcertent en général. Elles sont inquiétantes parce qu’elles proposent à l’esprit de sortir du limon de la terre et toute naissance est souffrance. C’est un regard et un appel. L’intelligence conceptuelle ne peut y trouver prise puisque ce qu’elles proposent à voir est encore à créer. Chaque instant de l’histoire humaine est une création. Le repos est dans le mouvement. Les apparences historiques sont différentes mais l’élan est le même.
On ne peut les vouloir, l’individu qui les porte ne peut faire accéder leur apparition que par une ascèse totale qui fait fi des limites de sa personne et l’écartèle pour accueillir la force dont il peut supporter l’intensité. Il est donc des œuvres plus ou moins vives selon la trempe de leurs auteurs.
C’est parce que nous disposons actuellement d’une multiplicité innombrable de concepts philosophiques et scientifiques que la tâche de l’artiste visionnaire est de plus en plus difficile. Il faut voir à travers l’écran de toutes ces couches dogmatiques.
L’artiste de la première génération fondait l’humain en exerçant le premier regard. Pour le fixer, il inventait le concept.
Les générations suivantes doivent réinventer l’humain car ce qui n’est pas inventé à nouveau périt.
Mais plus le bagage de concepts croît, plus on a tendance à croire en la primauté de son rôle. L’artiste qui parvient cependant à plonger aux abîmes primordiaux et recouvre le premier regard fait figure d’hérétique.
L’histoire du mot est édifiante : le mot grec hairen signifiait “saisir, prendre”, ce qui est le premier geste de l’organisme individuel. Mais saisir implique un choix, hairesis devient l’expression d’une opinion particulière. Le latin haeresis est la doctrine. Le mot doctrina provient du verbe docere, enseigner. Ce qu’il convient d’enseigner est fixé par le concept en dogme, c’est à dire ce qu’il faut croire et penser.
C’est ainsi que le concept en arrive à traiter le regard d’intuition d’hérétique, de rebelle et de dissident.
Le sens qui provient ainsi de l’intuition, de l’inconscient est originaire, éternel et universel.
Pourtant, dans le cours de son existence historique, lorsqu’elle aura eu le temps de modifier les yeux de ceux qu’elle doit nourrir, l’œuvre pourra cependant se laisser appréhender par le concept.
C’est l’épreuve du classement, dangereux non pour l’œuvre qui ne perd rien de son acuité, mais pour ceux qui croiraient avoir ainsi piégé son sens et deviendraient aveugles et sourds à sa voix.
Aussi nécessaires à la vie de ce qui est humain dans l’humanité que les fondations pour l’équilibre d’un édifice, ces œuvres originaires attirent d’abord peu l’attention. On prend appui sur elles, mais en surface on est préoccupé par les caractères de rentabilité sociale qui s’imposent à la vue. Les tempêtes du temps pulvérisent ces orgueilleuses constructions. Les assises demeurent, sur lesquelles on peut édifier à nouveau. Les œuvres fondatrices jettent les bases de la pensée à venir.
Les élaborations structurées par le concept se figurent “être de leur temps” alors qu’elles dépensent un capital acquis.
*Albert Camus. Le mythe de Sisyphe. Essais.
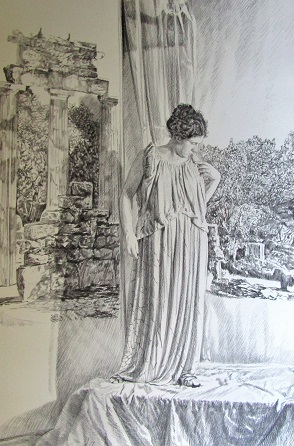
XIX
Si tant est que le faisceau
poussin de mes soucis
et le prisme violet de colères
endiguées par les larmes sanglots
de nacre toute bleue
et ces humeurs givrées
dans leur jeunesse rose
qui tournent par l’orange diapré
au carmin noir des vêpres sages
et les ennuis moussus
tachés de gros marrons piquants
et la blonde tendresse
auréolée du doux gris du secret
si tant est que le jour vire et volte
à ce rythme fantasque
Ah! Que n’ai-je assez d’yeux pour y voir…
22.8.1975

Liberté
Pour cerner le concept de liberté, on peut le confronter à celui de volonté. Le bon sens pratique cette approche ingénument quand il affirme que je suis libre si je fais ce que je veux. Mais dans cette formule qui lui fait prétendre atteindre la liberté par l’exercice de la volonté, le bon sens est victime d’une illusion fatale.
Dans le non-lieu global qu’est l’univers, l’interaction est permanente et les changements d’état continus. L’apparition ponctuelle d’un phénomène ne l’isole pas de cet indivisible. L’organisme constitué est à la fois une entité particulière et l’émanation d’un tout indifférencié. Cependant, dans sa qualité momentanée de matière sensible, il présente des caractères uniques et c’est la trajectoire et le projet de son existence de les tenir et de les conserver. Ce désir essentiel est affirmé par la volonté.
L’animal veut sa vie. Pour ce faire, il doit vaincre les obstacles et triompher des forces adverses. Sa volonté œuvre pour le libérer des contraintes, mais sa survie n’est pas absolument déterminée par la privation de liberté. Pour la vie animale, la liberté correspond à l’accès possible d’un plus vaste territoire et à l’auto-subsistance.
La notion de liberté comme absence de contrainte vaut aussi pour l’existence humaine, mais elle y engendre une confusion essentielle. L’argument suit la voie de la volonté qui œuvre pour la vie et qui se satisfait de son acte. La liberté correspondrait à la réalisation du désir. L’on aboutit à la croyance impétueuse de la jeunesse qui se sent libre quand elle suit l’impulsion de sa fantaisie.
Cette appréciation de la liberté est légitime et bien-fondée en ce qu’elle correspond à la maturation de l’individu qui doit vivre son indépendance, mais elle opère un raccourci qui ignore la spécificité de l’humain. La différence essentielle entre l’animal et l’humain réside dans sa fonction neuronale qui lui permet de vivre un acte psychique. Chez l’animal, l’acte cérébral et l’acte moteur sont confondus. Il existe chez l’humain une « dérivation » qui ouvre à l’activité cérébrale un autre champ d’action. Au désir et au plaisir physique de l’animal s’ajoute un appétit pour la jouissance de ce nouveau pouvoir. L’animal vit son corps, l’humain vit son corps par son esprit.
Pour l’humain, la volonté devient une force complexe, elle n’est plus cet élan unitaire qui contenait l’acte animal. On pourrait dire que l’animal n’a pas besoin de vouloir puisque son acte est porté par l’instinct. Au contraire, l’humain, de par l’amplitude et la diversité de son pouvoir, sent son élan l’entraîner tous azimuts. Il y a nécessité de choix.
En termes affairistes, on peut définir la volonté comme le pouvoir exécutif tandis que la liberté représente le législatif, ou dans un autre ordre d’images, le centre de pilotage ou la programmation.
C’est ainsi que s’installe la confusion, dans la tendance à surimposer conceptuellement les deux instances psychiques. Et pourtant, là où il y a choix, il y a exclusion, ou sacrifice. La liberté qui décrète l’intention de l’acte impose une contrainte à la volonté dont le mouvement naturel est spontané. Quand l’agence intérieure psychique propose une image, la volonté a tendance à suivre son désir et à s’élancer, la liberté tergiverse et proclame un arrêt.
Essentiellement, la liberté est le renoncement à toutes les potentialités que l’esprit peut concevoir et la résolution de définir celle que le corps va suivre existentiellement.
La liberté demeure telle dans toutes les situations, même celles dans lesquelles le corps est contraint et l’on peut risquer la formule que l’être humain ne peut pas ne pas être libre.
Pratiquement, la liberté exige un apprentissage et fait l’enjeu d’une culture. Les fonctions mentales de l’humain lui découvrant un jeu infini d’images abstraites, l’organisme qui doit exister concrètement dans ce dédale virtuel doit inventer, codifier des repères afin de survivre efficacement. La liberté doit donc recevoir une éducation, s’adonner à un entraînement.
La liberté s’impose à la volonté propre, elle n’a pas de pouvoir sur autrui. La contrainte exercée sur la volonté de l’autre est la négation de sa propre liberté. L’éducation n’est pas une contrainte, c’est l’incitation à parfaire la maîtrise de l’acte. La dictature est l’asservissement à la volonté, dans l’ignorance de ce qu’est la liberté.
2005
PS 2021
Il faut distinguer et tenir compte en même temps des libertés existentielles et de la Liberté essentielle.
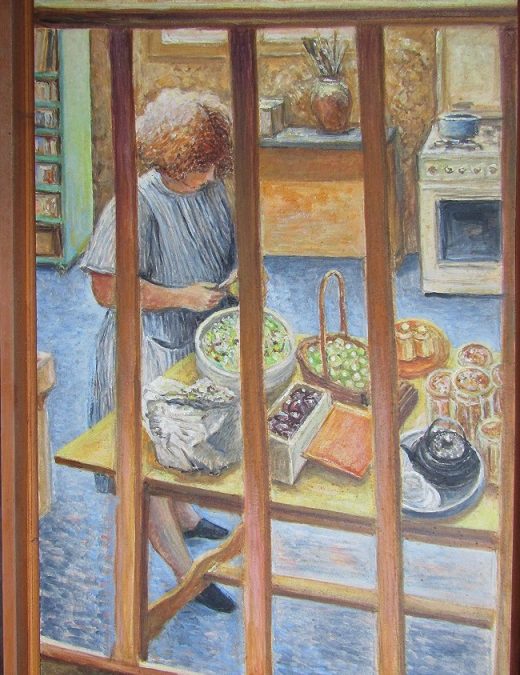
Commentaires récents